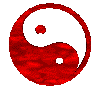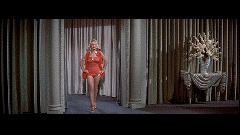-
LE CHEVALIERS
La figure du chevalier
La chevalerie n'est pas la noblesse, même si elle en permet l'accès par la voie des armes. La noblesse a une fonction politique liée en partie à la naissance et à un enracinement territorial. À la différence de la noblesse, la chevalerie n'est pas héréditaire. C'est un ordre auquel on accède par cooptation. Dès l'origine, au XIè siècle, surtout dans le Nord, on y trouve des fils de la plus haute aristocratie d'origine carolingienne, mais également des hommes d'armes issus parfois de la paysannerie. Au XIIè siècle, la chevalerie est devenue une communauté éthique qui est bien autre chose qu'un groupe professionnel. Son prestige se mesure au fait qu'à partir du futur Louis VI, armé en 1097, à l'insu de son père, tous les rois de France tiendront à se faire armer chevalier, ce que fera encore François Ier, au soir de Marignan, par la main de Bayard.
La chevalerie de l'Europe médiévale n'a aucune parenté avec ce que l'on nomme "chevalerie" à Rome. Elle doit son nom à l'usage militaire du cheval qui se généralise à l'époque carolingienne. Durant tout le Moyen Âge, on appelle "homme d'armes" le guerrier monté, plus ou moins cuirassé, qui combat avec la lance et l'épée. L'invention successive, entre le vine et le De siècle, de la selle d'armes à haut troussequin et des étriers, puis du fer protégeant le sabot du cheval, transforme cavalier et monture en un centaure redoutable dans les rencontres et capable de couvrir rapidement de longues distances.
Le mot chevalier, dérivé du bas latin caballarius (cavalier) ne commence à être en usage qu'à la fin du XIè siècle. Il est attesté dans La Chanson de Roland (au vers 110) : "Sur de blancs tapis de soie sont assis les chevaliers" (cevaler). Dans la langue des clercs, en latin, il est le miles, membre de la militia armata. L'un des premiers textes qui mentionne cette militia est dû à saint Bernard, dans une intention critique, par un jeu de mots sans aménité : militia/malitia. L'abbé de Clairvaux oppose à cette chevalerie qu'il juge mécréante et peu respectueuse de l'Église, la nova militia des moines guerriers du Temple, qui bénéficie de tous ses encouragements.
Le rituel chevaleresque, décrit par Chrestien de Troyes, est fixé au me siècle. Il repose sur l'adoubement, symbole d'une reconnaissance de qualités spécifiques et d'une initiation. L'Église s'efforcera d'étendre son contrôle sur l'institution par la bénédiction des armes.
À s'en tenir à la fonction strictement militaire, on ne comprendrait rien à ce qui définit le chevalier. Une éthique incarnée, voilà ce qu'il est. Prouesse, largesse et loyauté sont ses attributs que l'honneur résume. L'élégance de l'âme commande d'être vaillant jusqu'à la témérité. Dans les tournois, dit-on, "c'est dans les pieds des chevaux qu'il faut chercher les preux". La largesse associe le mépris de l'argent à la clémence et à la générosité du coeur enseignée à Perceval par son mentor. Tenir la foi jurée jusqu'à la mort est la troisième obligation naturelle qui implique de se sentir engagé par sa parole ou par un pacte d'amitié mieux que par tous les contrats.
Origines boréennes de la chevalerie
 Parmi les portraits de différents types sociaux tracés par Chaucer à la fin du XIVè siècle dans les Contes de Cantorbery, celui du chevalier ressemble comme un frère au Perceval de Chrestien de Troyes, mais aussi à la plupart des héros de l'Europe ancienne :
Parmi les portraits de différents types sociaux tracés par Chaucer à la fin du XIVè siècle dans les Contes de Cantorbery, celui du chevalier ressemble comme un frère au Perceval de Chrestien de Troyes, mais aussi à la plupart des héros de l'Europe ancienne : Dès les premiers temps qu'il avait commencé
De chevaucher, avait aimé chevalerie,
Loyauté et honneur, largesse et courtoisie,
Il avait fait de grands exploits à la gloire de son seigneur,
Et chevauché plus avant que personne,
Toujours tirant honneur de sa vaillance...
Si l'usage du cheval a donné son nom à l'institution médiévale, il n'est pas constitutif du mental de la chevalerie. Le guerrier achéen, l'hoplite grec, le fian irlandais, le berserker germanique sont des fantassins, et pourtant des préfigurations du chevalier. C'est pourquoi on a pu parler de "chevalerie homérique" pour désigner dans le monde d'Homère la fratrie des couroï. Le couros est un "guerrier noble, que sa naissance et son éducation ont voué au métier des armes [...] et aux raffinements d'un certain idéal". L'histoire atteste l'existence, dans la Grèce d'avant la cité, d'un compagnonnage de guerriers unis entre eux par un esprit, des liens d'initiation et de commensalité, exerçant des fonctions spécifiques dans la paix et la guerre. La même structure se retrouve dans l'ancienne Germanie décrite par Tacite. Au chapitre XIII de sa Germania, il a relaté la cérémonie au cours de laquelle un jeune Germain reçoit ses premières armes, la framée et le bouclier. Elle anticipe sur l'adoubement chevaleresque du XIIè siècle. Même symbolisme, même monde mental. Tout le légendaire celtique prouve des rites de passage analogues dans la milice guerrière des Fianna qui est à l'origine de la chevalerie arthurienne. Comme la noblesse, la chevalerie médiévale hérite également des traditions militaires romaines, de la dignitas et de l'éthique du service.
Ces filiations n'étaient pas ignorées par les intéressés. Au XIIè siècle, dans le prologue de son Cligès, Chrestien de Troyes, écrit : "Nos livres nous ont appris qu'en Grèce régna en premier le prestige de la chevalerie et du savoir. Puis la chevalerie vint à Rome, ainsi que la totalité du savoir, maintenant parvenue en France. Dieu veuille qu'on les y retienne !"
La figure du héros fracassé
 À sa naissance, la chevalerie médiévale était encore toute nimbée d'ancienne religiosité celtique et germanique. Les descendants des guerriers francs de Clovis avaient peut-être oublié jusqu'au nom de leurs anciens dieux, mais ils avaient conservé dans le sang une passion guerrière que le christianisme ne baptisa que superficiellement. "L'hostilité permanente entre clercs et chevaliers qui subsiste à travers tout le Moyen Âge, montre assez à quel point l'aristocratie militaire des pays d'Occident était mal adaptée à une religion qui était pourtant la sienne depuis des siècles".
À sa naissance, la chevalerie médiévale était encore toute nimbée d'ancienne religiosité celtique et germanique. Les descendants des guerriers francs de Clovis avaient peut-être oublié jusqu'au nom de leurs anciens dieux, mais ils avaient conservé dans le sang une passion guerrière que le christianisme ne baptisa que superficiellement. "L'hostilité permanente entre clercs et chevaliers qui subsiste à travers tout le Moyen Âge, montre assez à quel point l'aristocratie militaire des pays d'Occident était mal adaptée à une religion qui était pourtant la sienne depuis des siècles".De fait, les chansons de geste ont beau multiplier les invocations à Dieu et s'en prendre aux "païens", c'est-à-dire aux musulmans, elles reflètent une vie intérieure, où se trouvent exclusivement exaltées la mystique des combats, la bravoure et la mort. Elles renouent ainsi avec l'esprit des poèmes homériques, des sagas scandinaves, des légendes germaniques ou irlandaises, sans atteindre cependant à leur richesse symbolique. En comparaison, leur caractère fruste traduit une culture mutilée, amputée de ses sources spirituelles.
Survivent pourtant dans cette littérature la vitalité foncière de la race et son pessimisme fougueux. Les chansons de geste exaltent la souffrance et la mort plutôt que la victoire. Les histoires qu'elles décrivent ne sont nullement consolatrices. Le héros "clair de visage, large d'épaules, mince de hanches", malgré sa force prodigieuse, son courage sans limite, son épée inaltérable, sera quand même vaincu. C'est toujours dans l'histoire d'un grand malheur que se manifeste la beauté de la geste.
La description impitoyable des souffrances de la guerre est affranchie de toute compassion et de toute sensiblerie. "Souffrir pour comprendre", écrivait Eschyle dans Agamemnon. Il est implicitement admis que c'est devant la défaite, la douleur et la mort que l'homme se révèle.
Alors que, durant ses campagnes, Charlemagne connut beaucoup plus de victoires que de défaites, son compagnon le plus célèbre et le plus chanté est Roland, dont on ne sait rien sinon qu'il fut sans doute vaincu et tué à Roncevaux. Au fil des siècles, l'exaltation du héros intrépide, brusquement terrassé par le destin, reste l'une des constantes de l'imaginaire européen. Le mythe napoléonien n'aurait pas été ce qu'il fut si la gloire d'Austerlitz n'avait été suivie de la défaite de Waterloo et du martyre de Sainte-Hélène. C'est également un signe que l'on ait adopté Vercingétorix – même tardivement – comme premier héros national.
Un esprit indestructible
 Malgré l'ablation de la mémoire, on voit resurgir avec constance, sous les formes les plus inattendues, la célébration du héros fracassé. Ainsi en est-il du culte posthume voué à Che Guevara par une fraction de la jeunesse occidentale dans le dernier tiers du XXè siècle. Guérillero solitaire et improbable, rongé de fièvre, sans espoir et sans illusion, il s'en fut chercher la mort dans un coin perdu des montagnes de Bolivie. Et sans doute, malgré sa philosophie matérialiste, avait-il découvert cette grande vérité : on ne meurt bien que pour l'idée que la mort vous donne de vous-même. L'acceptation du christianisme par la chevalerie doit beaucoup à l'idéalisation européenne du héros sacrifié. L'Église occidentale du Haut Moyen Âge fit du Christ un dieu puissant. D'après la légende, après avoir donné la victoire à Constantin, ne l'avait-il pas également accordée à Clovis ? Au ne siècle, on réalisa même à l'usage des Saxons batailleurs et rétifs, une version épique des Évangiles, le Heliand. Jésus y devenait un prince germanique, ses disciples étant ses vassaux, et les noces de Cana un festin guerrier. Mais le dieu vainqueur était également un héros vaincu par un sort contraire et des ennemis aussi perfides qu'écrasants. Cela fut certainement plus important pour la conversion des Celtes, des Francs et des autres Germains que les Évangiles, ignorés pour l'essentiel par le Moyen Âge, faute d'accès aux Écritures. Être chrétien se résumait à croire en la divinité du Christ, dont l'aristocratie d'épée se faisait une idée assez peu chrétienne.
Malgré l'ablation de la mémoire, on voit resurgir avec constance, sous les formes les plus inattendues, la célébration du héros fracassé. Ainsi en est-il du culte posthume voué à Che Guevara par une fraction de la jeunesse occidentale dans le dernier tiers du XXè siècle. Guérillero solitaire et improbable, rongé de fièvre, sans espoir et sans illusion, il s'en fut chercher la mort dans un coin perdu des montagnes de Bolivie. Et sans doute, malgré sa philosophie matérialiste, avait-il découvert cette grande vérité : on ne meurt bien que pour l'idée que la mort vous donne de vous-même. L'acceptation du christianisme par la chevalerie doit beaucoup à l'idéalisation européenne du héros sacrifié. L'Église occidentale du Haut Moyen Âge fit du Christ un dieu puissant. D'après la légende, après avoir donné la victoire à Constantin, ne l'avait-il pas également accordée à Clovis ? Au ne siècle, on réalisa même à l'usage des Saxons batailleurs et rétifs, une version épique des Évangiles, le Heliand. Jésus y devenait un prince germanique, ses disciples étant ses vassaux, et les noces de Cana un festin guerrier. Mais le dieu vainqueur était également un héros vaincu par un sort contraire et des ennemis aussi perfides qu'écrasants. Cela fut certainement plus important pour la conversion des Celtes, des Francs et des autres Germains que les Évangiles, ignorés pour l'essentiel par le Moyen Âge, faute d'accès aux Écritures. Être chrétien se résumait à croire en la divinité du Christ, dont l'aristocratie d'épée se faisait une idée assez peu chrétienne.Barons et chevaliers n'avaient retenu des sermons que les mots agréables à leurs oreilles. L'expression "Dieu des armées" était prise au pied de la lettre. Habitués à un Walhalla peuplé de divinités guerrières, les nouveaux convertis se faisaient un paradis à leur image, sans s'interroger sur la généalogie véritable des nouveaux promus. Saint Michel, saint Georges, saint Maurice, saint Martin, saint Eustache, et quelques autres anciens militaires à temps partiel, avaient leur faveur. Et c'est moins la fermeté du martyre qu'ils retenaient, que la bravoure supposée du soldat. Les croisades contribuèrent à aplanir l'équivoque. L'Église parlait enfin un langage que les hommes d'épée pouvaient comprendre, conciliant leur foi chrétienne encore incertaine avec leurs aspirations profondes. Devenus soldats du Christ, les "Barbares" se christianisèrent. Mais par un mouvement de réciprocité, l'Église se "barbarisa", s'européanisa. Durant quelques siècles, la chrétienté tira sa force de cette injection massive de violence, d'énergie et de courage qui recevait la caution religieuse de la "guerre juste".
La bonne conscience accordée au chevalier restait cependant conditionnelle. Ce n'est pas la vocation guerrière en elle-même qui était justifiée – impossibilité majeure pour une religion dont l'essence est étrangère aux valeurs de l'épée –, mais l'usage qui en était fait, dans la convergence avec les intérêts de l'Église.
En dépit des croisades, la méfiance réciproque ne connut qu'une trêve relative. La querelle des guelfes et des gibelins prit naissance dès cette époque. La fracture s'accentua au temps de la Renaissance. Dans les villes d'Italie d'abord, puis de Germanie, de France et d'ailleurs, surgirent d'arrogantes statues équestres jusque sur le parvis des églises. Elles proclamaient le retour du héros et son éternité. Ce que firent aussi les toiles du Greco, de Vélasquez, du Titien ou la très subversive estampe de Dürer, où l'on voit le Chevalier marcher vers son destin, indifférent à la fois à la Mort et au Diable.
En Allemagne d'abord et dans bien d'autres pays, le succès foudroyant de la Réforme tint pour une large part au soutien de la noblesse hostile à Rome et fidèle aux valeurs de la féodalité. À partir du XVIIIè siècle, siècle du divorce de l'épée et de la foi, les ruptures que provoquèrent les grandes crises européennes étaient également contenues dans les héritages contradictoires de l'Europe.
L'esprit de la chevalerie avait-il disparu pour autant ? Au XXè siècle, parmi les nombreuses horreurs des deux guerres mondiales, les gestes chevaleresques n'ont pas manqué entre belligérants européens. Plus tard encore, dans une époque qui échappait à l'ancienne éthique, la noblesse des sentiments continua cependant de s'exprimer dans la littérature et le cinéma.
De la façon la plus imprévisible, l'âme chevaleresque s'empara d'un genre littéraire nouveau où personne ne l'attendait. Toute une part du roman noir et des films qui en sont inspirés fait revivre, et souvent chez les mauvais garçons, l'honneur, le courage et la loyauté qui ont déserté la réalité visible. L'esprit qui circule ici ou là dans cette littérature vigoureuse, fidèle aux vertus classiques du roman, semble surgir du même terreau que celui des tragédies grecques, des sagas scandinaves ou des chansons de geste. Rien ne montre mieux le caractère impérissable d'un esprit capable de traverser le temps et de resurgir sous les apparences les moins propices.

Dominique VENNER
In Histoire et tradition des Européens (30 000 d'identité)
Editions du Rocher
Souces : http://www.theatrum-belli.com/archive/2007/04/06/la-figure-du-chevalier.html
-
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Vous devez être connecté pour commenter
Dona Rodrigue