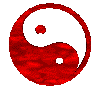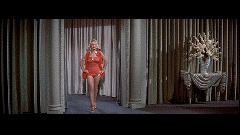-
Quelques termes de mesuresAbeillage
L'abeillage est un impôt seigneurial en nature conférant au seigneur féodal une certaine portion du miel issu des ruches de ses vassaux. Ce droit lui donnait aussi la propriété des abeilles éparses et non poursuivies.
Acapte
Droit de mutation qui survient à la mort du seigneur ou lors de la mort du censitaire. On utilise le plus souvent l'acapte pour désigner le droit dû à la mort du seigneur et l'arrière-acapte pour désigner le droit dû par le nouveau tenancier à la mort de son prédécesseur. Mais on trouve aussi l'inverse.
Adoubement
Cérémonie par laquelle un homme est fait ou ordonné chevalier. De à et du francique dubban, frapper. Le nouveau chevalier reçoit de l'adoubeur un violent coup sur la nuque du plat de l'épée (colée, paumée).
Acte
Acte cérémoniel par lequel l'impétrant est fait chevalier et reçoit ses armes. A partir du XIIe siècle, l'Église s'empare du cérémonial et c'est monsieur l'évêque lui-même qui procède au sacrement, à la bénédiction de l'épée ainsi qu'à la grande messe.
Afforage
Droit du seigneur à se faire remettre une certaine quantité de vin ou de bière lors de la mise en perce d'un tonneau (perçage du trou destiné au tirage de la boisson).
Affouage
Droit de prendre du bois de chauffage dans une forêt. Cela peut être le cas pour la communauté d'habitant dans la forêt seigneuriale ou pour le seigneur (chauffage du four banal) dans une forêt qui appartient aux habitants.
Afféagement
L'afféagement est un droit féodal qui consiste à démembrer un fief en lui soustrayant des terres dont le preneur doit payer le cens en nature ou en argent.
Ce droit permet au moment des grands progrès agricoles du XVIIIe siècle de mettre en valeur les terres incultes. Les prix agricoles étant alors élevés, l'opération est d'un bon rapport. Les paysans y sont très hostiles car ils perdent ainsi des terres où ils pratiquent la vaine pâture; par contre les bourgeois sont preneurs avec leurs fermiers ou leurs métayers.
Cession par le seigneur à un acquéreur, contre une redevance, d'une partie du domaine seigneurial ou des terres nobles.
Agrier
Agrier : droit prélevé sur les propriétés rurales soit en argent, soit en nature.
Aide
Une des catégories de services dus par le vassal à son seigneur comprenand des obligations d'ordre militaire de nature fort diverse (les plus courants: ost et chevauchée, garde du château ou estage) et d'ordre écuniaire: dans un certain nombre de cas, progressivement limités à trois ou quatre à partir du XIIe siècle (chevalerie du fils aîné, mariage de la fille aînée, croisade, rançon, souvent accroissement du fief), le seigneur peut imposer à son vassal une contribution extraordinaire.
Albergue
Droit du seigneur de se faire heberger, au 13eme siècle cela devient un impot en argent.
Alberque ou albergue : taxe versée au seigneur afin d'être dispensé de battre au sol ses récoltes.
Alleu
Du francique alôd. Durant le Haut Moyen Age, l'alleu désigne les biens patrimoniaux par opposition aux acquêts. Sous les Carolingiens, l'alleutier doit la dîme à l'église et l'aide militaire au souverain si celui-ci est attaqué. Ensuite (XIe-XIIIe siècle), l'alleu désigne un bien possédé en pleine propriété, le plus souvent hérité et sans seigneur, par opposition à la tenure paysanne et au fief: l'alleu ne comporte ni hommage ni services nobles ; dans celui des paysans, par opposition à tenure, l'alleu, terre indépendante de tout seigneur foncier, n'entraîne ni redevances, ni services, ni droits. Surtout répandu, à tous les niveaux, dans le Midi.
Terre libre, non soumise à l'autorité d'un seigneur. L'alleu roturier est la propriété de l'homme non-noble qui possède la terre et généralement la cultive. Il peut aussi être la propriété d'un noble (souvent un chevalier à cette époque) ou être un bien de l'Église dans ce cas il s'apparente à un fief. Si l'alleu est souverain, son propriétaire y exerce la justice.
Alleu : terre libre pour laquelle le propriétaire ne devait aucune redevance et ne relevait d'aucun seigneur.
Alleutier
Personne possédant une terre en franchise de droits.
Alleutier : propriétaire d'un alleu.
Allège
Pan de mur situé sous une fenêtre.
Amban
Amban : synonyme de cornière désignant des couverts entourant les places des bastides. Androne : espace de 25 à 40 cm créé entre les maisons voisines pour éviter les incendies et fermé en général au milieu de sa hauteur par des murs qui se rejoignaient. Arayer : terme de vieux français signifiant équiper ou diviser une terre. Araze : ancienne mesure de longueur équivalant à 0,46 m.
Amortissement
Elément ornemental placé au sommet de tout axe vertical d'une élévation (pinacle, statue, etc.).
Ansange
Surface rectangulaire de 40 perches de long sur 4 perches de large, à raison d'une perche de I0 pieds. Estimé à un peu plus ou un peu moins de I4 ares selon les auteurs contemporains.
Apanage
Terre ou bien donné par le roi à ses enfants pour compenser leur exclusion à la couronne, celle-ci étant réservée à l'aîné.
Araire
De l'ancien provencal araire, du latin aratrum, charrue. L'araire est un instrument de labour qui, à la différence de la charrue faite pour retourner la terre, rejette la terre déplacée de part et d'autre du sillon creusé. Déjà mentionné au IVe millénaire avant Jésus-Christ, il apparaîtra sous nos latitudes deux millénaires plus tard. L'araire était appelé binot dans le Nord.
Archère
Archère : ouverture verticale et étroite pratiquée dans une muraille pour permettre le tir à l'arc ou à l'arbalète sur les assaillants.
Archidiacre
Clerc assistant l'évêque, le plus souvent chargé d'une subdivision du diocèse, l'archidiaconé. A l'époque mérovingienne, très souvent chargé par l'évêque de l'administration du temporel de l'évêché.
Are
Unité de superficie agraire égale à 100 mètres carrés.
Arpent
Unité de mesure agraire divisée en quatre quartiers, chaque quartier se divisant en quarterons. La surface de l'arpent pouvait selon les régions varier de 30 à 60 ares. L'arpent carolingien (environ I2 ares) disparut au cours du XIIe siècle.
Ancienne mesure agraire de 20 à 50 ares.
Ancienne mesure agraire qui contenait cent perches carrées : mais l'arpent variait beaucoup, parce que la perche variait elle-même. Les arpents les plus usités étaient celui de Paris, qui valait environ un tiers d'hectare, et celui des Eaux et Forêts, qui valait un demi-hectare, à très peu près.
Arpent : terre de culture. Ce terme était aussi utilisé pour désigner une unité de terre arable.
Arpent de Troyes
Pour la région, il était d'après une charte de la commanderie de Troyes, de 6 perches de large et de 30 perches de longueurs.
La Perche de Troyes
dans cette même région était alors de 18 pieds une sole.
Assolement
Désigne à la fois la succession des cultures dans le temps et la répartition des cultures sur l'espace cultivé. L'assolement peut comporter en outre une période de repos d'une ou plusieurs années, la jachère.
Aune
Du francique alina, avant-bras.
Mesure de longueur de valeur variable utilisée surtout pour mesurer les étoffes. A Paris, une aune valait 1,188 mètre.
Est égal à 1,90 mètres. Il existe des 1/2 (0,95m), 1/4 (0,47m) et 1/8 (0,24m) d'aune. Il existe aussi des 1/3 (0,63 m), 1/6 (0,32m) et 1/12 (0,16m) d'aune pour la mesure des étoffes.
Aune de Frayssinet
vaut 1,028 mètre. Elle est surtout utilisée dans les environs de Frayssinet et de Rouffilhac. Elle correspond à 38 pouces.
Aune de Gourdon
vaut 1,0352 mètre. Elle peut être divisée en 1/2, 1/4, 1/8 d'aune. Elle correspond à 38,25 pouces.
Aune de Marminiac
vaut 1,082 mètre. Elle correspond à 40 pouces (ou 3 pieds et 4 pouces).
Aune de Paris
dans le Lot, elle vaut 44 pouces et on la divise en 4 pans de 11 pouces chacun. Utilisée essentiellement pour la mesure des étoffes.
Aveu
En droit seigneurial, l'aveu est une déclaration écrite que doit fournir le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief (par achat ou héritage). L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief.
Suit généralement l'investiture du fief : le vassal, pour éviter toute contestation ultérieure, "avoue" son fief; de même, le seigneur avoue (reconnaît) son vassal et inversement.
Aveu et Dénombrement
Description de tout ce qui constitue un fief par le vassal à son suzerain dans les 40 jours qui suivent la foi et hommage. Il en est de même pour le censitaire, mais si, pour le vassal, cette obligation ne lui incombe qu'une seule fois dans sa vie, le censitaire, lui, peut avoir à la refaire selon certains intervalles.
Ayral
Ayral : terme équivalent à localium et désignant l'espace réservé à une maison et à ses dépendances.
Baillie
Baillie ou baylie : juridiction dans laquelle le bayle, ou bailli, représentant du seigneur ou du roi, avait autorité.
Ban
Ban : proclamation publique d'autorisations ou d'interdictions énoncées par le roi ou le seigneur. Banalité : droit du suzerain d'obliger le vassal à utiliser moyennant redevance une installation dont il était propriétaire (four, moulin,...).
Bandoulier
Bandoulier : terme utilisé en Bigorre pour désigner les bandits qui sévissaient dans les baronnies voisines.
Banalités
Les banalités sont des installations techniques que le seigneur est dans l'obligation d'entretenir et mettre à disposition de tout habitant de la seigneurie. La contrepartie en est que les habitants de cette seigneurie ne peuvent utiliser que ces installations seigneuriales, payantes. Ce sont donc des monopoles technologiques.
Les principales banalités sont :
le four banal
le moulin banal
le pressoir banal
le marché aux vinsBarbacane
Barbacane : ouvrage de fortification, bas et avancé, destiné à protéger une porte ou la tête d'un pont.
Barris
Barris ou barrys : faubourgs d'une agglomération.
Barrau
Ancienne mesure de capacité qui servait à mesurer les liquides. Le Barrau se divisait en 20 ou 36 pots et équivalait, en Provence à cinquante litres ; en Languedoc à 60 et en Dauphiné à 43 ou 30.
Beffroi
Beffroi : tour ou clocher de l'hôtel de ville où l'on sonnait l'alarme.
Bicadier
Bicadier : qualificatif de l'homme qui cultivait la terre avec sa pioche.
Blairie
Dans la France du Moyen Âge et de l'Ancien Régime la blairie est un impôt seigneurial sur le pacage des animaux.
Le seigneur perçoit une redevance en avoine pour rétribution du pacage des animaux des paysans, sur les terres cultivées (après la récolte) ou non cultivées. Ce droit existe en Auvergne, Berry, Bourgogne et Nivernais.
Boiselée de terre
Ancienne mesure de superficie (1 are 25) qui est la 64e partie de la saumado.
Boisseau
(ancien)récipient cylindrique qui servait de mesure de capacité pour les matières sèches; cette unité de mesure (12 litres).
Ancienne mesure de capacité pour les matières sèches, valant 13 litres, 01, ou 13 litres plus un centième réduits à 12 litres 50, c'est-à-dire au demi-quart de l'hectolitre, lorsqu'on voulut ramener les anciennes mesures aux mesures métriques. Vendre, mesurer au boisseau.
Le Boisseau, a une capacité qui varie suivant le lieu entre 20 et 40 litres.
Bordalia
Bordalia : les bordalia, vraisemblablement analogues aux bordes des vallées pyrénéennes, devaient être des granges-étables.
Bouisseu
Mesure de capacité usitée en Languedoc et en Gascogne équivalant à 3 litres 125, c'est à dire le 1/4 de la quarto et le 1/8 de l'eimino.
Brasse
La brasse (anglais fathom, symbole fm) est une ancienne mesure de longueur correspondant à l'envergure des bras. Cette unité, bien qu'autrefois utilisée pour la mesure des terres, n'est encore usitée que dans la marine pour mesurer les cordages, les filins ainsi que la profondeur de l'eau. Cela dit, il ne s’agit là que de la traduction française de l’unité anglo-saxonne "fathom".
Brassée : mesure de longueur valant approximativement 1,96 m.
Canne
Canne de Bourg de Visa
elle équivaut à 8 pans ou 64 pouces et sa longueur est de 1,732 mètre.
Canne : ancienne mesure de longueur variant selon les contrées entre 1,71 m et 2,98 m.
Canne de Cahors
il y en a quatre sortes :
1° Une canne utilisée pour le toisé des bâtiments, les étoffes et le bois de charpente. Elle sert aussi de base à la mesure agraire. Valeur : 1,786 mètre soit l'équivalent de 66 pouces, division en 8 pans de 8 pouces et 3 lignes.
2° Une canne de 70 pouces de long qui se divise en 8 pans de 8 pouces et 9 lignes chacun. La moitié de cette canne soit 35 pouces est sous le nom d'aune utilisée par les marchands de tissus. Valeur : 1,894 mètre.
3° Une canne utilisée par les marchands détaillants et qui, longue de 73 pouces et 4 lignes se divise également en 8 pans de 9 pouces et 2 lignes chacun. Valeur : 1,985 mètre.
4° Une canne de 75 pouces de long qui se divise en 2 aunes ou en 8 pans de 9 pouces et 4,5 lignes. Valeur : 2,003 mètres. Elle est utilisée pour mesurer les toiles.
Canne de canavassière de Caussade et Montpezat
elle équivaut à 9 pans 8 pouces et 6 lignes. sa longueur est de 2,070 mètres.
Canne de canavassière de Montauban
elle est utilisée pour mesurer les toiles de pays. Elle équivaut à 10 pans 8 pouces et 6 lignes. sa longueur est de 2,30 mètres.
Canne de canavassière de Moissac ou Puy-Lévêque
elle équivaut à 9 pans 8 pouces et 4 lignes chacun. Sa longueur est de 2,03 mètres.
Canne de Caussade ou de Montpezat
équivaut à 5 pieds et 8 pouces. Elle se compose de 8 pans de 8 pouces et 6 lignes chacun. Valeur : 1,840 mètre.
Canne de Figeac
Elle aurait varié et équivalait initialement à 6 pieds 1 pouce et 8 lignes. Puis, elle est passée à 6 pieds et 2 pouces au XVIIIème siècle ou elle se compose de 8 pans de 9 pouces et 3 lignes chacun. Valeur : 2,003 mètres. Elle est utilisée à Cajarc, Gorses, Lacapelle-Marival, Lalbenque, Livernon, Puylagarde, Saint-Projet et Viazac.
Canne de Gourdon
vaut 2,0704 mètres soit 2 aunes de Gourdon.
Canne de Mirabel, Molières et Septfonds
se compose de 8 pans de 8 pouces et 8 lignes chacun. Valeur : 1,870 mètre.
Canne de Moissac et Lauzerte
se compose de 8 pans de 8 pouces et 4 lignes chacun. Valeur : 1,804 mètre.
Canne de Montcuq
se présente sous 3 formes :
1° Pour les tissus de laine, c'est une mesure de 5 pieds 2 pouces qui se divise en 8 pans et 7 pouces 9 lignes chacun. Valeur : 1,677 mètre.
2° Pour les toiles, elle a la même longueur que la toise de 6 pieds de Roi. Valeur : 1,948 mètre.
3° Pour les bois de construction, elle a la même valeur que la canne de Figeac. Valeur : 2,003 mètres.
Canne particulière de Moissac
se compose de 8 pans de 8 pouces et 7 lignes chacun. Valeur : 1,858 mètre.
Canne de Saint-Céré
est égale à 6 pieds et 4 pouces. Elle se divise en 2 aunes et 4 demi-aunes. Chaque demi-aune vaut 2 pans et chaque pan vaut 2 crues. Elle est aussi utilisée à Bretenoux et dans les localités voisines. Elle sert surtout à mesurer les toiles et étoffes du pays. Valeur : 2,057 mètres. Pour les autres mesures, l'aune de Paris est utilisée.
Cartonnée
Cartonnée : unité de surface valant environ 7 ares.
Carreyrou
Carreyrou : ruelle ou venelle située derrière une maison.
Casal
Casal : terme générique désignant un domaine, mais plus particulièrement utilisé dans les bastides pour les jardins attenant aux habitations.
Castelnau
Castelnau : village neuf construit au cours des XIIe et XHIe siècles autour d'un château.
Cavalcade
Cavalcade : obligation de suivre le seigneur au cours d'une expédition militaire de courte durée, appelée chevauchée.
Cens
Le cens désigne, à diverses époques historiques, l'impôt direct payé par les citoyens. Il est dû pour la terre du seigneur que la personne exploite.
Cens : redevance en argent ou en nature due par les tenanciers au seigneur du fief dont relevait le terrain.
Censive
La censive est une terre que le seigneur a vendue, il en a vendu la possession, ainsi que la propriété utile : seul le nouvel acheteur, désormais propriétaire, est responsable de cette terre et propriétaire de sa production. Mais, la censive reste une partie de la seigneurie, reste donc soumise au droit seigneurial. Le seigneur y a encore la propriété éminente.
Les censives de la seigneurie et leur différentes mutations - achat et ventes, divisions, etc. - sont inscrites dans un livre terrier, soigneusement conservé puisque déterminant quels sont les droits du seigneur sur chaque terre.
Ce domaine est soumis à un impôt que l'on appelle cens.
Censive : taxe relevant du cens.
Champart
Sous l'Ancien Régime, le champart est un impôt seigneurial, prélevé en nature, proportionnel à la récolte, oscillant entre 1/12 à 1/6. Il est prélevé après la dîme due au clergé.
Selon les provinces, il s'appelle : arrage, gerbage, parcière, tasque, terrage.
Chevage
Taxe légère et régulière payée surtout par les serfs.
Charretière
Charretière : qualificatif donné aux rues principales qui permettaient le passage des charrettes.
Chevauchée
Chevauchée : service militaire exécuté sous la forme d'un raid de quelques jours et dû au seigneur par l'habitant de la bastide.
Consuls
Consuls : représentants des habitants auprès du seigneur ou des officiers royaux, chargés de l'administration de la ville en liaison avec le bayle.
Convers
Convers : religieux de rang subalterne employé aux tâches domestiques dans les abbayes et les monastères.
Cornière
Cornière : portique formant un passage couvert au rez-de-chaussée des maisons qui bordaient la place principale des bastides. Crestianie : léproserie.
Cotte
Cotte : robe de laine portée par-dessus la chemise.
Coudée
Coudée : ancienne unité de mesure de longueur équivalant à environ 0,48 m. Denier : unité monétaire qui valait deux mailles. Il y avait douze deniers dans un sou. Dex : étendue et limites du territoire d'une nouvelle fondation.
Condamine
Le nom provient du Moyen-Age et signifie la terre cultivable au pied d'un village ou d'un château.
Décimateur
Le décimateur était, sous l'Ancien Régime, celui (individu ou communauté) qui avait le droit de lever la dîme (impôt en nature prélevé par l'Eglise sur les productions agricoles).
Dîme
La dîme — du latin decima, dixième — était, sous l'Ancien Régime en France, un impôt collecté en faveur de l'Église catholique et servant à l'entretien des ministres du culte.
Dîme : taxe versée à l'église et représentant en principe la dixième partie des produits de la terre et de l'élevage.
Droit de relief
En France au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, le relief, est un droit seigneurial sur les mutations de propriétés nobles ou roturières.
Le droit de relief doit être payé au seigneur dominant si la mutation n'est pas due à une succession en ligne directe ou à une vente. Le montant représentait une année de revenu du bien.
Voir : L'acapte est due en cas de succession en ligne directe.
Droit d'usage
Le droit d'usage désigne le plus souvent les droits d'une communauté villageoise de prendre du bois ou de faire paître le bétail dans une forêt seigneuriale, ou d'autres particuliers, ainsi qu'une série de petits droits, tels que le droit, pour femmes et enfants, de ramasser les grains tombés des épis durant la moisson, etc.
Ecu
L'écu – a une étymologie identique à l'escudo : le bouclier – est une monnaie du Moyen Âge - apparue en 1263 - et de l'Époque moderne, à l'origine orné d'un motif d'écu (bouclier). L'écu valait 3 livres.
En France, le nom d'écu est initialement attribué à des monnaies en or, puis à partir du règne de Louis XIII, le terme écu blanc désigne la plus grande pièce d'argent, 60 sols.
Emine
Au Moyen Âge, l'émine est une mesure de volume de grains ; dans le comté de Bourgogne, le muid vaut 12 émines, et l'émine contient 30 livres, soit environ 20 litres.
Encours
Encours : opération de confiscation de biens menée contre des Albigeois.
Emonée
Emonée : unité de surface valant environ 57 ares.
Encorbellement
Encorbellement : terme utilisé pour désigner un élément en saillie par rapport au reste des murs.
États généraux de 1317
Les états généraux, à la mort de Louis X le Hutin, déclarent que "à couronne de France, femme ne succède pas", deshéritant ainsi Jeanne II de Navarre au profit de son oncle, Philippe V le Long. La loi salique devient principe dynastique en France et interdit désormais le trône de France aux femmes.
Fief
Fief (une partie du domaine royal) octroyé par le roi à ses fils cadets ou à ses frères en renoncement à la Couronne. En cas de disparition de la branche apanagée, le fief revient à la Couronne.
Fief : domaine qu'un vassal tenait d'un seigneur sous réserve de lui rendre hommage et de lui payer des redevances.
Forage
Impôt sur la vente du vin en gros.
Fouage
Fouage : impôt extraordinaire payé dans certaines provinces sur chaque feu.
Fournage
Impôt pour l'utilisation du four banal.
Formariage
En vertu de ce droit de formariage (ou for-mariage), les serfs ne pouvaient contracter mariage qu'avec un sujet de la seigneurie, à moins de la permission du seigneur ; ceci afin d'éviter la dépopulation.
Le formariage est le droit payé au seigneur, à l'occasion du mariage, d'un serf hors de la seigneurie ou avec une personne de condition libre.
Ce droit a quasiment disparu dans les deux siècles précédant la Révolution de 1789.
Franc-fief
En France, au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, le franc-fief est un impôt seigneurial puis royal dû par un roturier acquéreur d'un bien noble.
Cet impôt est la compensation de la diminution de la valeur du fief ainsi amputé. A l'origine il est payable à tous les échelons de la hiérarchie féodale. Puis seulement à trois échelons, le roi compris. Enfin seul le roi le perçoit.
Ce droit est dû tous les 20 ans ou à l'occasion d'une mutation inopinée.
Gabelle
Sans doute inventé par Philippe V le Long, l’impôt sur le sel est associé par Philippe VI de Valois au monopole royal décrété par lui en 1331, puis en 1342, sur la vente de ce produit. Le principe de base est simple : le sel ne peut être vendu, moyennant paiement d’une taxe, que dans "les greniers royaux à sel" ; la gestion de ceux-ci est "confiée à ferme" ou "affermée" à des "grenetiers" qui achètent au roi ce lucratif état.
Glandée
La glandée est une pratique qui permet d'envoyer ses porcs paître dans les forêts pour y consommer les glands des chênes et les faînes des hêtres.
La glandée se pratique en automne, sa durée varie selon les coutumes, du début septembre (Notre-Dame de septembre), de la fin septembre (Saint-Michel) ou du début octobre (Saint-Rémy) à la fin octobre (Saint-André). Certaines coutumes la prolonge tout l'hiver. Le seigneur perçoit un droit qu'il donne à bail.
Grange
Grange : exploitation rurale médiévale dépendant d'une abbaye ou d'un prieuré et généralement cultivée par des frères convers.
Guier
Guier : sergent, gardien d'un territoire dont il surveillait les limites.
Gros tournois
Le gros tournois est une monnaie d'argent créée par saint Louis lors de sa réforme monétaire de 1260-1263.
Le gros d'argent pèse environ 4,52 grammes d'argent presque pur, et vaut 12 deniers tournois, soit 1 sou (équivalence de l'époque : 1 livre = 20 sous = 240 deniers. Donc 1 sou = 12 deniers).
Le gros d'argent est créé après la Septième croisade (1248-1254), après que saint Louis a découvert le système monétaire arabe. Lors du même mouvement de réforme, il crée aussi les premières émissions d'or du royaume, les écus d'or, mais ceux-ci en nombre très limité, dans un but purement politique.
Impôts sur les terres
1 vergée : 8 sous, 1 denier, 4 chapons
5 vergées : 40 sous, 7 deniers, 1 agneau
1 arpent cultivé : 4 deniers (à Troyes en 1175)
1 maison : 12 deniers, 1 boisseau d'avoine (à Troyes en 1175)
1 vergée : 140 deniers
1 maison : 50 deniers
A Grenoble :
1 mas : 2 porcs, 1 mouton, 2 agneaux, 1 chapon, 8 setiers d'avoine (586 l), 1 muid de vin (1000 l), 1 setier de légumes, 2 barriques ou l'équivalent en argent.
1 cabannerie : 8 sétiers de legumes
1 barderies : 1 porc
L'évêque de Grenoble reçoit pour ses terres 17 porcs et d'autres impots.
Journal
Ancienne mesure de terre, en usage encore dans certains départements. Le journal varie suivant les provinces. En fait c'est le temps qu'un paysan passe dans son champ pour y travailler : 1 journal est égal à surface cultivée durant une journée de travail.
Le Journal, correspond à environ 40 ares.
Leude
Leude : impôt prélevé sur les denrées et marchandises vendues sur le marché ou au cours des foires et généralement perçu uniquement sur les personnes étrangères à la bastide.
Ligne
La Ligne équivaut à 0,002 mètre soit 2 centimètres.
Lieue
La lieue de 2000 toises vaut 3.900 mètres.
La Lieue de 25 au degré correspond 4.400 mètres.
Livre (unité française)
Au Moyen Âge, sa valeur en France variait suivant les provinces entre 380 g et 552 g.
Il fallait notamment distinguer entre la livre de poids, divisée en 12 onces (cf. libra), et la livre de poids de marc (1 marc = 8 onces) qui valait 2 marcs, soit 16 onces (cf. mina).
Une livre vaut 20 sous ou 240 deniers. Un sou égale 12 deniers.
Livre parisis
Monnaie de compte utilisée sous l'Ancien Régime, en référence aux espèces monétaires fabriquées par l'atelier de Paris.
Elle demeure la monnaie de compte officielle du domaine royal jusqu'en 1203, où elle est remplacée par la livre tournois. Elle subsiste dans quelques régions de France jusqu'en 1667, date à laquelle son emploi est interdit.
La valeur de la livre parisis était fixée à : 1 livre parisis = 1,25 livre tournois
Livre tournois
La livre tournois se subdivise en sols, et deniers.
1 livre tournois = 20 sols tournois
1 sol = 12 deniers tournois
Avec donc : 1 livre tournois = 240 deniers.
Il est difficile de donner une valeur actuelle à une monnaie ancienne mais, pour pouvoir se faire une idée de ce que la livre tournois valait à l'époque, les historiens lui donnent une valeur moyenne de 8 euros de 2006. Ainsi, en lisant : "le cardinal Mazarin a laissé à l'État français l'ensemble de ses biens, pour un total de 35 millions de livres, dont 8 millions en liquide", on comprendra 280 millions d'euros dont 64 millions en espèces.
Localium
Localium : terme utilisé pour désigner l'emplacement d'une maison.
Manse
Du latin mansus. Centre d'exploitation rurale : maison, bâtiments, annexes, enclos. Exploitation rurale complète: bâtiments, champs, prés et tous droits d'usage. Cette exploitation rattachée à un domaine. Étendue de terrain équivalent à l'étendue moyenne d'un manse. Le manse est une parcelle habitée par le "manant" (du lat. manere) dans sa maison (mansio) ou mas. C'est le centre d'une petite exploitation agricole, utilisée pour la répartition des redevances et des services. À l'origine l'étendue du manse variait en fonction de la qualité du tenancier. La superficie arable et l'équipement du manse devaient permettre à une famille paysanne de se nourrir et d'acquitter les charges dues au propriétaire foncier.A l'époque carolingienne, le manse est une unité foncière servant d'assiette aux perceptions domaniales. Le manse carolingien est grevé de services en travail sur la réserve du maître ainsi que de redevances en nature et en argent.
Le manse est l'unité d'exploitation qui est institué à partir des Carolingiens. Il comprend la maison et ses dépendances, le jardin et la quantité de terre cultivable par une famille (10 à 20 hectares). On distingue trois sortes de manse :
1. Manses serviles: détenus par les serfs.
2. Manses lidiles: détenus par les affranchis.
3. Manses ingénuiles: détenus par les paysans libres.
Terre agricole, avec une maison, de taille suffisante pour faire vivre une famille, au moyen âge
Manse : ensemble regroupant au Moyen Age l'habitation, le jardin et les terres.
Marc (unité de masse)
Le marc est une ancienne unité de masse, valant huit onces ou une demi-livre.
En France, dans les unités françaises pré-métriques, le système de masse se disait justement "les poids du marc" et le marc valait environ 244,8 grammes.
Marc : ancienne monnaie d'or ou d'argent pesant 8 onces. Ce mot désignait aussi la quantité d'or ou d'argent pesant 8 onces.
Mazel
Mazel : banc de boucher installé sous la halle.
Mense
La mense est le revenu destiné à l'entretien d'une personne ou d'une communauté religieuse. La mense d'un évêché est composée de la mense épiscopale qui revient à l'évêque et de la mense capitulaire qui revient aux chanoines et qui est divisée en autant de prébendes que de membres. Au niveau monastique, la mense abbatiale revient à l'abbé alors que la mense conventuelle revient aux moines.
Mességuier
Mességuier : garde chargé principalement de surveiller les récoltes.
Mesure de Grains
Quarte, vaut entre 24,03 et 87,75 litres.
Sac, vaut entre 82,50 et 87,50 litres.
Setier, vaut entre 30,70 et 144 litres.
Mesures des Huiles
Baste
correspond à une contenance de 47,25 litres. Elle est utilisée uniquement à Gagnac et équivaut à 3 setiers.
Livre
vaut entre 0,514 et 1,007 litres. Elle peut être divisée en 1/2, 1/4, 1/8 et 1/16 de livre.
Pauque
correspond à 0,492 litre. Elle est utilisée uniquement à Gagnac.
Setier
correspond à une contenance de 15,75 litres. Elle est utilisée uniquement à Gagnac et équivaut à 32 pauques.
Mesures des Surfaces
Prime
vaut entre 32,50 et 140,90 ares.
Quarte
correspond à une superficie de 45,96 ares.
Quarterée
vaut entre 23,54 et 51,07 ares.
Quartonat
est égal à 7,70 ares.
Quartonée
vaut entre 8,54 et 19,15 ares.
Padouens
terrains vagues utilisés pour faire paître le bétail.
Paréage
convention de droit féodal conclue entre un seigneur puissant offrant sa protection et un autre plus faible qui donnait en indivision une seigneurie dont les revenus étaient alors partagés.
Perche
Ancienne mesure agraire de dix-huit, vingt ou vingt-deux pieds, suivant les différents pays, cent perches faisant toujours un arpent.
Pied
Le pied vaut à 0,325 mètre. Il est égal à 12 pouces.
Pugnerée
unité de surface valant environ 14 ares.
Mouture
Impôt pour l'utilisation du moulin.
1 sac sur 16 au meunier.
Pour 5 minots de blé à moudre, le seigneur touche 1 boisseau.
Muid
Le muid, du latin modius, "la mesure [principale]" est une ancienne mesure de capacité pour les grains et autres matières sèches et également pour les liquides.
Sa valeur – clairement définie à Paris – pouvait tout de même varier suivant les régions et la nature des marchandises à mesurer.
Muid de matière sèche
le muid de Paris valait 12 setiers de 12 boisseaux de 640 pouces cubes, soit 1,824 m³.
le muid d’avoine contenait un peu plus de 3,7 m³ ;
le muid de sel équivalait à un peu plus de 2,4 m³ ; en Lorraine, 0,52877 m³ ;
le muid de charbon de bois valait 4,1 m³.
Selon l'inventaire de 1155 à Cluny (dans le Mâconnais), un muid vaut 9 setiers
Notez que le muid correspondait aussi à la surface de terre que l'on peut semer avec un muid de grain.
Muid de liquide
A Paris, le muid de liquides était de 274 litres (8 pieds cubes). Il fut employé en France notamment pour les mesure de vin. En province, sa contenance variait de 270 à 700 litres. Le tonneau contenant un muid s'appelle futaille.
Obole
pièce de monnaie de cuivre qui valait la moitié d'un denier tournois.
Ost
service militaire de longue durée dû au tenant du fief par les habitants de la bastide ou d'autres villages de la juridiction.
Oublie
sorte de rente versée au seigneur, le plus souvent en nature.
Once
L'once est une ancienne unité de masse, encore utilisée dans certains pays, dont la valeur est comprise entre 24 et 33 grammes.
Pacage
Le mot pacage, du Bas-latin, pascuaticus venant de pascuum (pâturage) et du verbe pascere (paître), désigne originellement en français les herbages sauvages ou adéquatement préparés où le paysan va nourrir et engraisser les bestiaux et éventuellement la volaille.
Au moyen-âge et jusqu'au 17e, les lieux de pacage incluaient les friches, garrigues, landes et prés communaux ou d'autres lieux, forestiers faisant l'objet d'un Droit de pacage associé à la vaine pâture dans un droit, une coutume ou des tolérances plus ou moins formalisé selon les régions et les époques.
Pinte
Une pinte est une unité de mesure de volume pour des liquides. La pinte se subdivise en deux chopines.
Le Littré : Ancienne mesure pour le vin et les autres liquides. La pinte de Paris valait un peu moins que le litre, c'est-à-dire 0l,931.
En Normandie, la pinte mesure de Paris, du pot contenant deux pintes, de la chopine qui est la moitié de la pinte, et demi septier qui en est le quart, étalonné sur les matrices qui seront déposées aux greffes des hôtels des villes de Rouen, Caen et Alençon, Lett. pat. juill. 1680.
La Pinte, vaut entre 0,979 litre à 2,51 litres suivant les localités.
Pognère
La Pognère, subdivision du boisseau ou du quarton.
Pouce
Le pouce, est égal à 0,027 mètre. Il vaut 12 lignes.
Quart mesure pour le VIN
Le Quart, quarte (la), quartonne (la) vaut entre 19,50 et 30,50 litres suivant la localité.
Le Quart, équivaut à 0,25 pinte.
Quarton
Le Quarton, dans la région de Sarlat la Canéda a une capacité qui varie entre 20 et 40 litres comme le boisseau.
Quint
Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, le droit du quint est un impôt seigneurial sur la vente des fiefs nobles.
Il représente le cinquième du prix de vente, auquel s'ajoute très souvent le requint qui vaut le cinquième du quint.
Roquille
La Roquille, vaut 0,25 pinte.
Saumée
somme, charge, fardeau. Ce terme est devenu une unité de volume correspondant à une charge d'homme.
Sauveté
bourgade rurale fondée par les monastères ou les hommes d'église ; elle servait de refuge aux fugitifs et aux errants qui y bénéficiaient du droit d'asile. Sénéchal : grand subordonné du roi ayant autorité sur une région. Sol : terme provenant du mot latin solidus et utilisé pour désigner le sou. Surcot : tunique, en général sans manche, que l'on mettait par-dessus la cotte. Taille : impôt levé sur les roturiers et dû en contrepartie de la protection fournie par le seigneur. Levée en temps de guerre sous Philippe le Bel, la taille devint permanente durant la guerre de Cent Ans.
Setier
Ancienne mesure de grains de la contenance d'environ 156 litres.
Le setier de blé, mesure de Paris, vaut toujours chez nous environ vingt écus (VOLT. Lett. Florian, 25 févr. 1771)
Ancienne unité de capacité qui contenait 8 pintes de 48 pouces cubes chacune ; la même que la velte ; valant 7 litres, 61.
Demi-setier, ancienne mesure de capacité, quart de pinte.
Demi-setier, se dit à Paris d'un quart de litre.
Un setier de terre, autant de terre labourable qu'on peut ensemencer avec un setier de blé ; c'est ce qu'on nomme autrement setérée.
Sétérée
A une superficie comprise entre 23,74 et 260,54 ares.
Sole
Partie des terres arables d'une exploitation qui reçoit successivement chacune des cultures faisant partie de l'assolement ou rotation. Diviser une terre en trois soles. La sole de froment est plus forte cette année qu'à l'ordinaire.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles (Code civ. art. 1774)
Sou
Le sou est une ancienne monnaie française, issue du solidus romain et qui a survécu dans le langage à la décimalisation de 1795 pour désigner la pièce de 5 centimes jusqu'au début du XXe siècle. Il doit à cette longévité d'être encore présent dans de nombreuses expressions relatives à l'argent.
Face à une pénurie d'or, une nouvelle "stabilisation" (c'est ainsi que l'on appelle souvent les dévaluations) va venir de Charlemagne : le solidus ne sera désormais plus un soixante-douzième de livre romaine d'or mais un vingtième de livre carolingienne... d'argent. Il est lui-même divisé en 12 denarius, qui, sauf rares exceptions (le gros de Saint Louis), seront dans la pratique les seuls à circuler. Mais le système de compte (1 livre = 20 sous de 12 deniers) restera inchangé en France jusqu'à la Révolution.
Sous de Melgueil
Sous Ruthénois
Sous de Rodez
Deniers Ugonencs
Solidos Ugonencos octenos de Carcasona
Ugonencs - Unités monétaires utilisés dans plusieurs chartes du cartulaire de Douzens, et en particulier par les vicomtes de Carcassonne. On retrouve cette unité dans le cartulaire des Trencavel. Elle fut très concurrencée au début du XIIe siècle par le denier de Melgueil, qui l'emporte dans tous les actes des Trencavel et même dans tout le Languedoc. Cette monnaie de Melgueil est contrôlée par les comtes de Melgueil (puis de Toulouse à la fin du XIIe siècle), mais aussi des le début du XIIe siècle par les Guilhem de Montpellier [...]
Sources : Hélène Débax, La féodalité languedocienne XIe - XIIe siècles. Presses Universitaires du Mirail. 2003
Taille
Impôt en argent prélevé par le seigneur sur ses tenanciers (non fixe au départ, puis annuel). Rendue royale en 1440.
En 1287, à l'occasion du sacre du roi, un sculpteur de pierre paie pour la taille 106 sous.
En 1292, à Paris, 15200 contribuables paient la taille. En sont exemptés les nobles ou les ecclésiastiques, ou ceux qui bénéficient d'une excemption particulière.
Toise
La Toise, vaut 1.949 mètres.
Tonlieu
En droit féodal, le droit de tonlieu est un impôt prélevé pour l'étalage des marchandises sur les marchés. C'est aussi un péage sur les marchandises transportées prélévé lors du passage d'un fleuve (pont, bac) ou aux portes de certaines villes.
Tenure
terre concédée par un seigneur qui accordait au concessionnaire la jouissance des lieux mais en conservait la propriété.
Tournois
monnaie royale officialisée par Philippe Auguste ; une livre tournois valait vingt sous tournois.
Traversière
qualificatif donné à une rue secondaire transversale.
Vaine pâture
Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime la vaine pâture est un droit d'usage qui permet de faire paître gratuitement son bétail en dehors de ses terres, dans les bords des chemins, les friches, les terres nues de leurs cultures, les bois de haute futaie, les taillis de plus de 4 ou 5 ans. Le parcours est également un droit de vaine pâture que s'accordent réciproquement deux paroisses voisines.
A l'époque féodale, le propriétaire d'un terrain en perd l'usage après la moisson (ou la première coupe pour une prairie). Les chaumes, le regain appartiennent à la communauté et peuvent être utilisés librement par quiconque. Il en est de même pour les terres sur le sol en jachère.
Cette pratique a permis pendant longtemps aux plus pauvres de la communauté d'entretenir du bétail (une ou deux têtes maximum) même sans posséder de terre.
Verge
La verge est une unité de longueur dont la valeur à varié au cours de l'histoire. Bien que tombée en désuétude dans le reste de la francophonie, elle est encore fréquemment utilisée au Canada (1 verge = 0,9144 m = 1 yard).
Vilain
paysan libre (par opposition au serf).
Vinage
Impôt sur le vin récolté ou transporté.
1/8eme du vin pressé (le début est le meilleur).
Le seigneur touche 1/3 de toutes les vignes à presser.
Mesures pour l'Aube
Dans la plupart de ces communes, le mesurage des terres ci-devant seigneuriales est fait, depuis environ 30 ans, à la perche de 20 pieds ; et celui des particuliers, à l'ancienne perche de 8 pieds 4 pouces ; ce qui porte dans les déclarations l'arpent des premiers à 100 cordes de 20 pieds, et celui des seconds à 111 cordes, et le journal à 75 cordes pour les uns, et 83 et 1/2 pour les autres.
On évalue encore dans ce département les terres en mesure de terre, qui est le 6e de l'arpent, et mesure de chenevière, qui en est le 12e ; Boisseau 16e d'arpent pour les chenevières, ou 12e d'arpent pour les autres terres ; Journée, Ouvrée, Felte, et Homme, pour les vignes.
Mesures pour la Dordogne
Deux systèmes de subdivisions se partagent l'essentiel de la Dordogne :
Le boisseau qui est égal à 8 picotins,
Le boisseau qui est égal à 2 mandurières qui valent chacune 4 picotins. Parfois, la "Grande mesure" équivaut à 6 picotins au lieu de 8. Il arrive que pour une même localité, deux mesures cohabitent. Dans d'autre localité, la mesure est indiqué mais sa valeur exacte manque.
Barrique, du Périgord va de 220 à 245 litres suivant les localités.
Sac, usité dans la région de Bergerac. Il a une contenance de 92 litres.
Mesures Provencales
Mesure de longueur usitée autrefois dans le Midi ; elle se divisait en 8 pans et valait deux mètres. plus ou moins selon les pays.
Cano carado, mesure de surface équivalent a quatre mètres carrés. La cano carado se subdivisait en 64 pans.
La cargo ou charge de blé ou d'amandes valait en Provence trente-deux décalitres ou environ ; la charge de vin valait un hectolitre ; la charge d huile 24 décalitres ; la charge de bois 125 kilos et la charge de raisins à Aix valait 161 kilos. La charge de terre, mesure de superficie pour ensemencer une charge de blé, contenait 1600 cannes carrés, c'est-à-dire 63 ares environ et se divisait en 8 eimino. Aujourd'hui, la charge métrique de blé vaut à Marseille 160 litres.
La Carterée, Mesure de superficie valant deux mille mètres carrés. L'are étant 100 mètres carrés, 20 ares valent une carterée. On estime les demi guérets à 15 francs la carterée et les pleins guérets de 30 à 40 francs. Les guérets d'avril et mai doivent avoir 30 centimètres de profondeur. Les guérets pour le jardinage, étant profonds et bien façonnés, peuvent s'évaluer à 40 francs la carterée. La carterée en prairies produit environ 700 kilos à chaque coupe. La carterée en blé produit environ deux charges de blé.
Cosso Couosso à Nice ; couasso dans le Var. Petite mesure pour les grains et les surfaces ; c'est la vingtième ou douzième partie de l'eimino selon les pays, et la cent soixantième partie de la cargo. En certaines localités, c'est le quart de la panau ; à Villeneuve-lès-Avignon, c'est la huitième partie de l'eiminado.
Coupado, Mesure de superficie usitée dans le Tarn, seizième partie de la seisteirado.
Coupo, Mesure de capacité pour les liquides valant de 20 à 30 litres. Mesure de grain équivalent au douzième ou au seizième du setier ; en Limousin, douzième partie du boisseau ; en Gascogne, boisseau ; en Rouergue, quart de la sétérée.
Des (vieux), Borne limite d'un terrain, parce qu'on marquait les limites autrefois, comme on le fait encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, avec une croix de Saint André qui ressemble à un chiffre romain.
Destré, Perche servant à arpenter. Mesure agraire usitée autrefois dans le Midi ; le destré de Provence était la centième partie de l'eiminado et équivalait à huit mètres carrés, plus ou moins selon le pays ; le destré d'Alais et de Montpellier se subdivisait en dix pans et valait vingt centiares ; celui de Béziers valait quinze centiares soixante-dix-neux milliaires ; en Languedoc, on employait aussi le destré pour mesurer les bâtiments et, dans ce cas, c'était une corde de 2 mètres 50 cent.
Eiminado, Espace de terrain que l'on peut ensemencer avec une eimino de blé ; ancienne mesure agraire équivalent à huit ou dix ares selon le pays ; l'eiminado de Provence était la huitième partie de la saumado et contenait 100 destrés ou 200 cannes carrées ; l'eiminado du Dauphiné était la moitié de la seisteirado et l'eiminado du Roussillon valait soixante ares.
Eimino, L'eimino formait la moitié de seistier, le huitième de la saumado ou de la cargo et se divisait en 20 cossos, 8 monturen ou 8 poignadiero ou en 2 quarto.
Escandau, Mesure usitée pour l'huile et les liquides en général, ainsi que pour la chaux, c'est le quart de la miheirolo.
Journau, Mesure de superficie qui vaut près de vingt ares en Provence ; environ soixante ares à Aix ; vingt-neuf ares en Gascogne. Journau de vin, mesure de vigne, composée de 500 souches, dans le Tarn.
Liéuro, En Provence, Languedoc et Gascogne, la livre-poids se divisait autrefois en 16 onces et 128 gros. La livre d'Aix valait 379 gros 16 ; celle de Marseille, 388, 50 ; celle d'Arles 391,36 ; celle de Carpentras, 400 ; celle d'Avignon, 487,992 ; celle d'Alès, 415,89.
Miheirolo, Mesure de capacité pour les liquides, en usage en Provence. Elle contient 4 escandaus, ce qui équivaut à soixante-six litres.
Monturen, Mesure de capacité usitée à Nice : huitième partie de l'eimino, environ deux litres cinq décilitres.
Ounço, Seizième partie de la livre en Provence ; elle se divisait en 8 ternaux.
Pan, Longueur d'une main ouverte, mesure de 9 pouces usitée en Provence, Languedoc et Gascogne. Le pan était la huitième partie de la cano et il se divisait en 8 menuts. On l'emploie aujourd'hui pour le quart d'un mètre.
Panau, Ancienne mesure usitée en Provence pour les grains équivalent au double décalitre. La panau est la moitié du sestier et le dixième de la cargo. Elle se subdivise en 4 civadiers ou 8 quartiers. C'est aussi une mesure agraire qui comprend 10 poignardières ou 160 canes carrées et qui est la moitié de la seisteirado ou la dixième partie de la cargo. A Aix, la cargo d'avoine est de 12 panaux et la cargo d'amandes, de 16.
Pot, Mesure de vin qui contenait 2 pintes ou 4 feuillets à Aix. Le pouet équivaut au litre.
Pougnadiero, Petite mesure de grains contenant environ trente-deux décilitres, ainsi nommée parce qu'elle est munie d'une poignée qui sert à la manier d'un seule main. C'est le quart de la quartiero, le cinquième de la panau, le huitième de l'eimino et le vingt-quatrième du setier dauphinois.
Pougnerado, Espace que l'on ensemence avec une pougnero ou pougnadiero de grains. Petite mesure agraire usitée en Dauphiné, sixième partie de la quartelade, vingt-quatrième de la seisterado et équivalant à un are quarante-deux centiares.
Quarteiro, Petite mesure pour les grains dont 8 font la panau ou 6 doubles-décalitres. Le quarteiro de Béziers équivalait à 16 litres 40. Le quartiero se divise en 4 pougandieros.
Quarto, Mesure pour les grains et les amandes valant le quart du sestier et la moitié de l'eimino, le quart du boisseau dans la Drôme ; mesure agraire équivalant au Languedoc à environ cinq ares ; en Rouergue a neuf ares.
Quartounado, Terre que l'on ensemence avec un quartoun de blé. Mesure agraire, quatrième partie de la seisteirado. En Limousin, le quart de la quarteirado est de 2 boisseaux.
Quartoun, Mesure de blé usitée en Gascogne. Mesure de deux litres à Béziers. Le quartoun de Toulouse valait quatre setiers au XIVe siècle.
Ras, Selier, Mesure usitée pour les grains, amandes et noix. Elle se divise en 12 pougnadieros ou 2 panaux et vaut 2 double-décalitres. Un ras de civados, une mesure d'avoine.
Saumado, Mesure de capacité usitée en Provence et en Languedoc pour les grains, châtaignes, glands ; elle équivaut à 2 hectolitres, plus ou moins selon les pays, et se divise en quatre setiers ou huit eimino. En surface, elle équivaut à 8 eiminado.
Seisterado, Contenu d'un setier. Etendue de terrain que l'on peut ensemencer avec un setier de blé. Mesure agraire équivalente à vingt ares, plus ou moins selon les pays. La seisteirado de Nîmes se divisait en 100 destrés et celle de Montpellier en 75. La seisterado du Dauphiné. contenait 900 toises carrées, soit 34 ares environ ; la seisterado du Limousin 25 ares ; celle d'Albigeois contenait 32 boisseaux ; celle de Béziers 16 ares ; celle de Rodez, 2 hectares 1/2.
Sestier, Mesure de grains équivalente à 6 décalitres à Arles plus ou moins selon le pays ; il vaut, en général, 2 eimino et devient le quart de la cargo de la saumado. Le sestier de Limoges contenait 50 litres et celui de Loriol 80 litres. Le muid de vin de Montpellier contenait 18 sestiers et le sestier, 32 pots.
Ternau, Huitième partie d'une once qui se divise en 3 deniers.Autres
Pisé : maçonnerie faite avec de la terre argileuse et des cailloux.
Platea : terme utilisé à la place de localium ou d'ayral pour désigner l'emplacement d'une maison.
Poblan ou poblador : mot employé pour désigner les habitants des bastides.
Poterne : porte secrète des fortifications, donnant sur les côtés.
Pountet : petit pont couvert reliant deux habitations et enjambant une rue.
Regrattière : marchande de légumes ou épicière.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les graffiti de Domme

Les Tours de DommeQu'étaient donc au vrai les Templiers ?
Des Hérétiques ?
Cette extraordinaire collection de graffiti, que nous avons présentée dans Archéologia N° 32 (pages 24-37), est bien de nature à nous éclairer un peu sur ces énigmatiques Templiers.
Quels hommes étaient-ils ?
Méritaient-ils vraiment les accusations dont ils furent l'objet ?
Il semble que ces graffiti nous fassent entrer de plain-pied dans leur intimité, et nous permettent de les mieux connaître. Les inquisiteurs du procès nous assurent que les Templiers avaient des rites de réception étranges. Le crucifix y était bafoué, foulé aux pieds, couvert de crachats, le crucifié n'étant pas le Fils de Dieu mort pour les hommes, mais un homme comme les autres et lui-même un criminel.
Or, que voyons-nous à Domme ?
Ces archives secrètes, restées secrètes depuis 650 ans nous révèlent tout à coup, chez les Templiers un ardent amour du Crucifix. Ces hommes le mettent partout en honneur dans leur cachot. Croix, crucifix, scènes de Crucifixion, y abondent et forment comme le fonds même de la méditation des prisonniers. S'ils ont amoureusement gravé ou sculpté ces images, c'est afin de mieux prier devant elles.Ils ne marchandent pas au crucifié les honneurs divins. Ils ne chargent pas son front de la couronne d'épines, mais de la couronne glorieuse. C'est la couronne royale, ou le nimbe rayonnant, ou le nimbe crucifère traditionnellement réservé au seul Christ. La croix elle-même est entourée d'honneurs et de ses bras s'échappent des rayons glorieux.
Est-ce le fait d'hommes qui, en un jour solennel, auraient craché sur cette même croix, sur ce même crucifix ?
Graffiti des tours de Domme
Les inquisiteurs accusaient les Templiers prêtres d'omettre, à la messe, les paroles de la consécration, ce qui équivalait à nier la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il suffit semble-t-il, de regarder ce grand panneau où le Christ présente le Pain et le Vin et de lire au-dessous cet admirable acte de foi. Ma nourriture c'est Dieu, Dieu est ma nourriture. Il l'a dit en vérité. J'y crois. Et plus bas sur le banc du guetteur, cette même tendre allusion à l'Eucharistie : Ô Dieu est ma nourriture. Plus loin cette belle hostie au pied d'un crucifix, ou encore le Graal, le vase du Précieux Sang que recueille ailleurs Joseph d'Arimathie.
Est-ce là le fait de contempteurs de l'Eucharistie ?
Les inquisiteurs accusaient les Templiers, lors de leur réception dans 'l'Ordre, de renier non seulement le Crucifix, mais aussi la Vierge et les Saints. Or que nous montrent ces murs ?
Des Vierges sculptées assez maladroitement sans doute, par des sculpteurs improvisés, n'ayant probablement qu'un clou en guise de ciseau et qu'un caillou en guise de maillet. Mais ces pauvres sculptures n'en sont-elles pas plus touchantes dans 'leur encadrement précieux ?
Et peut-on ne pas être ému de cette discrète supplication : Mère de Dieu, priez pour nous. Et ne trouvons nous pas Saint Michel et Saint Jean les saints patrons de l'Ordre, et les anges dans le Paradis ?
Tout cela n'a pas été fait pour les besoins de la cause ; tout cela est trop vrai et ne peut pas tromper. Les murs nous racontent la vie spirituelle d'hommes qui étaient incontestablement des amants de la Croix et de l'Eucharistie et des serviteurs dévots de la Vierge et des Saints.Des hérétiques
Graffiti de DommeOn les accusait aussi d'hérésie. Accusation capitale et redoutable. Mais on n'a jamais bien précisé de quelle hérésie il s'agissait. On a prononcé les mots de monophysisme, de manichéisme, de gnosticisme, d'infiltrations cathares, d'ésotérisme enfin. Tout cela fait penser au proverbe connu : "Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage". En fait, on n'a jamais rien prouvé ni trouvé de tel. Et vraiment tout ici ne respire-t-il pas la foi la plus orthodoxe, la piété la plus simple et même la plus tendre chez ces religieux qui n'en étaient pas moins des soldats ?
Ce qu'ils adorent, ce qu'ils vénèrent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils prient, c'est ce que l'Eglise a toujours adoré, vénéré, aimé, prié et tout ce qu'aujourd'hui nous continuons à adorer, à vénérer, à aimer, à prier. Pas la moindre déviation dans leur foi ou leur piété. D'elles on peut dire "Sicut erat in principio" : Telles qu'au commencement, telles maintenant, telles toujours.
Je sais bien que certains voudront malgré tout trouver des failles dans cette foi et cette piété. Je pense à ceux qui veulent trouver de l'ésotérisme partout et à tout prix, à coup de rapprochement fallacieux, de comparaisons forcées, reliées par de multiples "peut-être", l'ensemble formant un échafaudage branlant au sommet duquel on installe un = donc a des plus catégoriques, mais qui fait songer au sorite des sophistes. Ceux-là ne se feront sans doute pas faute de trouver dans cet ensemble de graffiti, tel ou tel détail qui sera suspect à leurs yeux. Ils relèveront par exemple avec satisfaction la présence du Graal et octogonal par surcroît.Le Graal, nous assurent-ils, aurait été indubitablement pour certains du moins, un symbole alchimiste. "Donc" n'hésitent-ils pas à conclure ; les Templiers pratiquaient l'alchimie. Ce "donc" est bien de ceux qui défient la logique en paraissant s'y soumettre. Qu'on nous permette une comparaison. Disons par exemple "Les cartes à jouer servent pour prédire l'avenir ; or les joueurs de belote utilisent les cartes à jouer ; donc ils cherchent à prédire l'avenir". La fausseté du raisonnement saute aux yeux.La vérité beaucoup plus simple est que la "queste du Graal" n'était à travers toutes les péripéties du roman d'aventures – nous dirions aujourd'hui "de cape et d'épée" – y compris celles de "l'amour courtois", que les manifestations du culte que les chevaliers d'alors vouaient au Précieux Sang, et qu'il n'y a aucune raison de croire que les Templiers y avaient vu autre chose, et se soient préoccupés de rêveries métaphysiques.Alchimistes ?
Graffiti de DommeCette légende du Graal, M. Ollivier la rappelle opportunément, trouve son origine dans le partage du butin après la prise de Césarée, donc près d'un siècle avant que Chrétien de Troyes ne s'en empare et ne l'exploite. C'était, assurait-on, le vase de la Cène, le même qui servit à Joseph d'Arimathie pour recueillir le sang du Christ sur la croix. Si, plus tard, au début du XIIIe siècle Eschenbach en fit une pierre mystérieuse (philosophale) donnant à son possesseur vigueur et jeunesse, on voit en effet la légende verser dans l'alchimie. Mais cette alchimie elle-même, n'était-elle pas qu'un symbole ?
Cette pierre n'était-elle pas simplement un "caillot" du sang du Christ ?
Et n'est-ce pas précisément le corps et le sang du Christ qui peuvent rendre à l'homme vigueur et jeunesse ?
Si les Templiers "dans les heures de délassement avec de belles paroles et courtoisies" que leur accordait la Règle, (ce qui ne pouvait être que la lecture des romans de chevalerie) avaient lu Eschenbach, ils ne l'ont certainement pas compris autrement, eux qui écrivent en clair, non loin de l'image du Graal, "ma nourriture c'est Dieu". Pour eux, le Graal n'est autre que le vase du sang du Christ, que recueille pieusement Joseph d'Arimathie.Les figures symboliques
Graffiti de DommeMais d'autres figures aussi alerteront peut-être nos hermétistes. Dans le grand tableau de l'Eucharistie on trouve, avec le Soleil et la Lune, trois étoiles. Quoi de plus naturel ?
Mais il se trouve qu'une de ces trois étoiles a 8 rais ?
Voilà bien une preuve d'ésotérisme dira-t-on car l'étoile à 8 rais, c'est l'étoile parfaite, la figure dé la pierre philosophale, l'étoile hermétique, celle qui donne la clé du déchiffrement de la grille cryptographique... Mais si nos étoiles avaient la forme héraldique à 5 pointes, on nous dirait alors qu'il s'agit du "sceau de Salomon, et on prétendrait en tirer d'autres conséquences. De toute façon, nous voilà au rouet !" D'autant que, à bien y regarder, une seule des étoiles a 8 rais ; les deux autres en ont 9. Alors que conclure ?
Tout simplement qu'il faut bien qu'une étoile ait des rais ou des pointes, sinon, ce ne serait pas une étoile. Or, il faut les prendre dans leur contexte, elles sont ici les compagnes du Soleil et de la Lune, donc simplement des étoiles. Vouloir y trouver à tout prix autre chose nous paraît absolument arbitraire. Par contre, c'est le contexte qui nous fera reconnaître et admettre sans difficulté que l'étoile à 8 rais nous semble bien être chargée d'un sens symbolique.Nous admettrons de même que, si certaines des mains que nous trouvons peuvent n'avoir été qu'un passe-temps de soldats, d'autres comme celle qui figure dans la même archère, près de l'épée et de l'étoile, ou cette autre que l'on voit, (comme annulée du reste par deux traits en croix) à côté de la Bête-Clément V, sont visiblement symboliques. Symbolique aussi peut-être, le petit quadrillé qu'on relève dans cette même figure. Nous serions moins affirmatifs en ce qui concerne la marelle trouvée sur le banc d'une archère.Tant de soldats dans les corps de garde, et même des petits clergeons dans les églises, ont gravé ce dessin populaire, qu'on est en droit d'hésiter ici sur son origine templière. Reconnaissons encore comme figures symboliques l'enceinte renfermant une croix, et ailleurs avant l'épée, la double enceinte renfermant également une croix. Qu'en conclure ?
Simplement que les Templiers ont usé, comme beaucoup d'autres (... I) de graphismes symboliques et d'un langage de convention. C'est là un procédé qui relève parfois de l'amusement ou de la fantaisie, parfois aussi d'une nécessaire prudence. Mais de toute façon, il ne faut pas perdre de vue que symbolisme et langage secret ne sont nullement synonymes d'ésotérisme, c'est-à-dire d'une initiation à quelque doctrine cachée et d'un langage hermétique ; mais on peut pour telle ou telle raison employer un langage hermétique sans être pour cela le moins du monde ésotérique.N'est-ce pas le cas de bon nombre de prisonniers. Ici encore, il faut se remettre dans le contexte, et se demander, si une telle initiation peut être compatible avec la foi authentique et vibrante dont ces murs témoins étalent les preuves sous nos yeux. En définitive, les graffiti de Domme nous montrent dans les Templiers "de bons catholiques" comme ils prétendent l'être, comme ils le disent au Pape, comme ils entendent le rester. De bons catholiques, à la foi très sûre, sans la moindre déviation, à la piété solide et tendre de leur Ordre. Ce n'est pas tout à fait l'image qu'a voulu nous en laisser l'Histoire.Ni meilleurs... Ni pires...
Graffiti de DommeSoit, diront certains. Mais rien ne prouve que tous les Templiers aient ressemblé à ceux de Domme, qu'ils aient eu même orthodoxie, même piété, même surnaturel, même vertu... Domme n'est-il pas un cas exceptionnel, d'après lequel il serait imprudent de juger les Templiers en général ?
A notre tour, nous demanderons qui peut nous autoriser à voir dans le groupe des prisonniers de Domme une sélection de sujets supérieurs à la moyenne, plus réguliers ou plus fervents ?
En fait nous ne pouvons juger des Templiers que par ceux que nous connaissons. Or, nous connaissons ceux de Domme. N'est-on pas en droit d'en dire avec le poète : "Ni meilleurs que les uns, ni pires que les autres". Car, arrêtés tous ensemble dans la même rafle, il n'y a pas de raison de penser qu'on ait fait un choix quelconque entre eux. Et d'après quelles normes l'eût-on fait ?
Nous constatons au contraire que les prisonniers de Domme y sont restés au moins jusqu'en 1318, autant dire vraisemblablement jusqu'à leur mort. C'était donc, non pas des inculpés en prison préventive, mais des condamnés, des condamnés à la prison perpétuelle, ayant donc fait des aveux.On sait ce que valaient ces aveux faits sous la torture 1 N'importe ; ils avaient avoué. Ils se situaient donc dans le cas le plus commun des Templiers et peuvent être considérés comme bien représentatifs de la mentalité moyenne de leurs frères en religion. Mais par bonheur, nous connaissons assez bien un autre groupe de prisonniers, par la belle prière qu'ils composèrent dans leur prison de Sainte-Geneviève à Paris. Nous avons donc là un point de comparaison.C'est d'abord au Christ Crucifié que s'adresse cette prière "Ceux que par ta Passion et ton humilité tu enchaînes au bois de la Croix, les rachetant par ta miséricorde, conserve-les, conserve-nous"... C'est ensuite à la Vierge "en l'honneur de qui ton Ordre l'Ordre du Temple a été fondé" .... C'est à Saint Jean lui aussi protecteur du Temple, lui "que le Christ tant aima"... et dans leur prière, ils prennent Dieu à témoin de l'innocence de l'Ordre "en dépit des calomnies, vous le savez bien qui nous sont jetées à la face... Tu nous sais innocents des crimes qu'on nous impute"...A Paris, comme à Domme
Graffiti de DommeRegardons maintenant les murs des Tours de Domme. C'est le même Crucifié, la même Vierge, le même Saint Jean que nous y retrouvons et la même affirmation d'innocence qui se manifeste dans l'indignation contre Clément V. On dirait que les graffiti à Domme ont été calqués sur la prière des prisonniers de Paris. Ils en sont, si l'on préfère, l'illustration en images. La foi et la piété des uns et des autres vibraient à l'unisson, parlaient le même langage, rendaient le même accent. Ce n'est certainement pas par hasard.Il faut y voir le résultat d'une même formation religieuse, qui a laissé sur tous, à Paris comme à Domme, la même empreinte. Nous sommes donc en droit de penser semble-t-il, que tels étaient les Templiers de Domme et de Paris, tels étaient ceux d'ailleurs et de partout.
Par contre, nous accordons volontiers que sur les quelque trois mille Templiers que l'on comptait en France, avec autant de sergents et autant de- suivants, il ait bien pu se trouver quelques brebis galeuses. Le contraire serait même surprenant. Précisément nous savons que le Grand Maître y veillait avec sévérité, et que c'est cette juste sévérité à l'égard de quelques coupables qui attira sur l'Ordre les dénonciations venimeuses dictées par la rancune, et que Philippe le Bel ne fut que trop heureux d'exploiter.Cela même, prouve que l'Ordre faisait sa propre police et tenait à son intégrité morale. Les indignes ne devaient vraiment pas être très nombreux. Ce sont eux qui étaient l'exception. De toute façon, on le voit, ce n'est pas en Périgord qu'il fallait venir les chercher.Un étrange procès
Graffiti de DommeNous sommes bien loin des soudards débauchés et sans foi ni loi que certaine Histoire a voulu nous montrer. Il y a de quoi rester rêveur, et on est amené à se demander – une fois de plus – comment on a pu traîner de tels hommes devant l'Inquisition par le moyen de quelle machination un tel procès a pu être monté. J'avoue ne pas être de ceux-ci croient à la pureté des motifs qui ont guidé Philippe le Bel, ce prince pieux, nous dit-on, qui n'aurait agi que pour la défense de la foi. C'est oublier trop facilement Anagni et l'excommunication dont le roi fut alors frappé. Il remplissait ses devoirs de chrétien ?
Cela ne prouve pas grand-chose, et il lui aurait été d'ailleurs bien difficile, sinon impossible, à cette époque de faire autrement. Les belles formules et déclarations d'intention ne sont que littérature. Et si le roi avait eu vraiment en vue la défense de l'Eglise, c'est au Pape qu'il devait en laisser le soin.En fait, profondément imbu des principes laïcs et régaliens, comme ses familiers, les Flotte, les Dubois, les Marigny, les du Plessis et l'excommunié Nogaret, il était déjà l'archétype de ce que nous appellerions aujourd'hui le catholique anticlérical. Il voulait que le Pape fût à sa main et marchât à son fouet. Et il pouvait disposer maintenant, après Boniface VIII et Benoît XI d'un pape français. Gageons que le procès des Templiers n'eût pas eu lieu si Boniface VIII ou Benoît XI eussent vécu.
Gageons aussi que ce procès n'eût pas eu lieu si Molay, moins jaloux de l'indépendance du Temple avait accepté la fusion de son Ordre avec celui de l'Hôpital. Gageons qu'il n'eut pas eu lieu non plus si Molay, plus souple et moins jaloux de l'indépendance du Temple avait accepté d'en abdiquer la grande Maîtrise en faveur d'un des fils du roi.Nul doute qu'alors le Temple n'eût été paré de toutes les vertus !
En outre, aux yeux de Philippe le Bel, le Temple avait deux grands torts. En un jour d'émeute contre le roi faux monnayeur. le Temple où il s'était réfugié l'avait efficacement protégé, ce en quoi il avait montré sa force : et il avait ensuite renfloué le trésor royal : ce en quoi il avait laissé paraître sa richesse.C'étaient là deux grosses imprudences. C'étaient là aussi de ces services qui en politique ne se pardonnent pas.Turpitude et hérésie
Graffiti de DommeOr, il était bien difficile de faire au Temple un procès politique : il avait précisément rendu trop de services au roi. Mais il y avait mieux. Pour abattre un adversaire gênant, en ces temps-là, rien ne valait un beau procès religieux. Sur ce terrain la partie était gagnée d'avance. On fit donc un procès religieux. Devant une accusation de turpitude et surtout d'hérésie, tout accusé était perdu.Le code de jurisprudence ecclésiastique Impitoyablement retors, se chargeait par la torture, d'arracher à l'accusé tous les aveux qu'on voulait, "même d'avoir tué Dieu" ! disait un Templier avec une noire ironie. C'était alors, pour le moins, la prison perpétuelle. Mais si, par malheur, l'accusé, se retrouvant lui-même avait l'audace de revenir sur ses aveux, il était alors déclaré récidif relaps comme on disait, et c'était automatiquement le bûcher. Ce fut le cas de Molay et de 'bien d'autres. Cent quinze ans plus tard, Jeanne d'Arc subira le même sort après une procédure identique.
Juridiquement parlant, le procès des Templiers fut donc, si l'on peut dire, conduit de la façon la plus correcte. On peut aujourd'hui s'en indigner. Mais en ce temps-là, nul ne pouvait s'en étonner.Comme des agneaux à l'abattoir
Graffiti de DommePar contre, ce qui est sujet d'étonnement, dans cette triste histoire, c'est le silence des Templiers. Il fait songer à cette toute petite phrase de l'Evangile : "Et Jésus se taisait", "au grand étonnement de Pilate" du reste, ajoute le narrateur sacré. Pour nous aussi, le silence des Templiers semblait surprenant. Disons plus, il nous scandalisait un peu, comme s'il contenait un demi-aveu, un aveu honteux. C'est une impression que j'ai ressentie pour ma part, longtemps, jusqu'au jour où, à Domme, les Templiers m'ont parlé. Oui ils se sont tus. Mais nos graffiti vont nous faire comprendre pourquoi.
Dès le début de l'affaire, on voit que les Templiers ne cherchèrent pas à se dérober. Molay lui-même souhaitait une enquête qui lavât le Temple des calomnies répandues sur son compte. Rien n'eût été plus facile, pour lui, alors qu'il était pratiquement averti de ce qui se tramait, que de prendre le large.Bien au contraire, la veille même de l'arrestation, il accompagnait protocolairement le roi à l'église des Jacobins, pour les obsèques de Catherine de Courtenay, belle-sueur du roi, femme de son frère cadet, Charles, Comte de Valois. Mais Molay ne pouvait se douter de la tournure que prendrait "l'enquête".
De même il est hors de doute que les Templiers, s'ils l'avaient voulu, étaient de taille à résister. Mais il eût fallu tirer l'épée. Or, un Templier ne tirait jamais l'épée contre un chrétien : ainsi le voulait la Règle. Une autre règle qui n'était pas celle du Temple, mais qui régissait toute la chevalerie, s'énonçait dans le quatrain connu :
A Dieu mon âme.
Mon corps au roi.
Mon coeur à ma Dame.
Mon honneur à moi.
Leur corps était au roi. Cela ne se discutait pas. Et puis, essayons un peu, pour comprendre, de nous mettre au moins un peu à la place de ces prisonniers. Ils avaient tellement conscience de leur innocence, qu'ils ne ressentaient aucune crainte ; l'action intentée contre eux dut leur paraître comme le résultat dune invraisemblable méprise, qui serait vite éclaircie ou le fait d'une méchanceté -qui ne pourrait que tourner à la confusion de ses auteurs. On pourrait dire que la grande faute des Templiers ("une faute plus grave qu'un crime", aurait .dit Talleyrand), ce fut de croire qu'il suffisait d'être innocent pour n'avoir rien à craindre de la Justice.On se chargera vite de les détromper. Le Souverain Pontife leur fit du reste parvenir immédiatement (dans les trois jours), les meilleures assurances d'une heureuse solution de cette affaire, leur demandant de ne pas se décourager, de ne même pas songer à s'enfuir. Malgré cela le temps passait, les interrogatoires, et quels interrogatoires !, commençaient. Ce ne fut donc que peu à peu, après le premier moment de stupeur passé, que la réalité se fit jour et que les prisonniers comprirent que "c'était sérieux".La voie du Calvaire
Graffiti de DommeAlors ces hommes pieux se résignèrent, considérant leur pénible situation comme une épreuve. Habitués à tourner toujours leurs regards vers Jérusalem dont ils avaient la nostalgie, ils orientèrent tout naturellement leur méditation vers le Calvaire. Le Maître les appelait à le gravir avec lui. Ils ne se dérobèrent pas à son appel. C'est cela que nous disent les croix, les crucifix, ces crucifixions, ces groupes des trois croix du Golgotha, que l'on rencontre partout et jusqu'à cette évocation du Vendredi Saint qui nous a paru tout d'abord énigmatique. Ces hommes rudes et fiers, mais profondément modelés par l'ascèse du Temple, se jettent à plein coeur dans la voie du sacrifice, la vole du Calvaire, l'amour de la Croix.Voilà ce que nous font comprendre toutes ces images ; et cela seul peut les expliquer. Ici encore, comme s'ils s'étaient donné le mot, ils traduisent en images les pensées et la prière de leurs frères prisonniers comme eux à Sainte-Geneviève : "Ô notre Rédempteur et Défenseur, ceux que par ta Passion et ton Humilité tu enchaînes au bois de la croix, les rachetant par Ta miséricorde, conserve-les, conserve-nous"..Maintenant, nous comprenons leur état d'esprit, leur état d'âme. Ces murs nous le disent avec toutes ces croix, tous ces crucifix qu'ils gravent patiemment, qu'ils gravent encore partout où il y a un peu de place, les prisonniers, un peu plus chaque jour, se laissent enchaîner par le Maître au bois de la Croix.
Et comme le Maître devant Pilate et sur la Croix, ils se taisent. Le silence est une forme de l'obéissance. "Paratus in on nibus obedire", dit encore la Règle. Ils obéissent en se taisant. Ils se laissent mener "comme moutons à l'abattoir" selon l'expression de l'un d'eux, comme le Maître, toujours, "sicut ovis ad occisionem dentus est" (Is LIII 7 Act VIII, 32) c'est-à-dire sans se plaindre. Ils se laissent bafouer, torturer moralement et physiquement, subissant tout dans l'intention d'obéir à l'insondable Volonté Divine.Il est bien remarquable que pas un seul d'entre eux n'exhale une plainte personnelle. Une prière seulement, déchirante du reste ; Mère de Dieu, priez pour moi. C'est devant ces murs couverts de ces innombrables crucifix que j'ai compris le silence des Templiers.Une sainte colère
Graffiti de DommeMais le jour où, ne s'en prenant plus seulement aux personnes, on en vient à s'en prendre directement à l'Ordre, alors tout change. Ces hommes énergiques qui avaient su jusque là mater leur colère, tant que ne furent en cause que leur honneur personnel et leur vie, s'estiment déliés de toute contrainte le jour où l'on touche à l'honneur et à la vie de l'Ordre. Devant l'abolition de ce dernier par Clément V, ces hommes jusque-là muets et dociles, se déchaînent tout à coup. Les moutons deviennent enragés. Car c'est là pour eux le scandale des scandales, l'"abomination de la désolation dans 'le temple" prédite par le prophète Daniel (IX, 27).
Toucher à l'Ordre !
A l'Ordre de Notre-Dame !
A l'Ordre de Saint Bernard !
A l'Ordre, gloire et piller de la Chrétienté !
A l'Ordre, leur seule raison de vivre et leur seule fierté !
Leur retirer "le Manteau" dans lequel ils n'auraient même plus la consolation d'être ensevelis un jour ! Ce fut alors un concert d'indignations, de colère, de rage et de désespoir. Jusque là ils avaient comprimé leur coeur. Maintenant que l'Ordre est aboli, maintenant qu'ils se trouvent par là même déliés de tous leurs voeux et de l'Obéissance et du Silence, maintenant que la liberté de maudire, faute d'autre, leur est rendue, alors ils ne se font point faute d'en user pour maudire les persécuteurs de l'Ordre.Les poings se crispent devant l'atroce caricature de Clément V tandis qu'une violente clameur d'imprécations éclate sous les voûtes de cette prison :
"Quis tantus plagor ad auras ?"
Quelle immense clameur monte donc vers les cieux ?
Mais cette clameur ne monte pas plus haut que les voûtes, ne va pas plus loin que les murs. Ceux-ci du moins l'enregistrent et comme une bande sonore nous la restituent fidèlement aujourd'hui.Le Pape et le Roi
Graffiti de DommeOn peut penser que c'est en 1312 que s'y inscrivent la caricature de Clément V et l'hydre à deux têtes de Clément V et de Philippe le Bel, quand fut communiquée aux prisonniers la Bulle d'abolition de l'Ordre ; peut-être aussi en 1314 lors de la mort de Clément V, un mois après le supplice de Jacques de Molay. La mort de la Bête, sous les coups de Saint Michel, Patron de l'Ordre, aurait alors un accent de revanche.Les prisonniers, comprenons-le, traversèrent un terrible drame de conscience, qui ne paraît pas avoir pour autant entamé leur foi le moins du monde. Mais ils pensèrent que pour avoir perpétré un tel crime, Clément V, le destructeur du Temple ne pouvait être que le suppôt de Satan, la "Bête" de l'Apocalypse, pis encore, l'Antéchrist en personne. Nous ne savons comment put se passer dans l'autre monde, la rencontre de Clément V et de Philippe le Bel, avec Jacques de Molay et ses Templiers.Ce dût être houleux et nécessiter la mise en place d'un service d'ordre important de légions d'anges. Nous ne savons bien sûr quelle put être la sentence divine. Mais si les clameurs des Templiers du Ciel répondirent à celles que faisaient monter leurs frères encore prisonniers sur terre, ce dut être, en dépit de la majesté du protocole céleste, un beau tapage en Paradis !
Il est bon, il est salubre, d'entendre enfin les Templiers clamer leur révolte et leur dégoût, exhaler leur rancoeur, clouer au pilori et Clément V et Philippe le Bel. Ils ne s'avouaient donc pas coupables, et criaient vengeance au Ciel ! Cette colère soulage et fait du 'bien, même si elle est injuste. Il faut leur pardonner cet excès de colère. L'amour de l'Ordre seul a pu les y pousser. Leur confiance dans l'Ordre restait intacte.C'est là surtout ce. qu'il faut retenir de leur attitude. S'ils eussent eu le moindre doute sur la pureté de l'Ordre, ils eussent simplement courbé la tête, et pleuré. D'ailleurs, dans l'obscurité de leur prison, pouvaient-ils se faire une idée des difficultés à peu près inextricables dans lesquelles se débattait Clément V peu à peu emprisonné dans les rets de Philippe le Bel, qui ayant pris l'initiative d'une affaire qui n'aurait du relever que dû Pape, et !ayant menée à sa manière, forçait maintenant la main au Pape, et le mettait dans une situation difficile devant le monde chrétien. Le problème était complexe dont les Templiers étaient l'enjeu.A-t-on réfléchi aux conséquences qu'aurait entraînées l'acquittement des Templiers ?
N'eût-ce pas été par le fait même la condamnation du Roi et aux yeux du monde entier l'étalage de sa honte. Les bûchers de ses victimes eussent réclamé vengeance. Comment, sous ce coup Philippe le Bel eût-il réagi ?
On s'en doute. C'était alors l'excommunication, l'interdit sur le royaume, les consciences troublées, la Papauté prisonnière en France, les pires extrémités peut-être. Un Boniface VIII eût fait front.Clément V plia. Mais il plia "en gascon" comme eût dit le Cardinal Mathieu Rosso des Orsini. Pour ce qui lui parut l'intérêt général, il abolit l'Ordre, mais d'autorité, sans jugement, donc sans condamnation. En cela, il pensait éviter le pire, sans accorder au Roi la condamnation que ce dernier croyait tenir.Ce fut certainement très politique. Mais les prisonniers de Domme pouvaient-ils comprendre tant de subtilités ?
Ils ne pouvaient voir qu'une chose, c'est qu'ils étaient que l'Ordre était injustement sacrifié. On pouvait bien dire que l'Ordre n'était pas condamné. On pouvait répondre qu'il n'était pas acquitté non plus et qu'il restait sous le coup des plus infamantes accusations.Le Destructeur
Graffiti de DommeLes Templiers virent en Clément V l'Antéchrist. Dante, ce grand pamphlétaire, à la même époque, s'était contenté de lui assigner une place dans l'enfer des simoniaques. "Viendra du couchant un Pasteur sans loi... auquel sera flexible le roi qui régit la France".
Il faisait allusion à la légende, d'après laquelle Bertrand de Goth aurait accepté certaines conditions pour prix de l'appui du roi dans l'élection du nouveau pape. Ce pacte simoniaque aurait été conclu sans témoin alors, qu'en sait-on ?
Dans une forêt des environs de Saint-Jean d'Angely. Il s'agirait du Prieuré de la Fayolle, en plein milieu de la forêt d'Essouvert. Cette légende, déjà très suspecte et pleine d'invraisemblances, s'est trouvée démentie lorsqu'on découvrit le carnet de route de Bertrand de Goth. Le futur pape ne se trouvait pas en Saintonge à la date indiquée, mais à Lusignan en Poitou, et ne vint point à Saint-Jean d'Angely. Les historiens ne se sont pas fait faute de colporter cette légende qui courait déjà du vivant de Clément V.Il est possible que les Templiers en aient eu vent. Clément V, somme toute, était au moins fortement soupçonné de complaisance excessive envers Philippe le Bel, et son prestige était bien entamé. Les Templiers qui avaient cru en ses assurances de sollicitude au début de l'affaire avaient perdu confiance en lui.Quand vint brusquement l'abolition de l'Ordre, leur désaffection devint de la haine et Clément V, pour eux, ne fut plus que l'Antéchrist.
Quel fut le sort final des Templiers à Domme ?
Il est probable qu'ils moururent sans bruit, l'un après l'autre dans leur prison. La dernière date que nous avons relevée est celle de 1320. Et lis n'étaient sans doute pas tout jeunes lors de leur arrestation en 1307.Et l'on vieillit vite en prison... Ils s'en allèrent, priant de toute leur âme le Christ et la bonne Vierge, et Saint Jean et Saint Michel... et emportant dans la tombe une fidélité farouche à l'Ordre du Temple et une haine non moins solide à l'égard de celui qui en était le "Destructeur".Une bouteille à la mer...
Graffiti de DommeLorsque la Providence qui aide parfois les chercheurs, me fit tomber entre les mains cet extraordinaire trésor de graffiti, au fur et à mesure que j'en comprenais mieux le sens, que je découvrais plus clairement le drame,. qui s'était joué dans cette prison, j'ai été, je l'avoue, profondément ému, tout comme je le fus, il y a une dizaine d'années, devant des cris d'angoisse et de fidélité, d'autres prisonniers, des Protestants détenus dans la vieille forge de Brouage. Mais je compris aussi qu'il y avait là plus qu'un souvenir, si émouvant, si pathétique fût-il, mais un document, un document pris sur le vif, nous donnant un reflet exact de l'âme des Templiers et nous faisant mieux comprendre leur comportement, que tous les grimoires tendancieux, que les interrogatoires fallacieux, que les aveux dictés sous la torture.Ce document est un témoignage à décharge à verser comme "un fait nouveau" au dossier de ce malheureux procès. J'ai compris enfin, que ce document était aussi un message, un message vieux de 650 ans. Dans ces tours aux voûtes effondrées et béantes, les murs intacts ont conservé ce message et nous le restituent aujourd'hui. Ils ont enregistré au jour le jour, comme en une suite d'instantanés, la pensée, la vie, la longue résignation et la révolte enfin de malheureux sûrs de leur innocence et qui attendaient là l'accomplissement de leur destin. C'est tout cela qui resurgit devant nous comme après une longue hibernation.Tels des naufragés en perdition lancent une bouteille à la mer, à tout hasard, sans savoir ni où ni quand elle abordera, ni par qui elle sera récupérée, si, même elle doit l'être jamais, ainsi ces prisonniers qui savaient ne jamais revoir la lumière libre, ont confié leur message aux murs de leur prison, seuls témoins de leur Calvaire et de leur agonie.Des croix partout répétées... C'est le message d'hommes d'une foi robuste et pure, d'un surnaturel remarquable, qui n'a pu résister cependant à l'iniquité venant précisément de celui en qui reposait leur confiance et leur espoir, d'hommes qui avaient accepté d'être frappés par les Puissances de la Terre, mais qui n'ont pu comprendre, dans la simplicité de leur logique, que le coup pût leur être porté par le représentant du Christ, du Maître qu'ils servaient. Révoltés alors, ils en ont appelé du Pape à Dieu. Pareil drame s'est répété depuis dans l'Histoire.Ce message dont je devenais le dépositaire, pouvais-je l'enfouir à nouveau dans les oubliettes du Passé ?
C'est le message d'hommes d'une foi robuste et pure, d'un surnaturel remarquable, qui n'a pu résister cependant à l'iniquité venant précisément de celui en qui reposait leur confiance et leur espoir, d'hommes qui avaient accepté d'être frappés par les Puissances de la Terre, mais qui n'ont pu comprendre, dans la simplicité de leur logique, que le coup pût leur être porté par le représentant du Christ, du Maître qu'ils servaient. Révoltés alors, ils en ont appelé du Pape à Dieu. Pareil drame s'est répété depuis dans l'Histoire.Ce message dont je devenais le dépositaire, pouvais-je l'enfouir à nouveau dans les oubliettes du Passé ?
Pouvais-je mettre cette lumière sous le boisseau ?
Pouvais-je refuser de verser ces documents aux archives de l'Histoire ?
Les Templiers de là-haut me l'eussent-ils jamais pardonné ?
Je pense que nul désormais, ne devrait se sentir le droit d'écrire sur les Templiers sans avoir fait, auparavant, le pèlerinage de Domme.
Sources : Par le Chanoine P. M. Tonnellier
Toutes les images sont de Jack Bocar
Texte de la revue N° 33 et 38 d'Archéologia votre commentaire
votre commentaire
-

Résistance - La Voix de Paris, 8 mai 1945
L'armistice de 1945 fut signé le 8 mai
Faux ! En fait, en mai 1945, ce n'est pas une, mais deux redditions qui furent signées. A noter par ailleurs que nous utilisons à tort aujourd'hui le terme d'armistice, alors qu'il s'agissait bel et bien d'une capitulation de l'armée allemande.
En février 1945, le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées en Europe, avait installé son quartier général dans le collège moderne et technique de Reims. C’est là que fut signée une première capitulation, le 7 mai 1945 à 2h40 du matin, dans la salle des opérations (la war room.).
Le général Jodl (un émissaire allemand envoyé par l’amiral Donitz.) signa alors l’acte de reddition sans conditions de l’armée allemande. Étaient aussi présents ce jour là le général américain Bedel Smith (représentant le commandement suprême des forces expéditionnaires alliées.) et le général Susloparov (représentant le haut commandement soviétique général.).
Le général français Sevez signa l’acte de reddition à titre de témoin.

La signature de l'acte de reddition du 7 mai 1945.
La capitulation du 7 mai prévoyait la fin des hostilités sur les deux fronts pour le 8 mai à 23h01 (à noter que quelques mois après, Jodl fut condamné à mort par le tribunal de Nuremberg, et fut pendu le 16 octobre 1946.).
Staline, quant à lui, considérait que la capitulation du 7 mai n’était valable que pour la zone occupée par les anglo-saxons.
Il décida donc d’en faire signer une seconde à Berlin, au cœur de la zone d’occupation soviétique.
Une seconde capitulation fut alors signé le 9 mai à 0h28, dans le quartier général des forces soviétiques.
Le général allemand Keitel signa donc l’acte de reddition. Étaient aussi présents le maréchal Joukov, le maréchal Tedder (envoyé par le général Eisenhower.), le général Saatz et le général de Latre de Tassigny.
En fait, la première capitulation fut signée le 7 mai, mais il est vrai que les hostilités prirent fin, en France, le 8 mai
(ce fut le Général de Gaulle qui annonça la fin des combats
ce jour-là à 15 heures.).
A noter que la date retenue par la Russie pour commémorer cet évènement n’est ni le 7, ni le 8, mais le 9 mai.
Cependant, n'oublions pas que des milliers de soldats se battirent encore pendant des mois dans le Pacifique, après la signature de l’acte de reddition du 7 mai… en ce qui concerne la lutte contre le Japon, il faudra attendre que les Etats-Unis aient lancé leurs deux bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki (les 6 et 9 août 1945.) pour que l’on commence à parler de reddition… au final, les Japonais capitulèrent seulement le 2 septembre 1945, soit près de 4 mois après l’Allemagne nazie.
C’est pour cela que de nos jours, les Etats-Unis différencient le Victory Europe Day et
le Victory Japan Day.
Précisons aussi que la France est le seul pays où le 8 mai est férié et chômé (depuis 1981.). En effet, si ce jour est férié aux Etats-Unis, en Russie et en Angleterre, il n’est pas chômé.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les mensonges de l'Histoire
Menhirs et dolmens ont été érigés par les GauloisFaux ! Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'érection des menhirs et des dolmens est de loin antérieure à l'arrivée des Gaulois en France.

Dolmen de Ballykeel, Irlande.
Ainsi, l'on estime que ces derniers, en provenance d'Europe de l'est, émigrèrent en Gaule vers 700 avant Jésus Christ. A noter qu'ils se nommaient eux mêmes "Celtes" dans leur langue ; toutefois, les Romains les nommaient Galli (peut être s'agissait t'il d'un dérivé du mot germain walhisk, signifiant 'étranger'.), que l'on peut traduire en Français par "Gaulois".
Cependant, l'on estime l'érection des mégalithes entre 4500 et 2500 avant Jésus Christ, c'est à dire à la fin de l'ère néolithique[1]. Dolmens et menhirs étaient donc érigés depuis bien des siècles lorsque les Gaulois arrivèrent en France.
A noter toutefois que la signification de ces imposants édifices s'est perdue au cours des siècles ; aujourd'hui, les archéologues ne peuvent émettre que des hypothèses. Ainsi, s'il est communément admis que les dolmens (formé des mots bretons dol, qui signifie 'table', et men, 'pierre'.), avaient une vocation funéraire[2], les menhirs (formé des mots bretons men, qui signifie 'pierre', et hir, 'longue'.), au contraire, sont parvenus à conserver une grande partie de leur mystère. Depuis le XIX° siècle, de nombreux chercheurs ont ainsi tenté d'expliquer la fonction des menhirs, faisant de ces édifices un lieu sacrificiel dédié aux druides, une représentation primitive des divinités néolithiques, ou bien de simples stèles mortuaires.

Menhir de Kerloas, Finistère.
Il n'en reste pas moins que les menhirs et les dolmens font partie de notre histoire, un passé qui s'est perdu en raison de l'absence d'écriture et de traditions orales lacunaires[3].
[1] Le néolithique est une période s'étendant de 9000 à 3300 avant Jésus Christ. C'est à cette époque que l'homme, plutôt que de concentrer son activité sur la chasse, commença à maitriser l'élevage et l'agriculture.
[2] L'inhumation dans un dolmen était vraisemblablement réservée à une élite, vu le coût élevé que devait représenter l'érection d'un tel édifice.
[3] Peut être en raison de la mauvaise cohabitation des Gaulois et des peuples autochtones installés en France depuis le néolithique ?
 votre commentaire
votre commentaire
-
Jeanne d'Arc ( bataille 1429 - 1431)
Comme nous l’avons vu précédemment, Charles VII, en 1429, n’avait pas réussi à s’opposer efficacement face aux Anglo-bourguignons. Au contraire, c’était le duc de Bedford, le régent anglais, qui était en passe de remporter la victoire contre Charles VII.
Royaume de France, royaume d'Angleterre et duché de Bourgogne en 1429.
Depuis octobre 1428, l’armée anglaise assiégeait alors Orléans. Si la cité tombait, le chemin vers Bourges, où résidait Charles VII, était tout tracé.
Le Valois, qui avait quitté Bourges pour Chinon, dans un souci de sécurité, était alors dans une situation difficile.
C’est alors qu’apparut Jeanne d’Arc, figure jugée providentielle par de nombreux historiens. A noter que le récit de la vie de cette figure historique est à prendre au conditionnel, de nombreux hagiographes[1] ayant embelli l’histoire de Jeanne d’Arc.

Croquis représentant Jeanne d'Arc, exécuté de son vivant dans la marge d'un registre du Parlement de Paris par le greffier Clément de Fauquenbergue.
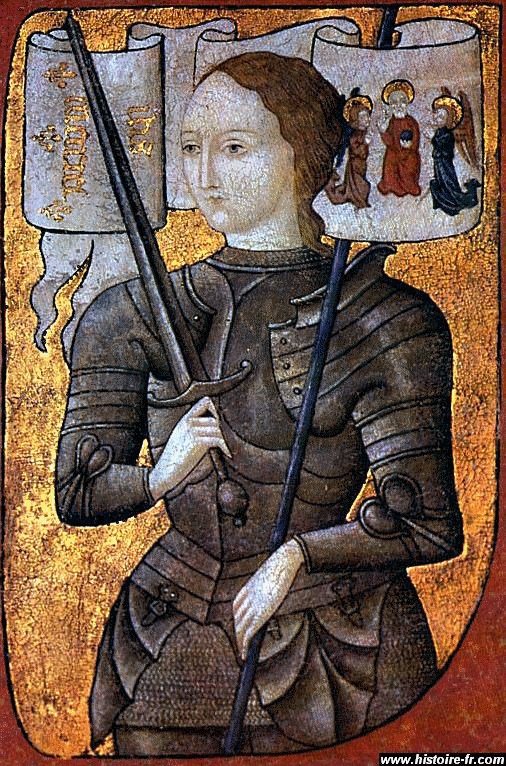
Portrait de Jeanne d'Arc, selon une miniature du XV° siècle, musée de Rouen.
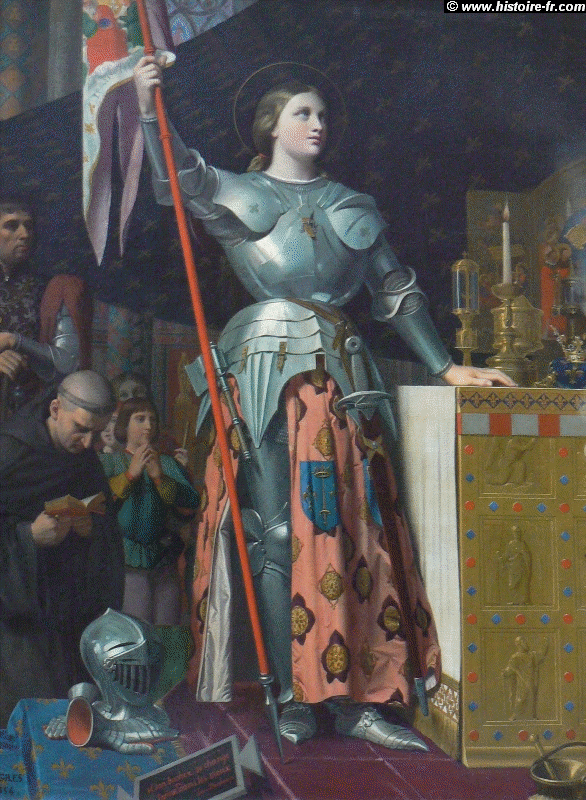
Jeanne d'Arc au sacre du roi Charles VII, par Jean Auguste Dominique INGRES, 1854, musée du Louvre, Paris.
1° Le voyage vers Chinon (mars 1429) – Jeanne, cadette d’une famille de cinq enfants, naquit en janvier 1412 à Domrémy, en Lorraine. Très pieuse dès son plus jeune âge, la jeune fille fut bergère lors de son enfance.

Jeanne d'Arc gardant les moutons, gravure issue de l'ouvrage Histoire de France, par François GUIZOT, France, 1875.
C'est alors qu'elle aurait entendu les voix de l’archange Saint Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, dès l’âge de treize ans. Ces dernières lui demandèrent instamment de partir à la rencontre de Charles VII, de le conduire à Reims, et de bouter les Anglais hors de France.
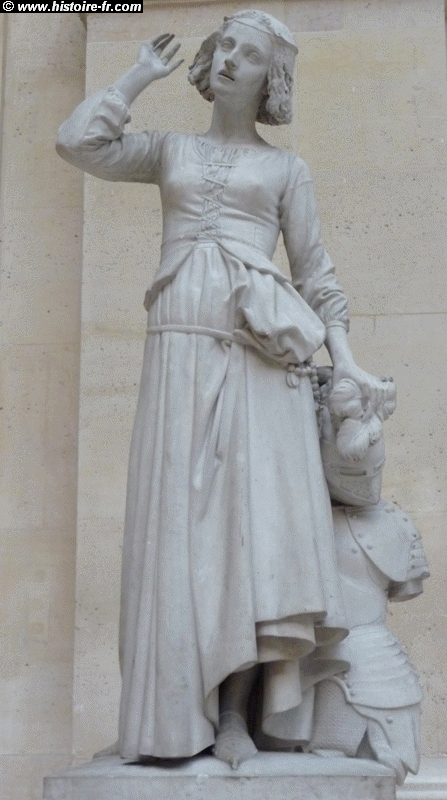
Jeanne d'Arc écoutant ses voix, par François RUDE, 1845, musée du Louvre, Paris
Jeanne d'Arc entendant la voix de l'archange Saint Michel, par Jules Eugène LENEPVEU, 1874, le Panthéon, Paris.
A l’âge de 17 ans, Jeanne décida de se rendre à Vaucouleurs, demandant à Robert Baudricourt, capitaine de la cité, de bien vouloir l’engager dans les troupes royales.
Chassée par le capitaine à deux reprises, Jeanne parvint toutefois à s’attirer la sympathie des habitants de la cité, enthousiasmés par l’idée qu’une aussi jeune fille ait la volonté de lutter pour défendre le royaume de France.
Lors de leur troisième rencontre, Jeanne affirma à Baudricourt qu’il était impératif pour elle de se rendre à Chinon, et qu’elle était prête à faire le voyage jusqu’à Chinon à pied, dût elle user ses jambes jusqu’aux genoux.
Finalement, le capitaine décida d’accepter la requête de la jeune femme, lui confiant un cheval et une petite escorte.

Le périple de Jeanne d'Arc jusqu'à Chinon, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Jeanne d'Arc part de Vaucouleurs, 1429, son oncle et un autre paysan se cotisèrent pour lui donner un cheval, Baudricourt lui donna une épée et lui dit, va et advienne que pourra, par Jules Eugène LENEPVEU, 1874, le Panthéon, Paris.
Revêtant l’habit d’homme, Jeanne voyagea jusqu’à Chinon, traversant des territoires alors entre les mains des Anglo-bourguignons.
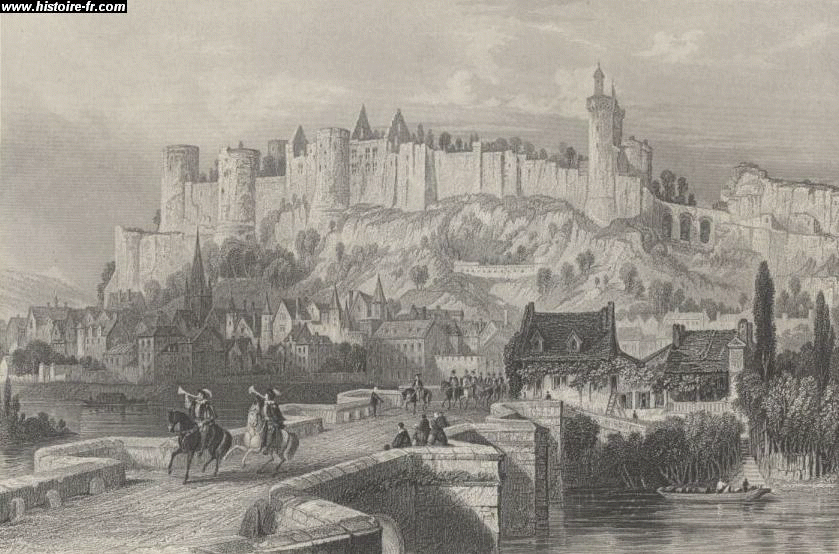
La forteresse de Chinon en 1429, gravure issue de l'ouvrage Histoire de France, par François GUIZOT, France, 1875.
Après avoir rencontré des conseillers du roi à Chinon, en mars 1429, ces derniers acceptèrent la requête de Jeanne, qui insistait pour rencontrer Charles VII. En apprenant qu’une jeune pucelle[2] de 17 ans venue de Lorraine souhaitait bouter l’Anglais hors de France, le Valois crut à une farce. Il décida alors de tromper Jeanne, s’habillant simplement, et demandant à un de ses proches de vêtir ses habits de roi. Pénétrant dans la pièce ou se trouvait le roi et sa cour, la jeune femme ne tomba cependant pas dans le piège et marcha alors directement vers Charles VII.
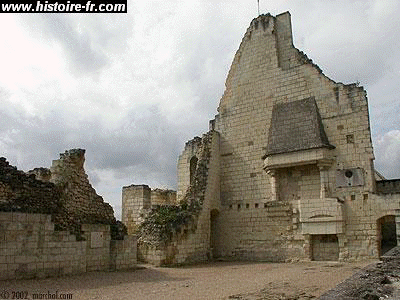
Ruines de la forteresse de Chinon, dans laquelle Jeanne d'Arc rencontra Charles VII.
Jeanne exposa alors les raisons de sa visite au Valois, affirmant qu’elle venait le trouver sur les ordres de Dieu, et qu’elle désirait entrer au service du roi afin de chasser les Anglais hors du continent.

La première rencontre entre Charles VII et Jeanne d'Arc, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Charles VII décida alors d’emmener la jeune femme à Poitiers, la faisant interroger par des professeurs de l’Université de Paris réfugiés dans la cité. N’ayant rien retenu contre elle, Jeanne fut alors nommé chef de l’armée par le roi.
Au début du mois d’avril, il fut donc décidé de se rendre au secours d’Orléans (la cité étant assiégée par les Anglo-bourguignons depuis octobre 1428.). A noter qu’au même moment, les assiégés acceptèrent de se rendre aux Bourguignons, se plaçant sous la protection de Philippe le Bon. Cependant, le duc de Bedford refusa cette proposition, ce qui entraina un vif mécontentement de la part du duc de Bourgogne. Ce dernier, excédé, décida alors de retirer ses troupes.
2° La campagne de la vallée de la Loire (avril à juin 1429) – Avant de partir en campagne, Jeanne se fit confectionner une armure adaptée à son gabarit, et trouva peu de temps après l’épée de Charles Martel, enterrée derrière l’autel de l’église de la petite commune de Sainte Catherine de Fierbois (la légende raconte que le Franc avait déposé là son épée, suite à la bataille de Poitiers, en octobre 732[3].). La chronique raconte que la rouille qui gangrenait l’épée disparut dès que la Pucelle posa la main dessus.
La jeune femme reçut aussi un grand étendard blanc, orné d’une fleur de lys, et portant l’inscription Jesus Maria. Jeanne déclara qu’elle aimerait quarante fois plus sa bannière que son épée.
Une fois les préparatifs achevés, Jeanne, à la tête d’une armée de 4 000 hommes, se dirigea vers Orléans (fin avril 1429.). Passant par Blois, la jeune femme fut immédiatement rejointe par de nombreux petits chevaliers et hommes d’armes, subjugués par le courage de la Pucelle.
Les populations entières se jetaient à genoux autour d'elle, ceux qui n'étaient pas assez heureux pour s'en approcher et pour baiser ses mains et ses vêtements baisaient la terre des pas de son cheval, 1429, par Jules Eugène LENEPVEU, 1874, le Panthéon, Paris.
a) Le siège d’Orléans (avril à mai 1429) : Jeanne, arrivant devant Orléans à la fin du mois d’avril, voulut s’attaquer immédiatement aux Anglais qui étaient en possession du fort des Tourelles, et qui contrôlaient donc l’unique pont menant à la ville (à noter que le pont avait été en partie démoli par les Orléanais, afin d’empêcher les assaillants de progresser jusqu’aux portes de la ville.).
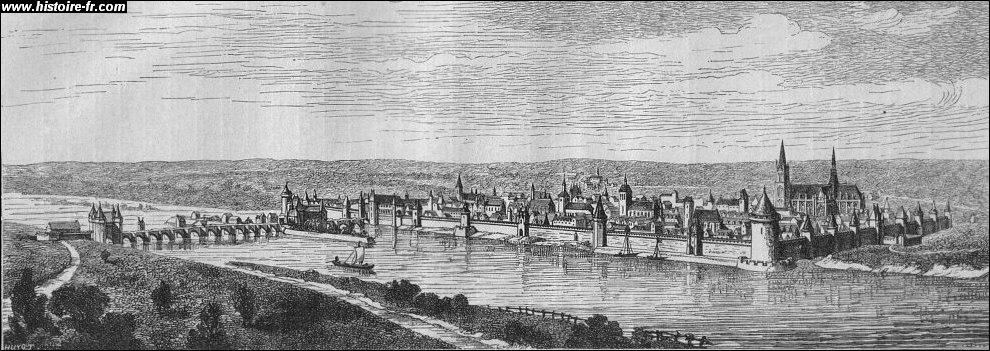
Orléans en 1429.
Plan d'Orléans en 1429 (faites un clic droit sur la carte, suivi d'un zoom avant, afin d'avoir une vision plus précise).
Cependant, les généraux refusèrent de suivre le plan de la jeune femme, préférant traverser la Loire en bateau afin d’éviter de se heurter aux Anglais.
Elle rencontra alors Jean de Dunois (fils illégitime de Louis d’Orléans, il était surnommé le bâtard d’Orléans.), auquel elle exposa ses griefs à l’encontre de ses généraux.

Jean de Dunois, 1843, musée du Louvre, Paris.
Les premiers navires, chargés d’armes et de vivres, parvinrent à rentrer dans la ville ; cependant, ils ne purent revenir, à cause de vents contraires et d’une pluie diluvienne.
L’armée royale n’avait donc pas d’autre solution que de se heurter aux Anglais afin de parvenir à rentrer dans Orléans.
Cependant, Dunois insista auprès de Jeanne afin que cette dernière traverse la Loire et se rende dans la cité, afin de redonner courage à ses habitants. La Pucelle accepta à contrecœur, franchissant le fleuve, et pénétrant dans la ville par la porte de Bourgogne (29 avril 1429.).
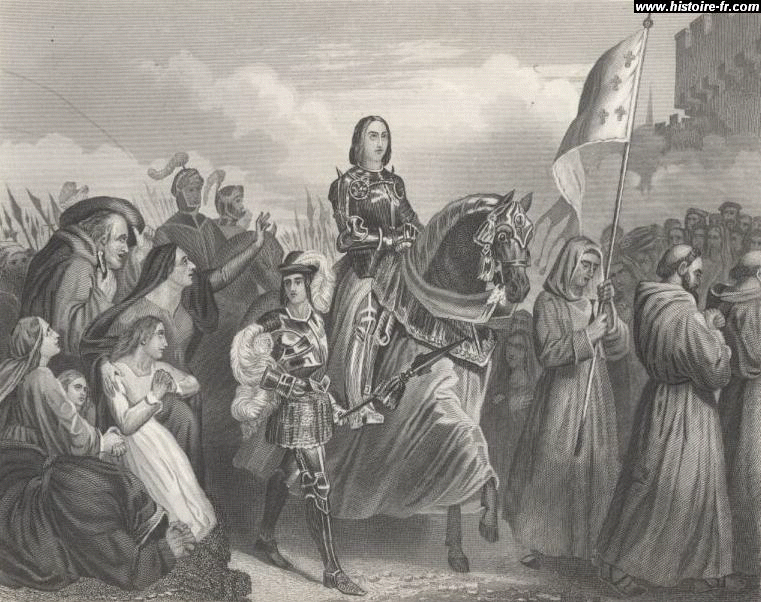
Jeanne d'Arc pénètre dans Orléans, gravure issue de l'ouvrage Histoire de France, par François GUIZOT, France, 1875.
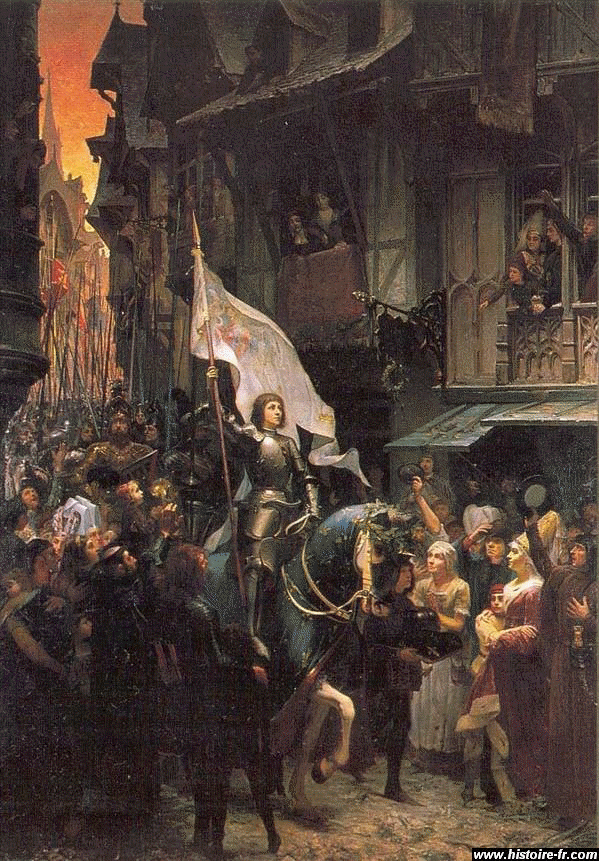
Entrée de Jeanne d'Arc à Orléans, par Jean Jacques SCHERRER, 1887.
Le 4 mai, l’armée royale, commandée par Dunois, parvint à franchir la Loire, traversant sans encombre les bastilles détenues par l’ennemi.
C’est alors que les Anglais décidèrent de contre-attaquer, sortant de la bastille Saint Loup, qui se trouvait à l’est de la porte de Bourgogne. Jeanne, apprenant l’offensive anglaise, lança ses hommes au combat. Victorieux, les Français parvinrent à s’emparer de Saint Loup dans la soirée.
Le 5 mai eut lieu l’Ascension, une fête chômée. Respectant le calendrier liturgique, les deux armées ne s’affrontèrent pas.
Jeanne décida alors d’envoyer un message aux Anglais : vous, hommes d’Angleterre, qui n’avez aucun droit en ce royaume, le roi des Cieux vous mande et ordonne, par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos bastilles et retourniez en votre pays…

La signature de Jeanne d'Arc.
Fixant sa lettre autour d’une flèche, la missive fut ainsi envoyée aux Anglais. Ces derniers s’éclaffèrent en lisant la lettre de la « putain des Armagnacs », le surnom dont ils avaient affublé la jeune femme.
Le lendemain, Jeanne fit traverser la Loire à son armée, et s’attaqua à la bastille Saint Jean, qui se trouvait au sud ouest de la bastille Saint Loup.
Les Anglais décidèrent de fuir devant l’armée royale, se réfugiant aux Tourelles et dans le couvent Saint Augustin (l’édifice en ruine, se trouvant au sud du pont menant à Orléans, avait été transformé en forteresse par les Anglais.).
La Pucelle fit alors donner l’assaut contre le couvent, dont les Français parvinrent à s’emparer non sans mal. Quelques Anglais parvinrent à rejoindre les Tourelles, mais un grand nombre d’entre eux trouvèrent la mort ce jour là.
Au soir de la bataille, Jeanne décida de retourner à Orléans, bien décidée à s’emparer de l’imposante bastille le lendemain.
Le 7 mai, les Français traversèrent à nouveau la Loire, et commencèrent le siège des Tourelles. Cependant, dès le début de la bataille, Jeanne fut blessé d’une flèche à l’épaule.
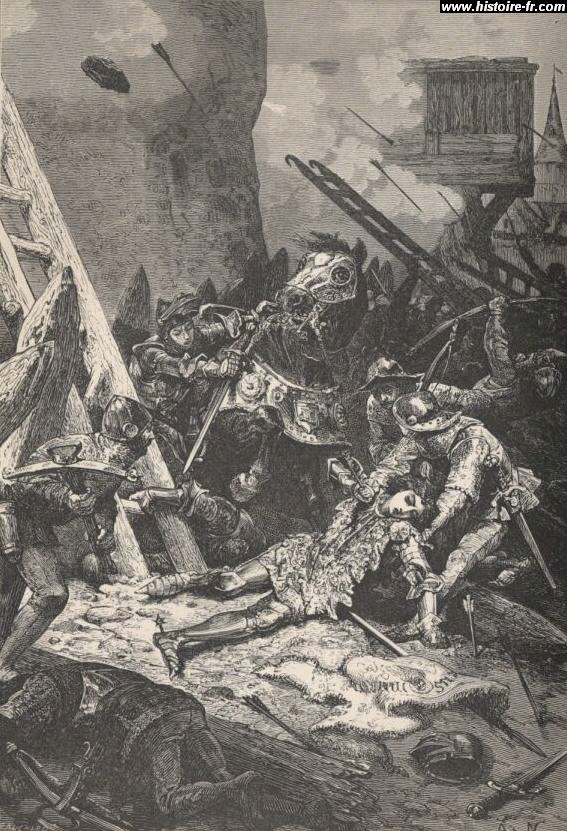
Jeanne recevant une flèche dans l'épaule lors du siège d'Orléans, gravure issue de l'ouvrage Histoire de France, par François GUIZOT, France, 1875.
Enlevant elle même le trait qui l'avait transpercée, Jeanne fut transportée à quelque distance du combat, où fut soignée de manière rudimentaire.
Reprenant conscience, elle aperçut Dunois faire reculer l’armée royale. Bondissant sur son cheval, elle harangua les soldats de l’armée royale, et lança un nouvel assaut contre les Tourelles.

Les Français s'emparent de la bastille des Tourelles, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.

Jeanne d'Arc à l'assaut des Tournelles, par Paul Lehugeur, XIX° siècle.
Les Français, enthousiasmés par l’ardeur de la Pucelle, se ruèrent à l’assaut de la bastille. Peu de temps après, ils parvinrent à s’en emparer, tuant ou emprisonnant tous les Anglais se trouvant là.
Jeanne arc en armure devant Orléans, par Jules Eugène LENEPVEU, 1874, le Panthéon, Paris.
Dans la nuit du 7 au 8 mai 1429[4], les Anglais, vaincus, décidèrent alors de lever le siège et de se retirer.
Le 13 mai, Charles VII entra dans la ville, accueilli par Jeanne d’Arc. Au début du mois de juin, elle insista auprès du Valois afin que se dernier accepte de se rendre à Reims pour se faire sacrer roi.
Cependant, avant de se lancer dans un tel périple, les Français devaient encore éliminer les restes de l’armée anglaise, qui s’était retranchée dans plusieurs villes avoisinant Orléans.
b) Bataille de Jargeau (mi juin 1429) : suite au siège d’Orléans, le moral était au beau fixe au sein de l’armée royale. En outre, enthousiasmés par cette victoire, de nombreux civils décidèrent de s’engager parmi les troupes du roi de France.
Suite à cette victoire, les Français poursuivirent alors leur offensive dans la vallée de la Loire.
Peu de temps après l’abandon du siège d’Orléans, une partie des troupes anglaises trouvèrent refuge dans le village de Jargeau, située au nord de la Loire. Assistée par le bâtard d’Orléans et Jean II de Valois, comte d’Alençon[5], Jeanne d’Arc décida de marcher vers la petite cité, et installa son campement aux portes de la ville.
Dans la nuit du 11 au 12 juin 1429, les Anglais décidèrent d’attaquer l’ennemi, mais leur charge fut vaillamment repoussée par les Français.
Le lendemain, ces derniers lancèrent l’assaut contre Jargeau, et parvinrent à chasser les Anglais de la cité. Au soir de la bataille, alors que Jeanne pénétrait dans Jargeau, les troupes anglaises se repliaient en désordre.
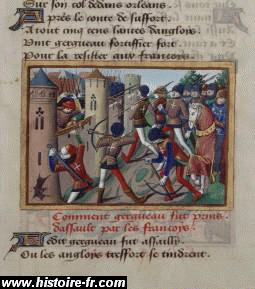
La bataille de Jargeau, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Le 17 juin, approchant de Beaugency, la cité capitula, ouvrant ses portes à Jeanne et son armée. John Fastolf, commandant l’armée anglaise, fut contraint de reculer une nouvelle fois.
c) La bataille de Patay (18 juin 1429) : suite à la prise de Beaugency, en juin 1429, Français et Anglais se retrouvèrent une nouvelle fois. Cependant, si les batailles précédentes n’avaient été que de simples escarmouches, la bataille de Patay fut une vraie bataille rangée, opposant 1 500 Français à près de 5 000 Anglais.

La bataille de Patay, par Jean Chartier, enluminure issue de l'ouvrage Chronique, Belgique, XV°siècle.
Comme à leur habitude, les troupes anglaises (commandées par John Fastolf et John Talbot.) décidèrent de faire intervenir leurs archers, qui avaient causé de grands ravages depuis le début de la guerre de Cent Ans. Ces derniers, comme à leur habitude, plantèrent des épieux en terre afin de se protéger contre une éventuelle charge de cavalerie.
Les Français, commandés par Ambroise de Loré, La Hire, et Jean Poton de Xaintrailles, décidèrent alors d’envoyer des piquiers attaquer l’ennemi sur ses flancs. Les archers anglais, qui n’étaient pas équipés pour le combat au corps à corps, furent alors massacrés.

La bataille de Patay, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Au même moment, la cavalerie française, qui n’avait plus rien à craindre des flèches ennemies, parvint à l’emporter sur la cavalerie anglaise.
La victoire fut éclatante pour les Français, qui perdirent moins de cent hommes au cours de l’affrontement. Les Anglais, par contre, eurent plus à souffrir des conséquences de la bataille, perdant près de la moitié de leur effectif. Talbot fut capturé, et Fastolf décida de s’enfuir avec quelques hommes (disgracié, il fut radié de l’Ordre de la Jarretière par le duc de Bedford.). A noter que les Français avaient l’habitude de sectionner l’index des archers anglais, afin que ces derniers ne puissent plus tirer à l’arc.
3° La chevauchée vers Reims, le sacre de Charles VII (juin à juillet 1429) – Suite à cette victorieuse campagne, Charles VII accepta de se rendre à Reims afin de se faire sacrer roi de France, entreprenant une périlleuse chevauchée au sein de territoires alors contrôlés par les Anglo-bourguignons.
Royaume de France, royaume d'Angleterre et duché de Bourgogne lors de la campagne de Jeanne d'Arc (1431).
L’armée royale, comptant près de 12 000 hommes, partit alors de Gien à la fin du mois de juin 1429.
Début juillet, l’armée royale arriva devant Auxerre. Après d’habiles négociations, la garnison bourguignonne se trouvant dans la cité décida de rester neutre.
Le 10, le cortège se trouva devant Troyes, alors occupée par une garnison anglaise. Jeanne, refusant toute négociation avec les Anglais, persuada Charles VII de mettre le siège devant la cité. Les habitants de la ville, impressionnés par cette démonstration de force, décidèrent alors de capituler.

La capitulation des Troyens, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Progressant inéxorablement vers son objectif, Charles VII reçut aussi la soumission de Chalons en Champagne, alors que son armée se trouvait non loin de cette cité.

La soumission des habitants de Chalons en Champagne, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Le 16 juillet 1429, l'armée royale arriva finalement à Reims.
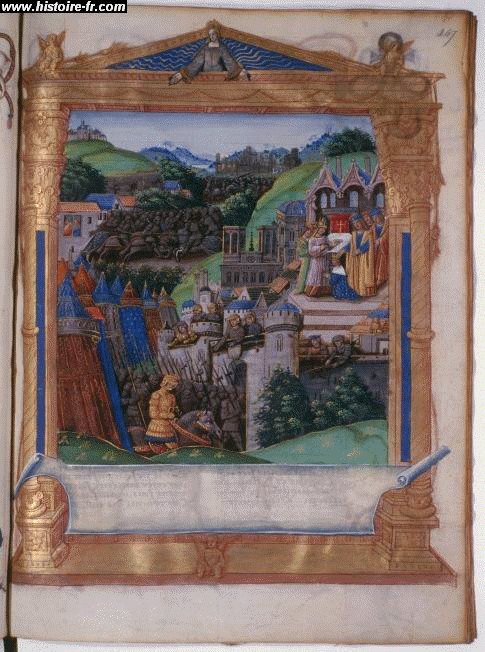
L'entrée de Charles VII dans Reims, par Guillaume Fillastre, enluminure issue de l'ouvrage Toison d'Or, France, Paris, XV° - XVI° siècle.
Dès le lendemain, Charles VII fut sacré roi de France dans l'église de la cité, en présence de la famille royale, de nombreux seigneurs, et de Jeanne d’Arc.

Le sacre de Charles VII, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Le sacre de Charles VII, par Jules Eugène LENEPVEU, 1874, le Panthéon, Paris.
La portée de ce couronnement fut majeure. En effet, le nouveau souverain n’était plus le fruit de l’union illégitime entre Isabeau de Bavière et Louis d’Orléans, mais le représentant de Dieu sur terre, digne successeur des Valois. De ce fait, le traité de Troyes n’avait plus de valeur, et le jeune Henri VI, qui apparaissait déjà comme un souverain déjà peu légitime, perdait ainsi toute crédibilité.
Dès l’annonce du sacre, les habitants de Laon décidèrent d’envoyer à Charles VII les clefs de la ville.
Au cours de l’été, de nombreuses cités firent allégeance au nouveau souverain : Sens, Soissons, Crécy, Coulommiers, Provins, Château Thierry, etc.

Les habitants de Sens font soumission à Charles VII, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Le duc de Bedford, voyant d’un œil inquiet le spectaculaire redressement du Valois, proposa à celui qui se disait dauphin et qui ose maintenant se dire roi, de s’affronter au cours d’une vraie bataille rangée. Charles VII refusa la proposition, préférant user l’ennemi, décidant de suivre la même tactique que son grand père Charles V.
Enfin, à la fin du mois d’août, Charles VII signa une trêve de quatre mois avec le duc de Bourgogne.
4° Jeanne d’Arc chef de guerre (été 1429 à mai 1430) – Suite à la signature de la trêve entre Charles VII et Philippe le Bon, Jeanne décida de marcher sur Paris (la cité était alors entre les mains des Bourguignons.).
Assistée par Jean II, duc d’Alençon, Jeanne entreprit le siège de la ville au début du mois de septembre 1429.
Blessée à la cuisse devant la porte Saint Honoré, les combats cessèrent, malgré les protestations de la Pucelle. En outre, Charles VII décida d’interdire à l’armée royale de reprendre les combats, soucieux de respecter la trêve signée avec les Bourguignons.

Le siège de Paris, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Souhaitant rester prudent quant à la suite des évènements, le roi de France préféra se retirer vers la Loire. A la fin de mois de septembre, se trouvant alors à Gien, Charles VII décida de licencier son armée.
A cette époque, la guerre était loin d’être finie : en octobre, le duc de Bourgogne reçut du duc de Bedford le titre de lieutenant général du royaume de France ; en novembre, le jeune Henri VI fut sacré roi de France et d’Angleterre à Westminster.

Le sacre d'Henri VI, par Jean de Wavrin, enluminure issue de l'ouvrage Chroniques d'Angleterre, Belgique, XV° siècle.
Jeanne d’Arc fut alors envoyée dans le Berry afin de lutter contre les compagnies qui causaient à cette époque de graves déprédations.
Début novembre, elle parvint à s’emparer de Saint Pierre le Moûtiers, mais échoua devant La Charité sur Loire, alors aux mains du Bourguignon Perrinet Gressart. Cependant, l’hiver arrivant, Jeanne dut abandonner le siège et regagner le château de Mehun sur Yèvre où séjournait le roi.
A la fin du mois de décembre, en guise de remerciement, la Pucelle fut anoblie par le roi, ainsi que ses parents, ses frères, et tout son lignage.
Au mars 1430, la Pucelle décida finalement de quitter le château de Sully sur Loire, où elle avait accompagnée le roi. Elle ne voulait pas rester inactive alors que le duc de Bedford, afin de renforcer son alliance avec la Bourgogne, avait donné la Champagne et la Brie à Philippe le Bon.
Quittant le roi sans prendre congé, Jeanne participa à quelques combats au printemps 1430, sans toutefois réussir à l’emporter. Cependant, sa présence et sa renommée parvenaient à terrifier certains capitaines et soldats anglais, tant et si bien que leurs supérieurs durent prendre des mesures contre ceux qui tremblaient devant la Pucelle.
En mai 1430, Jeanne répondit à l’appel des habitants de Compiègne, alors assiégés par les Bourguignons (en effet, au lendemain du sacre, Charles VII avait chassé la garnison bourguignonne se trouvant dans la cité.).

Le siège de Compiègne, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Le 23 mai 1430, la Pucelle pénétra dans la cité, accompagnée par des forces très réduites. Tentant une sortie le soir même, elle se lança à l’assaut des troupes de Jean II de Luxembourg, comte de Guise (ce dernier était un fidèle allié des Bourguignons, confirmé dans ses droits par le duc de Bedford.).
C’est alors qu’une troupe anglaise arriva en renfort, prenant les compagnons de Jeanne d’Arc entre deux feux. Se sentant en danger, la jeune femme ordonna à ses hommes de reculer vers Compiègne. Cependant, le pont levis se releva, abandonnant la Pucelle aux mains des Anglo-bourguignons.
C’est alors qu’un des vassaux de Jean de Luxembourg tira une flèche sur le cheval de Jeanne, la faisant tomber à terre. C’est ainsi que cette dernière fut capturée par les Bourguignons.

L'arrestation de Jeanne d'Arc, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Jeanne est entourrée (sic) et prise à Compiègne, tous ses ennemis se ruaient à la fois contre elle, un archer la tira violemment par sa huque de drap et la fit tomber de cheval, 1430, par Jules Eugène LENEPVEU, 1874, le Panthéon, Paris.
5° Le procès de Jeanne d’Arc (janvier à mai 1431) – Suite à sa capture, les Bourguignons retinrent Jeanne prisonnière pendant près de six mois.

Jeanne d'Arc endormie, par George William JOY, 1895.
Pendant ce temps, alors que la Pucelle était entre les mains de Jean de Luxembourg, Charles VII parvint à remporter plusieurs victoires.
En juin, l’armée royale stoppa les troupes bourguignonnes, qui tentaient de s’emparer du Dauphiné ; en juillet, Charles VII conclut une alliance avec Frédéric III, archiduc d’Autriche[6] ; en novembre, la ville de Liège, soudoyée par le roi de France, se révolta contre les Bourguignons, et Charles VII parvint à s’en emparer.
Jeanne, quant à elle, fut finalement vendue aux Anglais pour 10 000 livres. Ce fut alors Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, qui fut chargé d’instruire son procès pour hérésie.
Emprisonnée à Rouen dans un château ayant appartenu à Philippe II Auguste, le procès de la Pucelle s’ouvrit en février 1431.

Jeanne d'Arc interrogée par Pierre Cauchon, gravure issue de l'ouvrage Cassell's history of England, Angleterre, 1902.
Bien qu’étant innocente des crimes qu’on lui reprochait, les Anglais voulaient se débarasser de la jeune femme de manière légale. De ce fait, le tribunal déclara Jeanne coupable d’être schismatique, apostate[7], hérétique, etc.

Jeanne d'Arc devant ses juges, par Paul Lehugeur, XIX° siècle.
Le 23 mai, suite au procès, Cauchon et les juges tentèrent d’effrayer Jeanne, la menaçant de la condamner au bucher si elle ne se rétractait pas. Apeurée, la jeune femme décida alors de se rétracter, reconnaissant ses erreurs et se « offenses » envers l’Eglise. En échange, Cauchon jura à Jeanne qu’elle serait condamnée à la prison à vie, enfermée dans une cellule ecclésiastique.
Cependant, Cauchon ne respecta pas sa promesse, et la Pucelle fut renvoyée dans sa prison, entre les mains des Anglais. C’est alors que le 28 mai, la jeune femme fut surprise en train de porter des habits d’homme (l’on ne sait pas exactement dans quelles conditions Jeanne décida de revêtir ces vêtements masculins.).
Déclarée relapse[8] par Cauchon et les juges, la Pucelle fut alors condamnée au bûcher.

Jeanne d'Arc attachée au bûcher, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle.
Le 30 mai 1431, les Anglais firent brûler vive la condamnée sur place du Vieux Marché de Rouen. Cette dernière n’avait pas vingt ans…
Jeanne d'Arc sur le bûcher, par Jules Eugène LENEPVEU, 1874, le Panthéon, Paris.
Afin que ses restes ne soient pas utilisés comme des reliques, les Anglais décidèrent de récolter les cendres de la Pucelle, qu’ils jetèrent ensuite dans la Seine[9].
[1] On appelle hagiographes les personnes écrivant des hagiographies ; c'est-à-dire des récits de vies de Saints.
[3] Pour en savoir plus sur la bataille de Poitiers, qui eut lieu le 17 octobre 732, voir le 2, section II, chapitre premier, les Carolingiens.
[4] Aujourd’hui encore, le 7 et le 8 mai sont fêtés par les habitants d’Orléans en souvenir de ces évènements.
[5] Ne pas confondre Jean II, duc d’Alençon, et Jean II, roi de France. Les deux hommes descendaient de Charles de Valois, frère de Philippe IV le Bel, mais l’un était issu de la branche cadette, l’autre de la branche aînée.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les mensonges de l'Histoire
Faux ! Car la sempiternelle rengaine "nos ancêtres les Gaulois" ne repose pas sur une étude scientifique sérieuse, mais sur une simple volonté politique.

Statue de Vercingétorix à Alise Sainte Reine (un des sites présumés d'Alesia).
Remettons les choses dans leur contexte. Au XIX° siècle, suite à la guerre de 1870 contre la Prusse, les Français n'avaient pas le moral, honteux d'avoir été vaincus par leur ennemi. Les dirigeants du pays, outre la mise en place d'une réforme de l'armée, décidèrent aussi de réformer l'école. Les hommes politiques voulaient à cette époque faire de chaque enfant un futur soldat, apte à défendre son pays. Il fallut alors trouver un modèle, qui susciterai l'admiration et encouragerait le patriotisme des jeunes français. Il était impossible de choisir un roi pour modèle, la III° république venant à peine de naître (les politiques ne voulaient pas créer de futurs royalistes.) ; il était aussi impossible de prendre Napoléon I° ou Napoléon III comme modèles, bien qu'ils aient tout deux accomplis de hauts faits militaires (là aussi, il ne fallait pas encourager l'impérialisme chez les jeunes.) ; pas question non plus de prendre des révolutionnaires pour modèles (la révolution française ayant dégénéré en tuerie dès 1790.) ; quant à Jeanne d'Arc[1], l'idée était bonne, mais républicains et ecclésiastiques rivalisaient pour "s'emparer" de son histoire.
Les dirigeants décidèrent donc de remonter très loin dans le passé, à une époque où la France n'avait pas encore de rois, et qu'elle était peuplée par ce peuple qu'on appelle les Gaulois. Les hommes politiques furent satisfaits de leur trouvaille, car ils firent en sorte que l'opposition Gaulois/Romains rappelle l'opposition Français/Prussiens.
Par la suite, cette fausse idée se répandit partout en France et dans nos colonies (c'est ce qui s'appelle de la propagande.), et, plus de 100 ans après, est toujours présente dans l'esprit de nombreux de nos compatriotes.
Donc, pour résumer, disons que oui, les Gaulois sont nos ancêtres, mais n'oublions pas que des centaines d'autres peuples le sont tout autant (Grecs, Phéniciens, Romains, Francs, Ligures, etc.).
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les mensonges de l'Histoire
Champollion a déchiffré les hiéroglyphes grâce à la pierre de RosetteFaux ! Ou presque...
Jean François Champollion naquit à Figeac, dans le Lot, le 23 décembre 1790. La famille Champollion, s'installant à Grenoble en mars 1801, confia l'éducation du jeune Jean François à l'abbé Dussert. Ce dernier enseigna à son élève le latin et le grec, ainsi que l'hébreu, l'arabe, le syriaque et le chaldéen.

Buste de Jean François Champollion, par THOMAS, 1850, château de Versailles, Versailles.
Plus tard, en mars 1804, Champollion fut admis au lycée impérial de Grenoble. N'appréciant guère la discipline quasi-militaire de l'établissement, le jeune homme commença toutefois à se passionner pour l'Egypte antique et les mystérieux hiéroglyphes[1]. C'est entre 1806 et 1807 que Champollion aurait rencontré un moine grec, ayant participé à l'expédition d'Egypte[2], ce dernier lui expliquant que la langue copte provenait de l'égyptien ancien.
Afin de perfectionner sa formation, Champollion décida de rejoindre la capitale en septembre 1807, suivant des cours au Collège de France. Il y apprit entre autres le copte, le persan et l'amharique, et perfectionna ses connaissances en arabe et en hébreu.
C'est en 1808 que Champollion reçut de l'abbé de Tersan une copie de la pierre de Rosette, grâce à laquelle il put commencer à déchiffrer les hiéroglyphes.
La pierre de Rosette, gravée sous le règne du pharaon Ptolémée V[3] au début du II° siècle avant Jésus Christ, fut retrouvée en 1799 dans le village de Rachïd (francisé en Rosette.) par les membres de l'expédition d'Egypte de Napoléon Bonaparte. Toutefois, suite à la capitulation des Français en juin 1801, les Anglais récupérèrent une importante partie des antiquités découvertes par l'équipe scientifique française. C'est ainsi que la pierre de Rosette fut envoyée en Angleterre, où les savants anglais commencèrent à tenter de la déchiffrer.
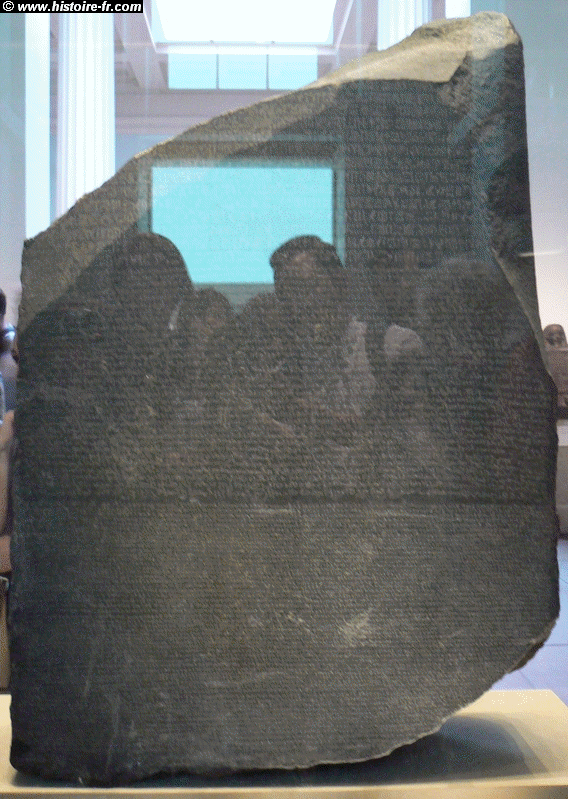
La pierre de Rosette, British museum, Londres.
A noter que la pierre de rosette était d'une importance capitale, cette dernière comprenant un décret pharaonique écrit en trois langues : en hiéroglyphes, en démotique[4], et en grec ancien[5].
Champollion, démontrant que les hiéroglyphes n'étaient pas des symboles muets (comme cela était communément admis à l'époque.) mais constituaient un véritable alphabet, prouva en 1810 que le démotique était une simplification de l'écriture hiéroglyphique.
Disgracié suite à la chute de Napoléon en raison de son orientation républicaine, Champollion fut exilé à Figeac, où il continua ses recherches sur les hiéroglyphes. Finalement, c'est en 1824 qu'il publia son Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, étant finalement parvenu à déchiffrer l'écriture des Egyptiens de l'Antiquité.
Visitant l'Egypte entre 1828 et 1830, il mourut à Paris d'une congestion cérébrale en mars 1832.
Ainsi, bien que Champollion se soit appuyé sur une copie de la pierre de Rosette afin de déchiffrer le mystère des hiéroglyphes, ce dernier ne vit jamais le document original, jalousement conservé par les Anglais dans l'enceinte du British museum (la pierre de Rosette s'y trouve encore aujourd'hui.).
[1] A noter que le terme 'hiéroglyphe' provient du grec hieroglúphos, combinaison des mots hierós (ce qui signifie 'sacré'.) et gluphein ('graver'.). Pour l'anecdote, les Egyptiens de l'Antiquité nommaient leur écriture medou-netjer, ce qui signifie 'parole divine'.
[2] Pour en savoir plus sur l'expédition d'Egypte, voir le 6, section IV, chapitre quatrième, la Révolution française.
[3] Pour en savoir plus sur le règne de Ptolémée V, voir le 5, section VIII, chapitre neuvième, histoire de l'Egypte antique.
[4] Le démotique (en grec dêmotiká, ce qui signifie 'populaire'.) est une écriture simplifiée des hiéroglyphes.
[5] Rappelons que depuis Ptolémée I°, les pharaons n'étaient plus Egyptiens mais Grecs.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les mensonges de l'Histoire
Faux !
Cléopâtre (septième du nom en réalité.), reine d’Égypte de 51 à 30 avant Jésus Christ, n’était pas Égyptienne mais grecque ! Elle appartenait à la dynastie des Lagides[1], qui étaient originaires de Macédoine.
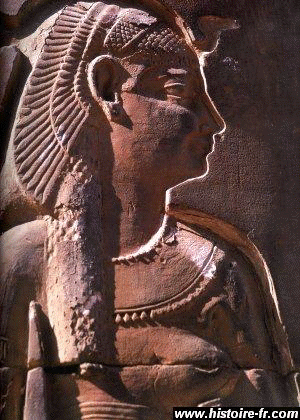
Cléopâtre VII, bas relief du temple de Kom Ombo, époque ptolémaïque (I° siècle avant Jésus Christ).
En fait, à la mort d’Alexandre le Grand[2], son Empire fut divisé entre ses généraux, les diadoques (les ‘successeurs’.), alors au nombre de 11. Son ami et peut être demi frère Ptolémée (ce dernier fut peut être engendré par Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre. Il aurait demandé à un de ses proches, Lagos, de revendiquer cette paternité.) reçut alors l’Égypte, où il y prit le titre de pharaon, sous le nom de Ptolémée I° Sôter (‘sauveur’.). Pendant 300 ans, les Lagides gouvernèrent donc le pays (le nom ‘Lagide’ provenait du nom du père de Ptolémée, qui s’appelait Lagos.).
Cléopâtre n’était donc absolument pas Égyptienne, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. A noter toutefois que cette dernière, contrairement à certains de ses prédécesseurs, était très cultivée, parlant le grec, l'égyptien, l'araméen, le mède, l'éthiopien, et peut être aussi l'hébreu. A noter qu'elle n'eut pas de mal à apprendre le latin au contact de Jules César, bien que ce dernier sache parler grec lui aussi.
[1] Pour en savoir plus sur Alexandre le Grand, cliquez ici !
[2] Pour plus de détails sur la dynastie des Lagides, cliquez ici !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les mensonges de l'Histoire
Christophe Colomb a découvert l'AmériqueFaux ! Christophe Colomb ne fut certainement pas le premier à découvrir l'Amérique! En effet, de nombreuses personnes firent le voyage avant lui, le précédant environ d'un demi millénaire...
Statuette à l'effigie de Christophe Colomb, par Charles Cordier, vers 1876, musée de la Marine, Paris.
Au IX° siècle de notre ère, les Vikings (un peuple vivant entre le Danemark, la Norvège et la Suède actuelle.) se lancèrent à l'assaut de nombreux pays d'Europe[1]. Profitant de la faiblesse du pouvoir royal en France, depuis la mort de Charlemagne, ils envahirent la Normandie; pénétrèrent en Angleterre; s'attaquèrent aux côtes de l'Espagne et de la Russie, et naviguèrent jusqu'en Sicile.
Par la suite, les vikings découvrirent l'Islande, vers l'an 860. Quelques années plus tard, l'Islandais Gunnbjorn Ulfsson découvrit qu'il existait des terres, au nord ouest de l'île.
En 980, le navigateur Eirikr Thorvaldsson, surnommé Erik le Rouge car il avait les cheveux roux, fut banni d'Islande, suite à une affaire de meurtre (il avait déjà été banni de Norvège.). Ce dernier décida alors de partir explorer ces terres inconnues, qui se trouvaient être le Groenland. Il resta trois ans dans ce pays, puis retourna en Islande afin de rechercher des colons pour occuper cette nouvelle terre. En 985, Erik put repartir vers le Groenland, accompagnée de nombreux colons. Après avoir exploré la partie est du pays, Erik décida de découvrir la partie ouest. Les deux colonies (baptisées Établissement de l'Est et Établissement de l'Ouest.) établies dans le pays furent prospères, et attirèrent des milliers d'Islandais.
Cependant, les impétueux Vikings ne purent s'empêcher de continuer à explorer. Bjarni Herjulfsson, un des compagnons d'Erik, se rendit compte vers 986 qu'il existait une terre inconnue , située au sud ouest du Groenland.
Ce sont sur ces indications que Leif Eriksson, le fils d'Erik le Rouge, décida de monter une nouvelle expédition, accompagné d'une trentaine d'hommes. Suivant le chemin indiqué, les vikings découvrirent alors de nouveaux territoires. Le premier fut baptisé Helluland (ce qui signifie 'pays de la pierre plate), en raison des glaciers qui s'y trouvaient. Leif décida de ne pas s'installer dans ces contrées inhospitalières (il s'agissait probablement de la partie nord du Labrador, au Canada.), et descendit plus au sud. Il passa alors à proximité d'un pays qu'il nomma Markland, 'le pays des forêts' (la sud du Labrador.). Enfin, arrivant près de Terre Neuve, Leif décida de débarquer, et baptisa le pays Vinland (en effet, les Vikings trouvèrent de nombreuses vignes dans cette région.).
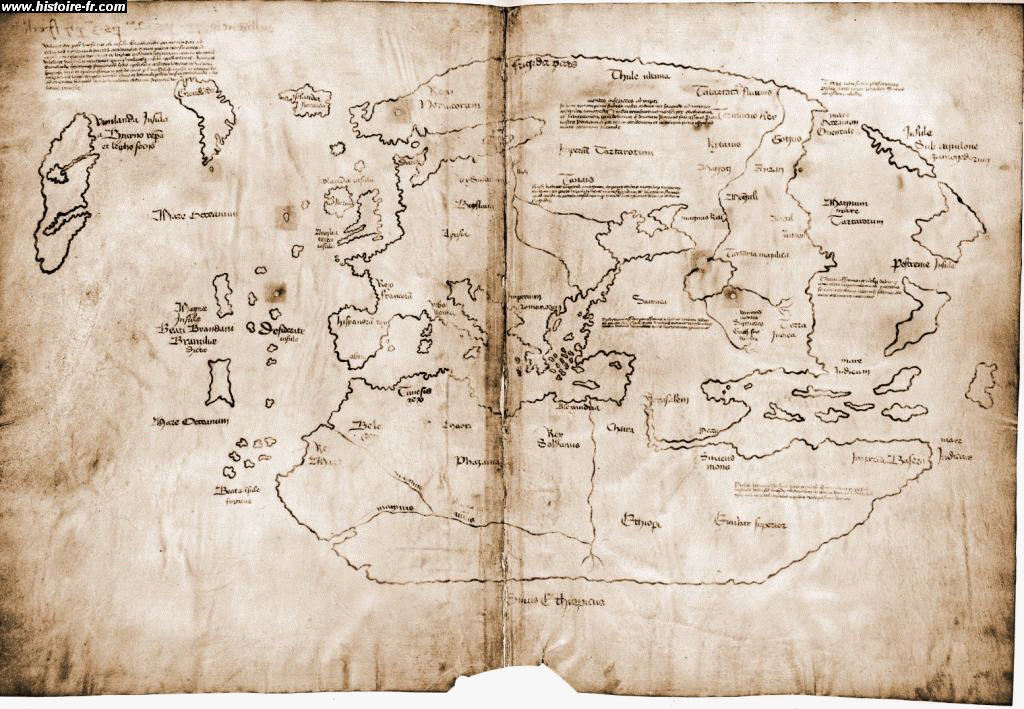
Carte du XV° siècle, dessinée à partir d'un original du XIII° siècle.
Par la suite, d'autres expéditions eurent lieu, mais elle ne portèrent pas leurs fruits. Les Vikings, attaqués par les autochtones, qu'ils nommèrent les Skraelings (ce qui signifie 'maigre, squelettique'.), ne purent continuer à coloniser la région.
Pendant longtemps, l'on pensa que le voyage de Leif en Amérique du nord n'était qu'une légende: en effet, l'aventure avait inspiré de nombreuses sagas, qui étaient évidemment trop romancées.
Puis, au XIX° siècle, l'on découvrit au Groenland, au cours de fouilles archéologiques, les restes d'habitations de type scandinave. Par la suite, au cours du XX° siècle, l'on découvrit le même type d'habitations à l'Anse aux Meadows (la pointe septentrionale de l'île de Terre Neuve.).
Cependant, les Vikings s'arrêtèrent ils à Terre Neuve, ou bien descendirent ils plus au sud? D'ailleurs, l'on pourrait même se demander pourquoi ils n'auraient pas tenté le voyage, lorsque l'on connaît l'esprit aventureux de ce peuple. Sont ils à l'origine du mythe de Quetzalcoalt, le 'dieu blanc barbu', qui imprégna les peuples précolombiens, et dont le retour devait causer leur perte? Aujourd'hui, aucune fouille archéologique ne peut étayer l'hypothèse d'un voyage vers le sud.
 votre commentaire
votre commentaire
-
J’Accuse... !
Lettre ouverte au président de la République
Lettre publiée dans le journal l’Aurore, le 13 janvier 1898
Monsieur le Président,
Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m’avez fait un jour, d’avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu’ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches ?
Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les coeurs. Vous apparaissez rayonnant dans l’apothéose de cette fête patriotique que l’alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre Exposition universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom - j’allais dire sur votre règne - que cette abominable affaire Dreyfus ! Un conseil de guerre vient, par ordre, d’oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c’est fini, la France a sur la joue cette souillure, l’histoire écrira que c’est sous votre présidence qu’un tel crime social a pu être commis.
Puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j’ai promis de la dire, si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l’innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu’il n’a pas commis.
Et c’est à vous, monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d’honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l’ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n’est à vous, le premier magistrat du pays ?
La vérité d’abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus.
Un homme néfaste a tout mené, a tout fait, c’est le colonel du Paty de Clam, alors simple commandant. Il est l’affaire Dreyfus tout entière, on ne la connaîtra que lorsqu’une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l’esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d’intrigues romanesques, se complaisant aux moyens des romans-feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent, de nuit, des preuves accablantes.
C’est lui qui imagina de dicter le bordereau à Dreyfus ; c’est lui qui rêva de l’étudier dans une pièce entièrement revêtue de glaces ; c’est lui que le commandant Forzinetti nous représente armé d’une lanterne sourde, voulant se faire introduire près de l’accusé endormi, pour projeter sur son visage un brusque flot de lumière et surprendre ainsi son crime, dans l’émoi du réveil. Et je n’ai pas à tout dire, qu’on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du Paty de Clam, chargé d’instruire l’affaire Dreyfus, comme officier judiciaire, est, dans l’ordre des dates et des responsabilités, le premier coupable de l’effroyable erreur judiciaire qui a été commise.
Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sandherr, directeur du bureau des renseignements, mort depuis de paralysie générale. Des « fuites » avaient lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujourd’hui encore ; et l’auteur du bordereau était recherché, lorsqu’un a priori se fit peu à peu que cet auteur ne pouvait être qu’un officier de l’état-major, et un officier d’artillerie : double erreur manifeste, qui montre avec quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau, car un examen raisonné démontre qu’il ne pouvait s’agir que d’un officier de troupe. On cherchait donc dans la maison, on examinait les écritures, c’était comme une affaire de famille, un traître à surprendre dans les bureaux mêmes, pour l’en expulser. Et, sans que je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le commandant du Paty de Clam entre en scène, dès qu’un premier soupçon tombe sur Dreyfus.
A partir de ce moment, c’est lui qui a inventé Dreyfus, l’affaire devient son affaire, il se fait fort de confondre le traître, de l’amener à des aveux complets. Il y a bien le ministre de la guerre, le général Mercier, dont l’intelligence semble médiocre ; il y a bien le chef de l’état-major, le général de Boisdeffre, qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l’état-major, le général Gonse, dont la conscience a pu s’accommoder de beaucoup de choses. Mais, au fond, il n’y a d’abord que le commandant du Paty de Clam, qui les mène tous, qui les hypnotise, car il s’occupe aussi de spiritisme, d’occultisme, il converse avec les esprits. On ne croira jamais les expériences auxquelles il a soumis le malheureux Dreyfus, les pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute une démence torturante.
Ah ! cette première affaire, elle est un cauchemar, pour qui la connaît dans ses détails vrais ! Le commandant du Paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que, si elle parle, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s’arrachait la chair, hurlait son innocence. Et l’instruction a été faite ainsi, comme dans une chronique du quinzième siècle, au milieu du mystère, avec une complication d’expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, ce bordereau imbécile, qui n’était pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous sans valeur.
Si j’insiste, c’est que l’oeuf est ici, d’où va sortir plus tard le vrai crime, l’épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l’erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née des machinations du commandant du Paty de Clam, comment le général Mercier, les généraux de Boisdeffre et Gonse ont pu s’y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur, qu’ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n’y a donc, de leur part, que de l’incurie et de l’inintelligence. Tout au plus, les sent-on céder aux passions religieuses du milieu et aux préjugés de l’esprit de corps. Ils ont laissé faire la sottise.
Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l’ennemi, pour conduire l’empereur allemand jusqu’à Notre-Dame, qu’on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur, on chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l’Histoire, et naturellement la nation s’incline. Il n’y a pas de châtiment assez sévère, elle applaudira à la dégradation publique, elle voudra que le coupable reste sur son rocher d’infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l’Europe en flammes, qu’on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos ? Non ! il n’y a eu, derrière, que les imaginations romanesques et démentes du commandant du Paty de Clam. Tout cela n’a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans-feuilletons. Et il suffit, pour s’en assurer, d’étudier attentivement l’acte d’accusation, lu devant le conseil de guerre.
Ah ! le néant de cet acte d’accusation ! Qu’un homme ait pu être condamné sur cet acte, c’est un prodige d’iniquité. Je défie les honnêtes gens de le lire, sans que leur coeur bondisse d’indignation et crie leur révolte, en pensant à l’expiation démesurée, là-bas, à l’île du Diable. Dreyfus sait plusieurs langues, crime ; on n’a trouvé chez lui aucun papier compromettant, crime ; il va parfois dans son pays d’origine, crime ; il est laborieux, il a le souci de tout savoir, crime ; il ne se trouble pas, crime ; il se trouble, crime. Et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide ! On nous avait parlé de quatorze chefs d’accusation : nous n’en trouvons qu’une seule en fin de compte, celle du bordereau ; et nous apprenons même que, les experts n’étaient pas d’accord, qu’un d’eux, M. Gobert, a été bousculé militairement, parce qu’il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi de vingt-trois officiers qui étaient venus accabler Dreyfus de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne l’avaient pas chargé ; et il est à remarquer, en outre, que tous appartenaient aux bureaux de la guerre. C’est un procès de famille, on est là entre soi, et il faut s’en souvenir : l’état-major a voulu le procès, l’a jugé, et il vient de le juger une seconde fois.
Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts ne s’étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre du conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et, dès lors, comme l’on comprend l’obstination désespérée avec laquelle, pour justifier la condamnation, on affirme aujourd’hui l’existence d’une pièce secrète, accablante, la pièce qu’on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon dieu invisible et inconnaissable. Je la nie, cette pièce, je la nie de toute ma puissance ! Une pièce ridicule, oui, peut-être la pièce où il est question de petites femmes, et où il est parlé d’un certain D... qui devient trop exigeant, quelque mari sans doute trouvant qu’on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressant la défense nationale, qu’on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain, non, non ! C’est un mensonge ; et cela est d’autant plus odieux et cynique qu’ils mentent impunément sans qu’on puisse les en convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les coeurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique.
Voilà donc, monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise ; et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus, l’absence de motifs, son continuel cri d’innocence, achèvent de le montrer comme une victime des extraordinaires imaginations du commandant du Paty de Clam, du milieu clérical où il se trouvait, de la chasse aux « sales juifs », qui déshonore notre époque.
Et nous arrivons à l’affaire Esterhazy. Trois ans se sont passés, beaucoup de consciences restent troublées profondément, s’inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l’innocence de Dreyfus.
Je ne ferai pas l’historique des doutes, puis de la conviction de M. Scheuter-Kestner. Mais, pendant qu’il fouillait de son côté, il se passait des faits graves à l’état-major même. Le colonel Sandherr était mort, et le lieutenant-colonel Picquart lui avait succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c’est à ce titre, dans l’exercice de ses fonctions, que ce dernier eut un jour entre les mains une lettre-télégramme, adressée au commandant Esterhazy, par un agent d’une puissance étrangère. Son devoir strict était d’ouvrir une enquête. La certitude est qu’il n’a jamais agi en dehors de la volonté de ses supérieurs. Il soumit donc ses soupçons à ses supérieurs hiérarchiques, le général Gonse, puis le général de Boisdeffre, puis le général Billot, qui avait succédé au général Mercier comme ministre de la guerre.
Le fameux dossier Picquart, dont il a été tant parlé, n’a jamais été que le dossier Billot, j’entends le dossier fait par un subordonné pour son ministre, le dossier qui doit exister encore au ministère de la guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896, et ce qu’il faut affirmer bien haut, c’est que le général Gonse était convaincu de la culpabilité d’Esterhazy, c’est que le général de Boisdeffre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le fameux bordereau fût de l’écriture d’Esterhazy. L’enquête du lieutenant-colonel Picquart avait abouti à cette constatation certaine. Mais l’émoi était grand, car la condamnation d’Esterhazy entraînait inévitablement la révision du procès Dreyfus ; et c’était ce que l’état-major ne voulait à aucun prix.
Il dut y avoir là une minute psychologique pleine d’angoisse. Remarquez que le général Billot n’était compromis dans rien, il arrivait tout frais, il pouvait faire la vérité. Il n’osa pas, dans la terreur sans doute de l’opinion publique, certainement aussi dans la crainte de livrer tout l’état-major, le général de Boisdeffre, le général Gonse, sans compter les sous-ordres. Puis, ce ne fut là qu’une minute de combat entre sa conscience et ce qu’il croyait être l’intérêt militaire. Quand cette minute fut passée, il était déjà trop tard. Il s’était engagé, il était compromis. Et, depuis lors, sa responsabilité n’a fait que grandir, il a pris à sa charge le crime des autres, il est aussi coupable que les autres, il est plus coupable gueux, car il a été le maître de faire justice, et il n’a rien fait. Comprenez-vous cela ! voici un an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et Gonse savent que Dreyfus est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose ! Et ces gens-là dorment, et ils ont des femmes et des enfants qu’ils aiment !
Le colonel Picquart avait rempli son devoir d’honnête homme. Il insistait auprès de ses supérieurs, au nom de la justice. Il les suppliait même, il leur disait combien leurs délais étaient impolitiques, devant le terrible orage qui s’amoncelait, qui devait éclater, lorsque la vérité serait connue. Ce fut, plus tard, le langage que M. Scheurer-Kestner tint également au général Billot, l’adjurant par patriotisme de prendre en main l’affaire, de ne pas la laisser s’aggraver, au point de devenir un désastre public. Non ! le crime était commis, l’état-major ne pouvait plus avouer son crime. Et le lieutenant-colonel Picquart fut envoyé en mission, on l’éloigna de plus loin en plus loin, jusqu’en Tunisie, où l’on voulut même un jour honorer sa bravoure en le chargeant d’une mission qui l’aurait sûrement fait massacrer, dans les parages où le marquis de Morès a trouvé la mort. Il n’était pas en disgrâce, le général Gonse entretenait avec lui une correspondance amicale. Seulement, il est des secrets qu’il ne fait pas bon d’avoir surpris.
A Paris, la vérité marchait, irrésistible, et l’on sait de quelle façon l’orage attendu éclata. M. Mathieu Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy comme le véritable auteur du bordereau, au moment où M. Scheurer-Kestner allait déposer, entre les mains du garde des sceaux, une demande en révision du procès. Et c’est ici que le commandant Esterhazy paraît. Des témoignages le montrent d’abord affolé, prêt au suicide ou à la fuite. Puis, tout d’un coup, il paye d’audace, il étonne Paris par la violence de son attitude. C’est que du secours lui était venu, il avait reçu une lettre anonyme l’avertissant des menées de ses ennemis, une dame mystérieuse s’était même dérangée de nuit pour lui remette une pièce volée à l’état-major, qui devait le sauver.
Et je ne puis m’empêcher de retrouver là le lieutenant-colonel du Paty de Clam en reconnaissant les expédients de son imagination fertile. Son oeuvre, la culpabilité de Dreyfus était en péril, et il a voulu sûrement défendre son oeuvre. La révision du procès, mais c’était l’écroulement du roman-feuilleton si extravagant, si tragique, dont le dénouement abominable a lieu à l’île du Diable ! C’est ce qu’il ne pouvait permettre. Dès lors, le duel va avoir lieu entre le lieutenant-colonel Picquart et le lieutenant-colonel du Paty de Clam, l’un le visage découvert, l’autre masqué. On les retrouvera prochainement tous deux devant la justice civile. Au fond, c’est toujours l’état-major qui se défend, qui ne veut pas avouer son crime, dont l’abomination grandit d’heure en heure.
On s’est demandé avec stupeur quels étaient les protecteurs du commandant Esterhazy. C’est d’abord, dans l’ombre, le lieutenant-colonel du Paty de Clam qui a tout machiné, qui a tout conduit. Sa main se trahit aux moyens saugrenus. Puis, c’est le général de Boisdeffre, c’est le général Gonse, c’est le général Billot lui-même, qui sont bien obligés de faire acquitter le commandant, puisqu’ils ne peuvent laisser reconnaître l’innocence de Dreyfus, sans que les bureaux de la guerre croulent dans le mépris public. Et le beau résultat de cette situation prodigieuse est que l’honnête homme, là-dedans, le lieutenant-colonel Picquart, qui seul a fait son devoir, va être la victime, celui qu’on bafouera et qu’on punira. O justice, quelle affreuse désespérance serre le coeur ! On va jusqu’à dire que c’est lui le faussaire, qu’il a fabriqué la carte-télégramme pour perdre Esterhazy. Mais, grand Dieu ! pourquoi ? dans quel but ? Donnez un motif. Est-ce que celui-là aussi est payé par les juifs ? Le joli de l’histoire est qu’il était justement antisémite. Oui ! nous assistons à ce spectacle infâme, des hommes perdus de dettes et de crimes dont on proclame l’innocence, tandis qu’on frappe l’honneur même, un homme à la vie sans tache ! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition.
Voilà donc, monsieur le Président, l’affaire Esterhazy : un coupable qu’il s’agissait d’innocenter. Depuis bientôt deux mois, nous pouvons suivre heure par heure la belle besogne. J’abrège, car ce n’est ici, en gros, que le résumé de l’histoire dont les brûlantes pages seront un jour écrites tout au long. Et nous avons donc vu le général de Pellieux, puis le commandant Ravary, conduire une enquête scélérate d’où les coquins sortent transfigurés et les honnêtes gens salis. Puis, on a convoqué le conseil de guerre.
Comment a-t-on pu espérer qu’un conseil de guerre déferait ce qu’un conseil de guerre avait fait ? Je ne parle même pas du choix toujours possible des juges. L’idée supérieure de discipline, qui est dans le sang de ces soldats, ne suffit-elle à infirmer leur pouvoir même d’équité ? . Qui dit discipline dit obéissance. Lorsque le ministre de la guerre, le grand chef a établi publiquement, aux acclamations de la représentation nationale, l’autorité absolue de la chose jugée, vous voulez qu’un conseil de guerre lui donne un formel démenti ? Hiérarchiquement, cela est impossible. Le général Billot a suggestionné les juges par sa déclaration, et ils ont jugé comme ils doivent aller au feu, sans raisonner. L’opinion préconçue qu’ils ont apportée sur leur siège, est évidemment celle-ci : « Dreyfus a été condamné pour crime de trahison par un conseil de guerre ; il est donc coupable, et nous, conseil de guerre, nous ne pouvons le déclarer innocent : or nous savons que reconnaître la culpabilité d’Esterhazy, ce serait proclamer l’innocence de Dreyfus. » Rien ne pouvait les faire sortir de là.
Ils ont rendu une sentence inique, qui à jamais pèsera sur nos conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous leurs arrêts. Le premier conseil de guerre a pu être inintelligent, le second est forcément criminel. Son excuse, je le répète, est que le chef suprême avait parlé, déclarant la chose jugée inattaquable, sainte et supérieure aux hommes, de sorte que des inférieurs ne pouvaient dire le contraire. On nous parle de l’honneur de l’armée, on veut que nous l’aimions, que nous la respections. Ah ! certes, oui, l’armée qui se lèverait à la première menace, qui défendrait la terre française, elle est tout le peuple et nous n’avons pour elle que tendresse et respect. Mais il ne s’agit pas d’elle, dont nous voulons justement la dignité, dans notre besoin de justice. Il s’agit du sabre, le maître qu’on nous donnera demain peut-être. Et baiser dévotement la poignée du sabre, le dieu, non !
Je l’ai démontré d’autre part : l’affaire Dreyfus était l’affaire des bureaux de la guerre, un officier de l’état-major, dénoncé par ses camarades de l’état-major, condamné sous la pression des chefs de l’état-major. Encore une fois, il ne peut revenir innocent sans que tout l’état-major soit coupable. Aussi les bureaux, par tous les moyens imaginables, par des campagnes de presse, par des communications, par des influences, n’ont-ils couvert Esterhazy que pour perdre une seconde fois Dreyfus. Quel coup de balai le gouvernement républicain devrait donner dans cette jésuitière, ainsi que les appelle le général Billot lui-même ! Où est-il, le ministère vraiment fort et d’un patriotisme sage, qui osera tout y refondre et tout y renouveler ?
Que de gens je connais qui, devant une guerre possible, tremblent d’angoisse, en sachant dans quelles mains est la défense nationale ! et quel nid de basses intrigues, de commérages et de dilapidations, est devenu cet asile sacré, où se décide le sort de la patrie ! On s’épouvante devant le jour terrible que vient d’y jeter l’affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d’un malheureux, d’un « sale juif » ! Ah ! tout ce qui s’est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des moeurs d’inquisition et de tyrannies, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d’Etat !
Et c’est un crime encore que de s’être appuyé sur la presse immonde, que de s’être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment, dans la défaite du droit et de la simple probité. C’est un crime d’avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes, lorsqu’on ourdit soi-même l’impudent complot d’imposer l’erreur, devant le monde entier. C’est un crime d’égarer l’opinion, d’utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu’on a pervertie jusqu’à la faire délirer. C’est un crime d’empoisonner les petits et les humbles, d’exaspérer les passions de réaction et d’intolérance, en s’abritant derrière l’odieux antisémitisme, dont la grande France libérale des droits de l’homme mourra, si elle n’en est pas guérie. C’est un crime que d’exploiter le patriotisme pour des oeuvres de haine, et c’est un crime, enfin, que de faire du sabre le dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au travail pour l’oeuvre prochaine de vérité et de justice.
Cette vérité, cette justice, que nous avons si passionnément voulues, quelle détresse à les voir ainsi souffletées, plus méconnues et plus obscurcies ! Je me doute de l’écroulement qui doit avoir lieu dans l’âme de M. Scheurer-Kestner, et je crois bien qu’il finira par éprouver un remords, celui de n’avoir pas agi révolutionnairement, le jour de l’interpellation au Sénat, en lâchant tout le paquet, pour tout jeter à bas. Il a été le grand honnête homme, l’homme de sa vie loyale, il a cru que la vérité se suffisait à elle-même, surtout lorsqu’elle lui apparaissait éclatante comme le plein jour. A quoi bon tout bouleverser, puisque bientôt le soleil allait luire ? Et c’est de cette sérénité confiante dont il est si cruellement puni.
De même pour le lieutenant-colonel Picquart, qui, par un sentiment de haute dignité, n’a pas voulu publier les lettres du général Gonse. Ces scrupules l’honorent d’autant plus que, pendant qu’il restait respectueux de la discipline, ses supérieurs le faisaient couvrir de boue, instruisaient eux-mêmes son procès, de la façon la plus inattendue et la plus outrageante. Il y a deux victimes, deux braves gens, deux coeurs simples, qui ont laissé faire Dieu, tandis que le diable agissait. Et l’on a même vu, pour le lieutenant colonel Picquart, cette chose ignoble : un tribunal français, après avoir laissé le rapporteur charger publiquement un témoin, l’accuser de toutes les fautes, a fait le huis clos, lorsque ce témoin a été introduit pour s’expliquer et se défendre. Je dis que cela est un crime de plus et que ce crime soulèvera la conscience universelle. Décidément, les tribunaux militaires se font une singulière idée de la justice.
Telle est donc la simple vérité, monsieur le Président, et elle est effroyable, elle restera pour votre présidence une souillure. Je me doute bien que vous n’avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre entourage. Vous n’en avez pas moins un devoir d’homme, auquel vous songerez, et que vous remplirez. Ce n’est pas, d’ailleurs, que je désespère le moins du monde du triomphe. Je le répète avec une certitude plus véhémente : la vérité est en marche et rien ne l’arrêtera. C’est aujourd’hui seulement que l’affaire commence, puisque aujourd’hui seulement les positions sont nettes : d’une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse ; de l’autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu’elle soit faite. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s’y amasse, elle y prend une force telle d’explosion que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l’on ne vient pas de préparer, pour plus tard, le plus retentissant des désastres.
Mais cette lettre est longue, monsieur le Président, et il est temps de conclure.
-
J’accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d’avoir été l’ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d’avoir ensuite défendu son oeuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables.
-
J’accuse le général Mercier de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des plus grandes iniquités du siècle.
-
J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves de l’innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s’être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique, et pour sauver l’état-major compromis.
-
J’accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s’être rendus complices du même crime, l’un sans doute par passion cléricale, l’autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l’arche sainte, inattaquable.
-
J’accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d’avoir fait une enquête scélérate, j’entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace.
-
J’accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d’avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la vue et du jugement.
-
J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse, particulièrement dans L’Eclair et dans L’Echo de Paris, une campagne abominable, pour égarer l’opinion et couvrir leur faute.
-
J’accuse enfin le premier conseil de guerre d’avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j’accuse le second conseil de guerre d’avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d’acquitter sciemment un coupable.
En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose.
Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice.
Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour !
J’attends.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect.
EMILE ZOLA
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
-
Dona Rodrigue