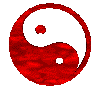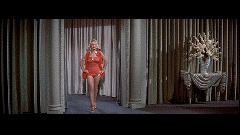-
La guerre de Cent Ans
Introduction
La guerre de Cent Ans est l'un des plus célèbres conflits du Moyen Âge. Elle oppose les rois de France de la dynastie des Valois aux rois d'Angleterre pour la possession du royaume de France. Le conflit peut se diviser en deux périodes au cours desquelles le trône de France est sur le point de basculer sous la tutelle anglaise, avant d'observer une reconquête quasi-totale. A chacune de ces périodes, une figure emblématique, un héros, incarne le sursaut français :- La première période du conflit voit l'Angleterre victorieuse à Crécy et à Poitiers où le roi de France est capturé. Le sursaut français s'effectue grâce au connétable Bertrand du Guesclin et à son roi Charles V.
- La seconde période du conflit voit naître une guerre civile : les Armagnacs contre les Bourguignons. Cette lutte favorise l'Angleterre, victorieuse à Azincourt. Le trône est alors promis au roi d'Angleterre. C'est Jeanne d'Arc qui permettra le réveil des forces françaises et leur course vers la victoire.

L'origine de la Guerre
Un siècle de lutte entre Français et AnglaisLa longue période de lutte entre la France et l'Angleterre, qui est connue sous le nom de guerre de Cent Ans, ne fut pas exactement une guerre, et dura bien plus de cent ans (116 ans : de 1337 à 1453). Cinq rois de France et autant de souverains anglais se trouvèrent successivement engagés dans ce duel. Trois générations entières vécurent dans un perpétuel climat de troubles et de combats.La guerre de Cent Ans se décompose en une série de batailles, séparés par des périodes de paix relative, ou de trêves. Et quand cessaient les combats, les pillages, la famine ou la peste achevaient de ruiner villes et campagnes. Si l'Angleterre ne fut pas épargnée par cette guerre, la France, sur le sol de laquelle se déroulèrent les batailles, fut plus atteinte que sa rivale. Elle finit cependant par avoir le dessus. Mais les deux belligérants sortirent profondément changés de ce conflit séculaire.Les souverains protagonistes France Angleterre - Edouard III (Plantagenêt)
- Richard II (Plantagenêt)
- Henri IV (Lancastre)
- Henri V (Lancastre)
- Henri VI (Lancastre)
Cliquer sur les noms en bleu

Charles IV Le Bel
Les trois prétendants
A la mort de Charles IV le Bel, dernier des Capétiens directs, trois prétendants ont des droits équivalents à la couronne :- Philippe, comte de Valois : Fils de Charles de Valois, frère cadet de Philippe le Bel. Philippe constitue l'un des chef de file de la féodalité française. Son père aura été très influent au cours des règnes de ses neveux. A la mort de Charles IV, il devient le Régent du royaume, ce qui lui donne un sérieux avantage pour la suite.
- Edouard III d'Angleterre : Fils d'Edouard II et d' Isabelle de France, Edouard III est donc le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère. Mais il est difficile de mettre un noble anglais sur le trône de France, et pourtant à cette époque, la cour anglaise parle le français, héritage de la conquête normande de Guillaume le Conquérant.
- Philippe d'Evreux : Petit-fils de Philippe III, il a épousé sa cousine Jeanne de Navarre (fille de Louis X). Il est donc devenu roi de Navarre, et revendique la couronne selon les droits de sa femme. Philippe d'Evreux est le père de Charles le Mauvais.

Philippe VI : roi de France
Ce sont les pairs de France qui élisent Philippe de Valois roi de France. Celui-ci a l'avantage d'être ni Anglais ni Navarrais. Pour écarter les deux autres prétendants, on a invoqué la loi salique, cette vieille loi franque qui interdit la transmission de la couronne par les femmes. On a exhibé un vieux document pour le prouver, mais la légitimité du nouveau roi est fragile. Si Edouard III accepte plutôt bien son éviction, il n'en est pas de même pour le roi de Navarre. Le fils de Jeanne de Navarre, Charles le Mauvais n'acceptera jamais son expulsion et tentera par tous les moyens de nuire aux Valois. Dès son accession au trône, Philippe tente donc d'affirmer son autorité, il s'empresse d'aller écraser l'armée flamande, insurgée contre leur comte Louis de Nevers, sur le mont Cassel en 1328. Philippe a ensuite rappelé au roi d'Angleterre qu'il lui devait l'hommage pour ses possessions en Guyenne. En effet, le roi d'Angleterre possède toujours une partie de l'Aquitaine, et il est donc vassal direct du roi de France. C'est chose faite à la cathédrale d'Amiens en 1329.
La vraie cause de l'antagonisme
L'hommage prêté par le souverain anglais au roi de France montre bien que le conflit de succession n'est qu'un prétexte pour la guerre. Edouard III souhaite juste conserver ses possessions en Aquitaine. Et lorsque Philippe voulut mettre la main sur le duché de Guyenne, dernier fief du roi d'Angleterre en France, Edouard III déclencha la guerre. A l'origine du conflit, il s'agissait surtout d'étendre le domaine royal, ou, pour Edouard, de maintenir ses positions. Philippe prend Bordeaux en 1337, il est bientôt appuyé par le comte de Flandre. Edouard III réagit tout de suite en mettant l'embargo sur l'exportation de la laine anglaise qui permet aux flamands de tirer leur richesse (les draps flamands sont vendus dans toute l'Europe). Bientôt, c'est une nouvelle révolte de la Flandre, les insurgés de Gand se rangent du côté du roi anglais. Puis, de Wetminster, Edouard défie publiquement Philippe.Quelques mois plus tard avec ses alliés flamands, Edouard prend publiquement le titre de roi de France. En 1339, premiers combats, Edouard ravage la campagne de Thiérache. La suite des opérations anglaises ne donne rien sur terre, mais sur mer, la flotte française de l'Écluse est écrasée. En 1340, les deux souverains signent une trêve, prolongée jusqu'en 1345.
La guerre de succession de Bretagne (1341 - 1364)
Dès 1341, un autre conflit va opposer indirectement Français et Anglais. Une guerre fait rage pour la succession au duché de Bretagne après la mort du duc Jean III. Cette guerre est aussi appelée « guerre des Deux-Jeanne » Deux clans s'affrontent :- Celui des partisans de Charles de Blois et de sa femme Jeanne de Penthièvre (nièce de Jean III), qui ont le soutien du roi de France Philippe VI.
- Celui de Jean de Montfort (frère de Jean III) et de son épouse Jeanne de Flandres, qui, après avoir pris possession de la quasi-totalité du duché, s'en alla quérir l'alliance d'Edouard III.

Le marasme français
La bataille de Crécy
En 1346, les hostilités reprennent entre Français et Anglais. Edouard III débarque dans le Cotentin, il envahit la Normandie et marche sur Paris. Impressionné par l'armée que vient de lever Philippe VI, il se replie sur la Somme et campe à Crécy pour reposer ses troupes et faire le plein de vivres. Mais le roi de France le poursuit avec opiniâtreté. Ce dernier s'arrête à Abbeville où des renforts lui parviennent. Le 26 août, l'armée anglaise, fraîchement reposée, attend les Français sur les hauteurs. Edouard III a organisé ses troupes habilement afin de les tenir prêtes à riposter à l'attaque de la cavalerie française : ses archers sont placés de telle façon que chaque groupe est couvert par un autre. Derrière eux, les chariots contenant la réserve de flèches ont été disposés en arc de cercle protégeant ainsi chevaux et cavaliers. Côté français, c'est l'anarchie. L'armée a quitté Abbeville tôt le matin ; très sûre de ses forces, elle pense venir à bout très facilement de l'ennemi et l'organisation laisse à désirer. Soudain, les Anglais sont en vue ! A cette annonce, le roi de France tente de rassembler ses troupes, en vain ; il est déjà trop tard. L'arrière-garde essayant de rejoindre l'avant-garde, le désordre est tel qu'on ne distingue même plus les bannières les unes des autres. Cependant, trois groupes se forment finalement : les arbalétriers génois, les hommes du comte d'Alençon et enfin les hommes du roi. Un violent orage éclate, rendant le terrain boueux et impraticable.Dans une telle situation, comment diable recharger les arbalètes ? Les hommes sont de plus fatigués de leur marche, rappelons qu'armes et carreaux pèsent jusqu'à 40kg. Néanmoins, les voici qui s'avancent. Ils sont reçus par de denses volées de flèches, si drues que « ce semblait neige », dira Froissart. Les hommes s'enfuient de tous côtés, gênant les soldats. Le roi est furieux. Ordre est donné aux cavaliers de tuer cette piétaille en fuite et d'attaquer ! Les chevaliers se battent bravement, certes, mais en pure perte. Le roi lui-même se jette dans la mêlée, et voit deux chevaux mourir sous lui. A la nuit tombante, tout est terminé, la victoire anglaise est aussi imprévue qu'éclatante.
L'armée a quitté Abbeville tôt le matin ; très sûre de ses forces, elle pense venir à bout très facilement de l'ennemi et l'organisation laisse à désirer. Soudain, les Anglais sont en vue ! A cette annonce, le roi de France tente de rassembler ses troupes, en vain ; il est déjà trop tard. L'arrière-garde essayant de rejoindre l'avant-garde, le désordre est tel qu'on ne distingue même plus les bannières les unes des autres. Cependant, trois groupes se forment finalement : les arbalétriers génois, les hommes du comte d'Alençon et enfin les hommes du roi. Un violent orage éclate, rendant le terrain boueux et impraticable.Dans une telle situation, comment diable recharger les arbalètes ? Les hommes sont de plus fatigués de leur marche, rappelons qu'armes et carreaux pèsent jusqu'à 40kg. Néanmoins, les voici qui s'avancent. Ils sont reçus par de denses volées de flèches, si drues que « ce semblait neige », dira Froissart. Les hommes s'enfuient de tous côtés, gênant les soldats. Le roi est furieux. Ordre est donné aux cavaliers de tuer cette piétaille en fuite et d'attaquer ! Les chevaliers se battent bravement, certes, mais en pure perte. Le roi lui-même se jette dans la mêlée, et voit deux chevaux mourir sous lui. A la nuit tombante, tout est terminé, la victoire anglaise est aussi imprévue qu'éclatante.Crécy en chiffres
- Forces en présence :
- France : 36 000 hommes dont 15 000 mercenaires génois (arbalétriers)
- Angleterre : 12 000 hommes dont 7 000 archers
- Pertes françaises :
- 11 princes dont Charles, comte d'Alençon, frère du roi et Jean de Luxembourg, roi de Bohème
- 1 250 chevaliers
- 15 000 hommes d'armes dont 6 000 Génois
- Flèches anglaises tirées :
- Plus de 500 000 !
La défaite de Crécy
Crécy marque un tournant dans la stratégie de guerre : les bombardes faisaient leur apparition pour la première fois dans une bataille rangée. Pas très efficace du fait de leur portée limitée, elles effrayèrent néanmoins les troupes françaises et leurs chevaux, contribuant ainsi au désordre affligeant de l'armée française. La chevalerie entre en déclin, les chevaliers sont battus par l'infanterie.(Bibliothèque nationale de France) La Grande Peste
En plus de la guerre, un terrible fléau, la peste, s'abattit sur la France et sur l'Europe tout entière. Venue d'Orient, plus précisément des hauts plateaux d'Iran, où elle existait à l'état endémique, elle fut propagée par un certain type de rat et se répandit comme une traînée de poudre en 1347. La raison essentielle de cette propagation fut la surpopulation des principaux pays d'Europe, ce qui, venant après de grandes disettes, accrut la vulnérabilité de la population. Les habitants des villes et les communautés religieuses, à cause de leur concentration, furent particulièrement touchés.La peste gagna l'Italie, le sud de la France, l'Espagne et atteignit en 1349 l'Allemagne, l'Europe centrale et l'Angleterre. On posa la question : qui était responsable de ce cataclysme ? Certains trouvèrent des boucs émissaires : les Juifs.LES POGROMSAccusés de répandre volontairement la contagion, ils furent massacrés ou brûlés part milliers; des bûchers furent élevés à Strasbourg, Mayence, Spire, Worms.Le pape en vint à menacer d'excommunication ceux qui persécutaient les Juifs. D'autres virent dans la peste le châtiment de Dieu et incitèrent à expier les fautes commises. Lorsqu'elle disparut vers le milieu du siècle, elle avait emporté un tiers de la population.La peste noire
La peste s'abattit sur la France en 1348, elle y est arrivée par les navires marchands venus d'Orient. Comme on ne connaissait pas les causes du mal, on ne soignait pas les malades et on n'ensevelissait pas les morts, ce qui favorisait la contagion.

Jean Le Bon
De nouvelles défaites
Après la prise de Crécy, Edouard vient mettre le siège devant Calais. Après des mois de sièges, six bourgeois de la ville, tête et pieds nus, en chemise et la corde au cou, se rendirent devant le roi d'Angleterre afin de remettre leurs vies et la clef de la ville entre ses mains. Ils parvinrent ainsi à éviter la destruction de Calais et eurent la vie sauve grâce à l'intervention de la reine Philippa de Hainaut. C'est un succès pour l'Angleterre, une tête de pont permanente est ainsi créée, destinée à demeurer anglaise jusqu'en 1558. En 1350, Philippe VI meurt, son fils Jean le Bon lui succède. Très vite, le nouveau roi doit faire face aux intrigues de Charles le Mauvais, le roi de Navarre, celui-ci n'hésite pas à comploter des assassinats et des alliances avec l'Angleterre. Jean II le Bonfinit par le capturer à Rouen, mais les partisans du roi de Navarre tiennent toujours la Normandie. Profitant de ce conflit, les Anglais lancent deux chevauchées :- L'une part de Bretagne sous Henri de Lancastre (futur roi d'Angleterre).
- L'autre part de Guyenne sous le fils du roi Edouard, le prince de Galles. Surnommé le Prince Noir en raison de son armure, il mène des expéditions sanglantes dans la campagne française. Les Anglais pillent les villages et les bourgs.
La bataille de Poitiers
Face aux chevauchées du Prince NoirJean le Bon ne peut réagir car il manque d'argent. Il réunit les états généraux en 1356 afin de lever une armée. Pour poursuivre les Anglais efficacement, il ne garde que les cavaliers, plus rapides. Le combat se déroulera au sud de Poitiers, sur un terrain accidenté et coupé de haies, Jean II le Bon décida que le combat se ferait à pied. Croyant à une fuite des Anglais, les Français s'engagent dans un chemin bordé de haies, devenant ainsi une proie facile pour les archers anglais. Par la suite, les deux corps de batailles s'engagent dans le désordre. La bataille tourne rapidement à l'avantage du Prince Noir. Sentant la défaite s'approcher, Jean le Bon décide d'envoyer ses trois fils aîné vers Chauvigny. Seul le cadet Philippe le Hardi (futur duc de Bourgogne), 14 ans, reste au côté de son père en lui recommandant ces célèbres paroles :« Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche ! »Mais le roi est rapidement cerné, et même capturé par l'ennemi. La défaite est désastreuse, dix ans après Crécy, le royaume est plongé dans la plus grave crise de son histoire. En l'absence du roi, les états généraux de langue d'oil (états du nord) se réunissent sans attendre et décident de libérer Charles le Mauvais dans l'espoir qu'il protège le pays dans la défaite. Mais le perfide Navarrais entre en contact avec les Anglais pour s'approprier de nouveaux fiefs.
Capture de Jean II le Bon
Emeutes urbaines et jacqueries
- Emeutes urbaines : Pendant ce temps à Paris, la bourgeoisie s'insurge contre la noblesse et le dauphin, le futur Charles V. Sous la conduite d' Étienne Marcel, prévôt des marchands (charge qui en faisait une sorte de maire de Paris), ils réclament l'abolition de certains privilèges et le contrôle des impôts. En fait, Etienne Marcel rêve de rendre sa ville autonome, à l'image de certaines villes flamandes ou italiennes. Un jour de 1358, il fait irruption dans la chambre du dauphin, faisant assassiner ses maréchaux devant lui. Le pauvre dauphin de 18 ans est infirme et incapable de porter une épée. Il est bientôt contraint de porter un chaperon aux couleurs rouge et bleu de la ville. Mais le dauphin parvient à s'échapper de façon rocambolesque, et fait bientôt le siège de Paris avec ses troupes. Alors qu'il s'apprêtait à donner les clefs de la ville à Charles le Mauvais, Etienne Marcel est assassiné.
- L'héritier du trône peut alors faire son entrée triomphale dans la capitale. Plus tard, il fera ériger la Bastille pour tenir en respect les turbulents Parisiens.
- La Jacquerie : Dans les campagnes, l'exaspération due à l'impopularité de la noblesse après la défaite de Poitiers et à la misère entraînée par la guerre et la peste provoqua une explosion.
- Les Jacques (du surnom de Jacques Bonhomme que les maîtres donnaient à leurs serviteurs) incendièrent les châteaux et menacèrent les seigneurs. La répression, notamment dans la région de Beauvais et de Meaux, fut terrible, et des milliers de paysans furent massacrés.

Assassinat d'Étienne Marcel
Le sursaut français
Le difficile relèvement de la France
Emprisonné dans la Tour de Londres, Jean le Bon a promis à son geôlier, Édouard III, une rançon de 4 millions d'écus d'or en échange de sa libération ainsi que toutes les possessions des Plantagenêt. Mais le dauphin Charles, auréolé de sa victoire face aux bourgeois parisiens, ne l'entend pas de cette oreille. Edouard III tente alors un nouveau débarquement visant à le faire sacrer à Reims. Epuisés par de longs sièges, les Anglais sont contraints de se retirer du territoire. Le traité de Brétigny est signé en 1360, les Anglais y gagnent de nouvelles possessions en France.Le roi Jean le Bon est libéré, mais il se rend prisonnier volontaire quelques mois plus tard : son fils Louis d'Anjou qui était utilisé comme otage s'était enfui pour rejoindre son épouse. Finalement Jean II meurt en captivité en 1364. Charles V, dit le Sage, monté sur le trône, fut l'artisan du relèvement de la France. Cultivé, collectionneur de manuscrits rares et d'œuvres d'art, aimant s'entourer d'écrivains, de peintres, de musiciens, il fit reconstruire le Louvre et y fonda la bibliothèque royale.Grand travailleur, il sut s'entourer de bons ministres. Grâce à un nouvel impôt sur le sel, la gabelle, il rétablit les finances de la couronne. Tirant avec intelligence les leçons de l'échec de Poitiers, il réorganisa l'armée : finies les cavalcades épiques des barons féodaux ! Désormais, une milice permanente procédant par opérations de guérilla plutôt que par meurtriers engagements frontaux formerait l'élément de base.
La naissance du franc
Après avoir payé une partie de sa rançon, Jean le Bon sort de captivité. En 1360, il crée le franc, pour commémorer sa libération (franc = affranchi). Cette monnaie vient compléter l'écu d'or de Saint Louis et la livre tournois en argent. La pièce de 1360 représente le roi à cheval, une seconde édition en 1365 représentera le roi à pied (le « franc à pied »).Bertrand du Guesclin, connétable de France
Bertrand du Guesclin est né près de Rennes en 1320. Mat de peau, presque noir, le bébé était paraît-il si laid que son père ne voulut le reconnaître. Bousculé, battu du fait de sa laideur, Bertrand rendit dès qu'il put coup sur coup. Un jour, l'enfant s'insurgea contre ses frères et renversa une longue table, une religieuse orientale le calma et lui prédit qu'il serait un jour le Chef des chefs et que les Lys s'inclineront devant lui. Plus tard, lors d'un tournoi où il a interdiction de participer, il défait tous ses adversaires, avant de refuser de combattre son père. Il se forgea ainsi une force de caractère et un corps d'athlète qui l'amènerait à la plus haute dignité du royaume après le roi. En effet, en 1370, Charles V remet à Bertrand du Guesclin l'épée de connétable de France (chef des armées).Jusqu'à cette date, le fier Breton était à la tête d'une bande de paysans qu'il avait entraînés lui-même à se battre selon les principes de la « guérilla » : la hache pendue au cou, il s'agissait d'harceler les Anglais, vils occupant de sa terre bretonne. Alors qu'Henri de Lancastre dirige une chevauchée en Bretagne, Bertrand s'illustre au cours de la défense de Rennes. Charles de Blois l'adoube chevalier en 1357. Dès lors, au cours du conflit de Succession de Bretagne, Du Guesclin se rangera à ses cotés face à Jean de Montfort.
Légende ou réalité
Une légende courait sur l'origine de la famille du Guesclin. Cela remonterait à Charlemagne, une flotte de nefs sarrasines, conduite par un roi nommé Acquin, aborda les côtes bretonnes et dévastèrent les environs. Charlemagne accourut en personne, et rejeta les envahisseurs à la mer. La panique fut telle que les Sarrasins abandonnèrent sur la plage tentes et matériel ; parmi tout cela il y avait un enfant, le propre fils d'Acquin. Charlemagne en fit son filleul et le baptisa. Il lui donna des précepteurs et en fit un chevalier auquel il octroya le château de Glay qui devint le fief de Sire Glay-Acquin. Nous ne sommes pas loin de Du Guesclin.Bertrand du Guesclin à la bataille de Cocherel (1364) Le connétable au service de son roi
En 1357, Du Guesclin est au service du roi Charles V. Il participe à toutes les batailles qui opposent les troupes royales aux Anglais et Navarrais. Il obtient sa première victoire à Cocherel (près d'Evreux), en 1364, en battant l'armée de Charles le Mauvais. Puis, c'est la même année, la défaite d'Auray pour la succession de la Bretagne. Il sera fait prisonnier, le roi s'empresse alors de payer sa rançon. Bertrand du Guesclin engage ensuite une lutte contre le fléau de l'époque : « les Grandes Compagnies » : des mercenaires sans emploi qui s'étaient rassemblés en Côte d'Or. Ces fameuses compagnies se livraient à des exactions en tout genre.Il fallut trouver une solution pour se débarrasser de ces pillards. Du Guesclin, qui était le seul homme à avoir suffisamment d'autorité pour les rassembler, les emmena avec lui pour combattre en Espagne. Le futur connétable avait en tête de mener la lutte contre Pierre le Cruel, allié des Anglais, qui disputait à son frère Henri de Trastamare le royaume de Castille.Du Guesclin réussit à conquérir la Castille mais il est capturé par le Prince Noir. Le roi paya de nouveau la rançon.Libéré, Du Guesclin parvient à vaincre son ennemi à la bataille de Montiel en 1369. Quant aux Grandes Compagnies, elles entrèrent peu à peu en décadence. De 1370 à 1380, en utilisant toujours une tactique, très personnelle, de harcèlement de l'adversaire en partant des places fortes prises et bien défendues, Du Guesclin va réussir à chasser les Anglais de presque la totalité du territoire français occupé (Aquitaine, Poitou, Normandie...). En 1380, il meurt au siège de Chateauneuf-de-Randon en Auvergne. Charles V le fit ensevelir, fait unique pour un homme qui n'est pas roi, dans la basilique royale de Saint-Denis, aux côtés des rois de France. Le roi, victime de maladie, ne tarda pas à le rejoindre.
Le titre de Dauphin
Au cours du règne de Jean le Bon, le Dauphiné est rattaché par donation à la couronne. Désormais l'héritier présomptif de la couronne recevra ce territoire et portera donc le titre de Dauphin. Le premier dauphin sera donc Charles V, par la suite, ce titre servira à désigner l'héritier du trône de France (généralement le fils aîné du roi).(Bibliothèque Nationale de France) De nouveaux troubles
Charles VI « le Bien Aimé » ou « le Fol »
Avant sa mort, Charles V avait supprimé les fouages (impôt perçu sur chaque foyer), privant ainsi la monarchie de ressources. A sa mort, son fils Charles VI n'a que douze ans. Ce sont ses oncles, les ducs d'Anjou, de Berry, de Bourgogne et de Bourbon qui gouvernent le royaume. Profitant de leur situation, ils dilapident les ressources du royaume et décident d'instaurer de nouveaux impôts pour leur profit personnel.En 1383, c'est la révolte des « Maillotins » : des parisiens armés de maillets descendent dans la rue pour manifester leur mécontentement. En 1388, Charles VI prend en main les affaires du royaume, il chasse ses oncles et rappelle les anciens conseillers de son père, que les princes appellent les « Marmousets ». Pour ses sujets, Charles VI devient « le Bien Aimé ». En 1392, le destin de ce roi va littéralement changé. En traversant la forêt du Mans, lors d'une expédition contre le duc de Bretagne, le roi prend les membres de sa suite pour ses ennemis et les attaque en brandissant l'épée. Six chevaliers sont tués avant qu'on ait pu le maîtriser. La brutale folie du roi s'aggrave l'année suivante. Les sujets du royaume craignent un retour des oncles de Charles VI au pouvoir. Mais à travers ses crises de folie, le roi retrouve des accès de lucidité et gouverne avec sagesse. Personne n'ose alors placer le roi sous tutelle.
Folie de Charles VI
Armagnacs contre Bourguignons
Dès 1392, la reine Isabeau de Bavièrepréside un conseil de Régence mouvementé. Deux factions s'affrontent alors, aboutissant à une grave guerre civile :- Le parti d'Orléans (plus tard appelé Armagnacs) du frère de Charles VI : Louis d'Orléans (grand-père du futur Louis XII).
- Le parti Bourguignon du puissant oncle de Charles VI : Philippe le Hardi. Duc de Bourgogne, Philippe a hérité de l'apanage confié par son père Jean le Bon, il obtient la Flandre grâce à son mariage. A la tête d'un immense royaume, ses descendants se détacheront peu à peu du royaume de France.
Pendant ce temps, la France esquisse un rapprochement avec l'Angleterre. Le roi d'Angleterre, Richard II épouse la fille de Charles VI. Les deux souverains se rencontrent sans parvenir à des conditions de paix. En 1399, Richard II est renversé par Henri de Lancastre, c'est la fin des tentatives de pacification entre les deux royaumes.
La rivalité ne cesse de croître entre Louis d'Orléans, qui est à la tête de l'armée française, et le nouveau duc de Bourgogne, Jean Sans Peur.
Ce dernier fait assassiner Louis d'Orléans en 1407, dans le quartier du Marais à Paris. Cet assassinat marque le début de la guerre civile. Le fils de la victime, Charles d'Orléans, demande l'appui à son beau-père Bernard VII, comte d'Armagnac (d'où l'appellation de la faction). Armagnacs et Bourguignons se disputent les places et ressources du royaume, n'hésitant pas à faire appel à l'Angleterre. Jean Sans Peur parvient bientôt à dominer Paris. Très populaire le duc bénéficie de l'appui de l'Université et d'une remuante corporation de bouchers, dirigé par Simon Caboche. Ces derniers obtiennent en 1413, une grande réforme administrative : l'ordonnance cabochienne. Mais les troubles persistants inquiètent la bourgeoisie parisienne, qui se rapproche des Armagnacs. Le comte Bernard VII se rend maître de Paris et se fait nommer connétable par la reine Isabeau de Bavière.
Les ducs de BourgogneLa bataille d'Azincourt
Les querelles fratricides qui balayent la France n'ont pas échappés au nouveau roi d'Angleterre, Henri V de Lancastre. Ce dernier en profite pour relancer la guerre, il débarque avec ses troupes en Normandie. Henri V est le fils d'Henri IV, l'usurpateur qui a fait assassiner Richard II, l'héritier des Plantagenets. Il souhaite revoir les ambitions anglaises sur la couronne française, et à défaut, regagner une partie du continent perdue grâce aux campagnes de Bertrand du Guesclin. Sitôt débarqué en France, le souverain anglais va se réfugier à Calais.L'armée française s'organise autour des Armagnacs. Une fois encore, ils possèdent l'avantage numérique, mais malgré les défaites de Crécy et de Poitiers, la chevalerie française n'a rien perdu de son arrogance. En dépit des conseils du duc de Berry, les Français décident d'attaquer les Anglais dans un passage étroit, où il est impossible de se déployer.Déjà fatigués par la longue nuit d'attente sous la pluie, les chevaliers chargent avec le soleil dans les yeux. Avec leurs lourdes cuirasses, ils peinent à se déplacer et sont accueillis par une volée de flèches anglaises. Des piétons anglais viennent bientôt aux pieds des chevaliers en les frappant avec masses et épées. Les prisonniers sont égorgés. Azincourt est l'une des plus meurtrières batailles du Moyen Âge avec 10 000 pertes côté français.Une fois de plus, de nombreux barons français sont tués, Charles d'Orléans, neveu du roi et père du futur Louis XII est capturé et demeurera 25 ans en Angleterre. La chevalerie française qui demeurait l'élite du royaume pendant deux siècles entre en déclin. Ses vertus ancestrales comme le courage, la foi et le sacrifice sont balayés par la stratégie militaire. Une fois de plus une poignée d'infanterie a défait une horde de chevaliers.
Bataille d'Azincourt
La guerre civile
L'inaction du clan des Armagnacs, toujours au pouvoir, incite Henri V à élargir ses projets. Il débarque en Normandie et organise une conquête méthodique. En 1417, Jean Sans Peur et Isabeau de Bavière installe à Troyes, un gouvernement rival de celui du dauphin. A Paris, les Armagnacs ne s'imposent que par la terreur. En 1418, une violente émeute les chasse de la ville. Le comte Bernard VII et les siens sont froidement massacrés. La nuit du 20 août, les pillages et les massacres se poursuivent. On compte plus de dix mille morts. Le prévôt de Paris rentre dans la chambre du dauphin (le futur Charles VII), organisant sa fuite à cheval. Âgé de 15 ans, le dauphin part se réfugier à Bourges dans le duché de Berry qu'il a hérité de son grand-oncle.C'est un triomphe pour Jean Sans Peur et ses alliés anglais. Le duc de Bourgogne manœuvre à sa guise le roi Charles VI et sa reine Isabeau de Bavière. Ayant fait alliance avec les Anglais pour son intérêt personnel, Jean Sans Peur en vient cependant à s'interroger au vue de l'invasion anglaise sur le territoire national. Il souhaite faire une ultime tentative de réconciliation avec le dauphin. Les deux partis semblent disposés à mettre fin à leur rivalité qui ne sert que les intérêts anglais. Une entrevue a lieu sur le pont de Montereau en 1419, Jean Sans Peur s'y rend sans protection.C'est alors qu'un conseiller du dauphin, Tanguy du Châtel lui porte un coup de hache au visage, Jean Sans Peur est roué de coups puis assassiné. Naturellement, le meurtre horrifie le pays et ranime la querelle entre Armagnacs et Bourguignons. Charles VI se laisse convaincre par les Anglais de déshériter son fils et signe l'ignominieux traité de Troyes (1420). La fille de Charles VI est promise au roi d'Angleterre qui devient le successeur au trône de France. Il fait une entrée triomphale à Paris aux cotés de Charles VI. Il semble bientôt qu'un roi anglais régnera sur le royaume de France !L'assassinat de Jean Sans Peur
La réconciliation entre Armagnacs et Bourguignons aurait du constituer le relèvement français. Mais il n'en est rien, l'assassinat de Jean Sans Peur plonge le pays dans ses heures les plus noires.Accèder à l'article suivant : Jeanne d'Arc votre commentaire
votre commentaire
-
Le meunier et le boulanger
Le meunier
Un meunier est une personne qui moud la farine à l'aide de deux meules en pierre qui fonctionnent avec la force du vent ou de l'eau. Le meunier vit assez pauvrement, le travail est très rude. Même sous le soleil tapant, la neige, la pluie ou la grêle, le meunier travaille beaucoup. Il doit : entretenir le mécanisme, démonter et nettoyer les meules, régler la quantité des graines versées entre les deux meules. Sans meunier plusieurs métiers n'existeraient pas : le boulanger, le marchand...
Le boulanger
Un boulanger est une personne qui fabrique du pain. Au Moyen-Âge, le pain était souvent acheté par les pauvres. La cuisson du pain se fait à l'intérieur d'un four ovale. L'intérieur du four est fait, en général, en terre cuite. Dans la campagne, les fours sont fait en dalle de pierre. Les boulangers gardent tout l'argent qu'ils gagnent grâce à leurs ventes afin d'acheter des habits et de la nourriture. Les femmes des boulanger aidaient souvent les hommes.
Ces métiers d'alimentation sont les premiers à s'organiser parce qu'ils jouent un rôle très important dans les villes qui s'agrandissent. Il semble qu'a chaque fois qu'un nouveau village se créait, on édifiait une chapelle et un four.
Les cuissons et la gestion des redevances étaient confiées au fournier
Texte de la page
La place Panetière en 1835, par V. Daunay.
© Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis / E. Jacquot.
Coupe stratigraphique des maisons fouillées rue de la Boulangerie. Au travers des strates rouges et noires (terre rubéfiée et charbon), on devine la présence des fours de boulangers médiévaux.
© UASD / O. Meyer.La rue de la Boulangerie doit probablement son nom aux nombreux boulangers qui y étaient installés pendant le Moyen Âge. Leur activité a laissé des traces archéologiques formées des sols de boutiques recouverts des rejets de curage de fours à pain.En 1411, le Livre vert de Saint-Denis réglemente les modes de fabrication et de commercialisation du pain. Les boulangers habitant Saint-Denis peuvent exercer leur métier avec la permission du Grand Panetier de l'abbaye.
Propriétaires de leurs fours à cuire le pain, ils sont pourtant tributaires des moulins banaux de l'abbaye pour se procurer la farine. Le pain, destiné aux habitants et aux taverniers de la ville, peut être vendu dans les maisons, les ouvroirs ouvroir
------------------------------------------------------
une boutique ou "à fenêtre". Lors de visites-surprises, le Grand Panetier, accompagné de son sergent, vérifie la qualité du pain.

Boulanger au travail. Missel Franciscain du XVe siècle
© Bibliothèque municipale de Lyon (Ms 514, f. 6v)
Boulanger devant son four. Livre d'heures des XVe - XVIe siècles, attribué à Jean Bourdichon
© Bibliothèque municipale de Lyon (Ms 5141, f. 11v-12).
Boulanger devant son four. Livre d'heures des XVe - XVIe siècles © Bibliothèque municipale de Lyon (Ms 5997, f. 7v-8).
Boulanger et boulangère devant leur four. Livre d'heures à l'usage de Châlon, de Guillaume II Leroy, début XVIe siècle
© Bibliothèque municipale de Lyon (Ms 6881, f. 12).Le Livre vert distingue le pain cuit à Saint-Denis du pain produit aux environs de la ville. La vente de ce dernier est autorisée sur deux places uniquement : la Panetière, devant la basilique, deux jours par semaine (le vendredi et le dimanche) etle Pain de Paris, dans le quartier Saint-Marcel, les autres jours. Sur la Panetière, ces boulangers "estranges" ou "de hors" disposent d'étaux dont les plus petits mesurent à peine 50 cm2. Ce pain "forain" est réservé au seul usage domestique et ne peut être revendu. Il est également dit que les pains qui n'ont pas trouvé preneur avant l'heure des vêpres ne peuvent pas être conservés dans la ville pendant la nuit ; il est interdit de les présenter à nouveau à la vente le lendemain, sous peine d'amende ou de confiscation par le Grand Panetier.
Les talmeliers
Talmelier serait l'ancien nom des boulangers français. Deux hypothèses quant à l'origine du nom : le talmelier dériverait de tamiser, ou bien de taler qui signifiait battre (idée de pétrissage) et boulanger apparaît plus tardivement vers la fin du 12 ème siècle.
Au Moyen-Âge, pratiquement toutes les céréales étaient panifiées (orge, avoine, épeautre, seigle). Le froment, céréale fragile était tout à fait minoritaire.

SOURCES : http://www.culture.gouv.fr/fr/arcnat/saint-denis/fr/2_7_boulanger.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les activités du forgeron :
- Ferrage des chevaux, et donc fabrication des fers.
- Fabrication des cerclages de roues des charrettes.
- Fabrication des cercles pour le tonnelier, serrures et quincaillerie.
- Fabrication des divers araires, ainsi que tous les outils des champs : faux, faucilles, râteaux, houes...
- Fabrication des divers outils pour le jardin : pelle, pioche, fousou, bêches fourches...
- Crémaillères, broches, tisonniers, moines.
- Fabrication des enseignes en fer forgé et des éléments de mobilier : lit, pieds, bougeoirs...
Il utilisait plusieurs métaux. Les trois métaux les plus importants le fer, l'acier, le plomb. Les outils qu'utilisait le forgerons sont : le marteau, la tenaille et la gouge.

Je viens de découvrir le BLOG d'un super ARTISTE FERRONNIER D'ART - FORGERON... un VERITABLE ARTISTE...
sources :
http://www.20th.ch/historique.htm
http://www.20th.ch/ferronnerie_art_nouveau.htm
Historique du projet Schulé Métal

Ayant une formation de base de dessinateur en bâtiment, puis dessinateur serrurier constructeur, j'ai travaillé plusieurs années dans la construction métallique comme dessinateur.
Durant cette période, j'ai aussi travaillé un peu à l'atelier, et à la pose sur les chantiers.
Bien que n'ayant jamais vraiment appris à souder, je me suis formé sur le tas, et j'ai suivi des cours de soudure par la suite
C'est lors du gros chantier de la maison familiale, où j'ai réalisé seul plusieurs ouvrages métalliques, que le goût du travail manuel du métal m'est venu.
Comme le bâtiment était ancien, lors de la rénovation, j'ai eu à coeur d'utiliser de la ferronnerie d'époque (en particulier en ce qui concerne les balustrades), afin que cela reste en harmonie avec la bâtisse.
J'ai donc rénové et adapté divers éléments anciens, mais aussi construit à neuf: barrières, vitrines, vitrages ...
Par la suite, fin 2005, je suis tombé par hasard sur une rouleuse de ferblantier, c'est en faisant des essais, et en
"m'amusant" avec cette machine, que j'ai découvert le potentiel créatif de la tôle cintrée, et je me suis intéressé au travail de la tôle acier: en particulier en ce qui concerne le mobilier design.
Fin 2008, je décide de me mettre à mon compte pour réaliser divers travaux en acier: serrurerie, mais aussi décoration, design et sculpture.

Art Nouveau - Explication
Historique:
l'on peut dater la période du style Art nouveau de ~1890 à 1914, le style Art nouveau, qui selon les pays se nomme Jugendstil, Tiffany, ou Modern Style.Au début du19ème siècle, la mode était (déjà !) aux formes classiques: l'on s'inspirait de l'architecture de l'antiquité grecque ou romaine par exemple, il y avait aussi des copies, et l'on s'inspirait de l'art antique, parallèlement à cela, le style Néo gothique s'est développé, sans toutefois supplanter complètement les styles classiques, le style néo gothique à mûri en partie en réaction à la "lourdeur" des styles anciens, sa base idéologique était le "romantisme" qui s'est développé aussi en réaction à un classicisme trop rigide.
Le néo gothique s'inspire des épopées chevaleresques du moyen age, et reprend les canons stylistiques de l'art des cathédrales: rosaces, ogives, constructions fines et en hauteur. L'apogée du néo gothique, se situe vers le milieu du 19ème.
l'on s'est donc intéressé au patrimoine de cathédrales d'époque gothique, et a partir du milieu du 19ème siècle, l'on peut citer l'architecte Viollet le duc, qui s'est occupé de nombreuses restaurations, et même si il a commis quelques excès stylistiques dans ses travaux, et dans son romantisme "béat", il fût un théoricien qui inspira d'une certaine manière le mouvement Art nouveauLe mouvement Art nouveau en lui même commence au début des années 1890, c'est un mouvement qui est né en réaction a un historicisme ambiant pesant (cela veut dire que l'on glorifiait les formes et l'art du passé) car depuis la renaissance, l'on avait pas inventé de style révolutionnairement nouveau, et l'on a souvent "pompé" et imité les styles anciens (le style néo gothique étant dans la même dynamique)
l'on pourrait dire que le néo gothique a fait la transition entre le classicisme et l'Art nouveau, car même si il copiait le moyen age sans vraiment de création pure, ce qui faisait la différence avec les mouvements antérieurs, c'était l'idéologie:Entre autre le romantisme (quelque chose de difficile à expliquer pour moi !): une sorte de mouvement de nature poétique, en réaction a un rationalisme philosophique trop rigide
l'on pourrait qualifier de mouvement Art nouveau, de "hippie", car il prônait une sorte de retour à la nature (c'est dans cet esprit que la communauté Monte Verita c'est développée au début du 20ème siècle)
il s'intéressait à la nature, aux arbres, aux insectes, aux fleurs (dont on retrouve les formes dans les constructions), bref du design organique ou bio morphe avant l'heure.
Le style Art Nouveau s'est parallèlement développé
simultanément dans plusieurs pays avec la même idéologie de base, quelque gimmicks stylistiques en commun, mais avec un style propre à chacun des créateursLa France, avec le plus emblématique: Hector Guimard, mondialement connu pour ses bouches de métro. L'école de Nancy, avec des architectes, mais aussi verriers et menuisiers: Majorelle, Daum, Gallé.
La Belgique, avec Horta et Van de Velde
La sécession Viennoise, le Jugendstil en Allemagne, le style Sapin en Suisse (et plus particulièrement à la Chaux-de-Fonds)dans les pays Anglo-saxons, le style Arts and Crafts, le Style Tiffany, et sans oublier le génial Antoni Gaudi en Espagne
La période du style Art nouveau est assez courte, avant 1890 il y a certes quelques créations audacieuses, mais leur formes sont plus "gothiques" que "naturalistes",
l'apogée, est vers 1900, (d'ailleurs l'on nomme aussi l'Art nouveau, style 1900)
la première ligne du métropolitain parisien qui sera inaugurée pour l'exposition universelle de 1900 en sera le symbole, avec la ferronnerie Guimard.la fin du style Art nouveau se situe au début de la première guerre mondiale, dans les années 1910 l'Art nouveau perd de sa "folie" est devient plus sobre, plus épuré, l'on retrouve plus de lignes droites, de motifs géométriques, et l'on abandonne petit à petit les motifs asymétriques.
tout cela préfigurant l'Art déco: débutant officiellement avec l'exposition des arts décoratifs de 1925 (mais dont la période se situe entre 1920 et 40)
La ferronnerie:il faut distinguer les pièces de fonderie qui était produites de manière semi industrielles pour des éléments répétitifs ou des commandes spéciales, des ferronneries forgées à la main.
Pour les immeubles prestigieux, les éléments métalliques étaient esquissés de manière assez précise par les architectes, à la charge des serruriers de les réaliser d'après ces dessins, pour des constructions plus modestes, c'était directement les serruriers qui réalisaient les dessins, s'inspirant et adaptant des modèles que l'on pouvait trouver dans des revues spécialisées.
le "vrai" style Art nouveau est rare, cela s'explique qu'après une longue période d'architecture néo-classique, ce style était très moderne, donc dérangeant, mais il est souvent plus marqué dans la ferronnerie que dans la maçonnerie: lorsque l'on regarde un bâtiment ancien de style intemporel, c'est souvent la ferronnerie qui trahi l'époque de la construction, car au niveau technique, l'on peut se permettre plus d'audace avec le métal, tout en restant discret
Beaucoup de bâtiments ont une ferronnerie d'apparence classique, mais lorsqu'on les regarde de prés, il y a un petit détail qui trahi l' appartenance à l'époque Art nouveau
C'est pourquoi en ferronnerie, même si certains éléments sont clairement identifiés au mouvement Art nouveau, le reste: si c'est une balustrade par exemple, est de facture classique, avec des volutes géométriques régulières.
Donc, cela fait plaisir, lorsque l'on trouve un élément dont l'ensemble a un style nouille harmonieux (le style "nouille" est le nom donné au style Art nouveau par ses détracteurs, a cause des volutes anarchiques et entrelacées de certaines pièces)C'est pourquoi la belle ferronnerie Art nouveau peut se collectionner pour sa forme, indépendamment de son utilisation
Johan SchuléPour en savoir plus: Lien Wiki Art nouveau
Le site très documenté d'un passionné de l'Art nouveau
l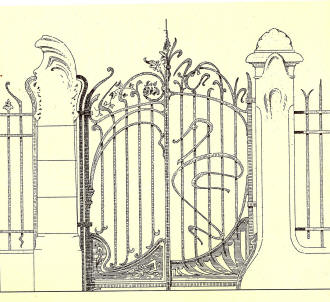
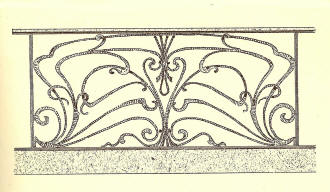
liste des pièces Art nouveau disponibles:
vous avez peut-être déjà vu certaines pièces sur des autres pages, j'ai regroupé
ici, des pièces de toute sorte ayant en commun un beau style 1900
me contacter pour une question, ou une demande de prix

Art Nouveau N° 1 Paire de beaux motifs art nouveau symétriques forgés. Style très pur, acier épaisseur
5mm, longueur totale 78cm. L'on peut éventuellement fabriquer une suspension
d'enseigne avec (mais le marquage en creux n'est que d'un côté)


Art Nouveau N° 2 jolie grille de porte allongée en fonte d'époque Art nouveau, avec joli décor floral, l'encadrement est de section 16x8, la grille est légèrement voilée, mais non fendue



Art Nouveau N° 3 superbe paire de grilles en fonte, d'époque, et de style Art Nouveau très pur, peinture rouge. l'encadrement est de section 15x8, complètes et non fendues largeur 300mm, hauteur 900mm. VENDU


Art Nouveau N° 4 paire de grilles en fonte, d'époque, idem que la photo précédente (les grilles rouges), ces grilles n'ont pas de peinture, une pièce dont une partie de l'encadrement manquait à été rénovée, comme elles sont identiques aux grilles rouges, l'on pourrait utiliser les 4pièces pour construire quelque chose VENDU


Art Nouveau N° 5 petite grille de style Art nouveau sobre, les volutes sont forgées à chaud largeur 325mm, hauteur 750mm. l'encadrement est de section 12x12



Art nouveau N° 6 Portail 2 vantaux, de style et d'époque Art Nouveau vers 1900, il est rare de trouver
de la ferronnerie avec un "vrai" style Art Nouveau, largeur 167cm.
Mesures:
largeur du cadre 167cm, hauteur des montants latéraux 132cm, hauteur des montants
centraux 149cm.
Construction - état:
montants latéraux fer carré 20x20mm, barreaux 14x14mm. & 14x8mm, filières plat 25x6
montants centraux cornières 30x30x6, non tordu, mais certaines pièces rongées par la rouille sont a changer, dont les 2 filières du bas en plat 25x6, le bas de certains barreaux, ainsi que les montants centraux en cornières 30x30x6, les ornements du haut en tôle sont un peu piqués par la rouille, mais ne nécessitent pas un remplacement.
Il est rare de trouver des pièces de beau style 1900.


Art nouveau N° 7 garde corps de pur style Art Nouveau, avec de très belles feuilles forgées, l'on peut utiliser
cette pièce pour en faire un élément décoratif, potence ou autre largeur 1180mm. hauteur 330mm. utilisable pour un vide de maçonnerie de 110 à 120cm.



Art nouveau N° 8
bâti de machine en fonte: essoreuse, laminoir ...? très beau décor
de style Art Nouveau, belle patine rouille, transformable en pied
de table ou autre


Art Nouveau N°9 Belle grille en fer forgé, d'époque et de style Art Nouveau format 775x1010mm, encadrement en plat de 16x8, barreaux torsadés en carré de 12x12, construction entièrement rivetée, en bon état, non tordu RECYCLÉ
Retour sommaire ferronnerie ancienne
il est possible construire des éléments de style Art nouveau, en
s'inspirant des dessins d'époque: l'on peut redessiner des motifs
sur un logiciel DAO, afin d'obtenir des fichiers transférables sur
des machines de découpe CNC.
 votre commentaire
votre commentaire
-
L'histoire du talon haut
Il y a deux types de femmes dans le monde: celles qui avancent leur poitrine rebondie et celles qui ont des jambes. Je préfère me référer aux secondes (on ne peut pas tout avoir!) et m'élancer à talons perdus dans le monde, en défiant parfois les lois de l'apesanteur.
Mais d'où vient le talon? Il est dit qu'il est né dans l'ancienne Egypte où les bouchers portaient des talons pour éviter le sang au sol… Charmante vision! Les cavaliers mongols mettaient des talons à leurs bottes pour mieux tenir dans leurs étriers.

Au XVIIème siècle, tous les nobles s’avancent en vacillant sur des talons d’au moins 12 cm, en signe de distinction sociale. Même les hommes en portent malgré l’inconfort : leur poids pousse le pied vers l’avant et, ce qui n’arrange rien, la chaussure gauche n’est pas conçue différemment de la droite. Ils marchent donc en canard ! Si le talon haut donne aux femmes une démarche ondulante parfois maladroite, il oblige ces messieurs à se dandiner. Pour éviter de tomber, beaucoup s’aident de cannes qui leur servent d’appui. Mais peu importe la démarche. A leurs yeux, elle est royale car elle les propulse au sommet.

Largement portées du XVè au XVIIIè siècle, les chaussures à talons compensés avaient alors un rôle pratique à défaut d’une fonction esthétique. Elles permettaient en effet de protéger les vêtements des projections de boue et des déchets jonchant le sol.
A la Renaissance et plus particulièrement à Venise, ces chaussures étaient notamment portées par les courtisanes, et étaient surélevées grâce à des plateformes en bois. Elles sont apparues quelques années plus tard comme un accessoire de mode et un outil pour afficher son statut social. Appelées alors « chopines », ces chaussures disposaient d’un talon dont la hauteur pouvait mesurer jusqu’à 60 cm. Les femmes élégantes de l’époque utilisaient ainsi cet artifice pour afficher l’importance de leur statut.
Le XVIIe Siècle
Les femmes européennes déambulaient avec les talons hautes de 5 pouces et elles se servaient de cannes. Parce que la classe ouvrière ne pouvait pas porter les chaussures non pratiques, les talons représentaient le luxe et privilège.
En 1660, Louis XIV a porté des chaussures à talons rouges. Dans le XVIIe et le XVIIIe siècle, le talon rouge et la décoration dentelle argent était le style Rococo. Ce style a représentait la classe privilège.



Bottier France XIXè siècle

1925

André Perugia, 1931

- Talon abattu : talon évasé vers le haut, créant un profil en surplomb ;
- kitten heel : petits talons aiguille d'une hauteur comprise entre 3,5 et 5 centimètres ;
- Talon aiguille : talon haut, de plus de 7 cm, et très effilé vers le bas. Il peut atteindre des hauteurs de 15 cm ;
- Talon baraquette : talon plat et débordant à gorge rectiligne ;
- Talon bas ou talon plat : talon de faible hauteur dont les faces supérieures et inférieures sont parallèles ;
- Talon bobine : talon haut creusé sur son pourtour et évasé vers le bas ;
- Talon bottier ou talon rainuré : talon haut et large fait de lamelles de cuir superposées ou donnant cet aspect ;
- Talon chiquet : talon très plat constitué d’une unique lamelle de cuir. Ce type de talon se trouve souvent sur des ballerines par exemple ;
- Talon collant : talon dont le pourtour est au même niveau que celui de la chaussure ;
- Talon compensé ou semelle compensée : talon qui se prolonge sous la cambrure pour se raccorder à la semelle.
- Parfois appelé talon plein ou talon wedge ;
- Talon crayon ou talon stiletto : talon aiguille très haut qui reste fin jusqu'à la semelle ;
- Talon cubain ou talon quille : talon large, de hauteur moyenne, dont les profils sont rectilignes et dont l’arrière est en pente légère vers l’avant ;
- Talon débordant : talon dont le pourtour est en saillie par rapport à celui de la chaussure ;
- Talon en talus : talon évasé vers le bas et dont la surface au sol est plus grande que la surface d’emboîtage (inverse du talon abattu) ;
- Talon français : talon plat à gorge incurvée et dont l’arrière est en pente vers l’avant ;
- Talon haut ;
- Talon italien : talon haut collant et abattu sur toutes ses faces ;
- Talon Louis XV : talon haut de profil concave et au surplomb très accentué ;
- Talon recouvert : talon dont le revêtement extérieur est le même que celui de la chaussure ;
- Talon semi-compensé : talon compensé dont la surface inférieure sous la cambrure est légèrement creusée.
Note : une talonnette est une demi-semelle se plaçant à l'intérieur de la chaussure

SOURCES :
SUPER BLOG
- http://www.folles-de-manolo.com/Talons.html
LIEN SUPERBE
HISTOIRE DE LA CHAUSSURE de ROMANS, chaussure française
http://www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=1697
 1 commentaire
1 commentaire
-

Montcalm en pourparlers avec des IndiensLa Nouvelle-France (1534-1760)
L'implantation du français
au Canada
Plan du présent article
1. Les débuts de la colonisation en Amérique
Jacques Cartier
Samuel de Champlain
L'organisation de la Nouvelle-France
2. Le peuplement et la population
Les provinces françaises d'origine
Les origines sociales
Une colonie militaire
Les «filles du roy»
La qualité des émigrants
Les coureurs des bois
Les esclaves
3. Les autochtones (Indiens)
Des alliés incontournables
La religion chrétienne
La multitude des langues
Le métissage
La politique française d'assimilation
Les interprètes
L'art d'haranguer les «Sauvages»
Le prix des alliances indiennes4. L'implantation du français au Canada
Les français régionaux importés de France
Les causes de l'unification linguistique
La langue de l'Église5. Le français parlé au Canada
Un français similaire à celui de la France
Des divergences dans le vocabulaire
Les influences amérindiennes6. L'éducation au Canada
Les petites écoles
Les grandes écoles
La qualité de l'instruction7. La croissance démographique
Le déficit démographique
La population résidente temporaire
Une population restreinte
Les moyens de la politiqueL'origine du nom de «Nouvelle-France» serait attribuée aux frères Giovanni et Girolamo da Verrazzano. En 1524, alors qu'ils exploraient les côtes septentrionales de l'Amérique pour le compte du roi de France, François Ier, les Verrazzano utilisèrent les mots Francesca (en hommage à François Ier) et Nova Gallia («Nouvelle-Gaule») pour désigner la région s'étendant de Terre-Neuve à la Nouvelle-Angleterre. D'autres explorateurs utilisèrent les termes Nova Francia, Nova Franza, Nouvelle-France ou New France. Mais c'est Samuel de Champlain qui inscrira définitivement «Nouvelle-France» (plus précisément «Novvelle France») sur une carte dessinée en 1607 et représentant l'Acadie à partir de La Hève jusqu'au sud du Cape Cod; par la suite, toutes les cartes utiliseront le terme «Nouvelle-France». Marc Lescarbot, compagnon de Champlain à Port-Royal (Acadie), emploiera lui aussi le même terme dans le titre de son ouvrage publié en 1609 et intitulé Histoire de la Nouvelle-France.
1 Les débuts de la colonisation en Amérique
La période de la Nouvelle-France s'étendit de 1534 à 1760. C'était une période où les grands puissances européennes découvraient d'autres mondes afin d'exploiter de nouvelles richesses.
1.1 Jacques Cartier
Jaloux des richesses que l'Espagne et le Portugal retiraient de leurs colonies, François 1er nomma Jacques Cartier (1491-1557) à la tête d'une première expédition en 1534. Ce dernier devait découvrir de nouveaux territoires et fonder éventuellement un empire colonial. Lors de son premier voyage, Cartier planta à Gaspé, le 24 juillet 1534, une croix avec un écusson portant des fleurs de lys et, au-dessus, une inscription en français avec de grosses lettres: «VIVE LE ROY DE FRANCE». Lors de son second voyage (1535-1536), Cartier planta une autre croix à Stadaconé (près de Québec) avec cette inscription latine: «Franciscus primus Dei gratia Francorum rex regnat» (''François premier, par la grâce de Dieu, roi des Français, règne''), cette dernière inscription pouvant être lue par tout Européen de passage. Ensuite, il enleva le chef Donnacona, s’assurant ainsi d’avoir un témoin oculaire qui pourra raconter cette histoire à François 1er. Bien que ces découvertes soient inestimables, les voyages de Cartier au Canada (1534, 1535-1536, 1541-1542) se soldèrent, au point de vue de la colonisation, par des échecs, car au début du XVIIe siècle aucun Français n'était encore installé sur le territoire de la Nouvelle-France.
Même si le navigateur français a échoué à fonder un établissement au Canada, il donna à la France des droits sur le territoire. Au plan linguistique, les voyages de Cartier contribuèrent à fixer très tôt la toponymie de l'est du Canada: les noms de lieu sont depuis cette époque ou français ou amérindiens. Cartier aura eu le mérite d'établir les bases de la cartographie canadienne et d'avoir découvert le grand axe fluvial – le Saint-Laurent – grâce auquel la Nouvelle-France pourra recouvrir, pour un temps, les trois quarts du continent nord-américain. En Acadie, certains toponymes français à l'origine deviendront plus tard anglais, soit après le traité d'Utrecht de 1713.
Au sens strict, Jacques Cartier n'est pas le découvreur du Canada actuel, puisqu'il n'a pas parcouru le Nouveau-Brunswick, ni la Nouvelle-Écosse ni l'île du Prince-Édouard. En fait, Cartier fut le découvreur de la vallée du Saint-Laurent; il appellera le fleuve «rivière du Canada». Lors de ses voyages dans la vallée du Saint-Laurent, Cartier avait rencontré ceux que les anthropologues désigneront par les «Iroquoiens du Saint-Laurent» (ou «Iroquoiens laurentiens»), notamment à Stadaconé (Québec) et à Hochelaga (Montréal). Rappelons que c'est à Jacques Cartier qu'on doit le nom de Canada au pays: en entendant le mot iroquoien kana:ta, qui signifie «ville» ou «village», il crut que le terme désignait le pays tout entier. Cartier est l'auteur du premier Glossaire sur les langues amérindiennes au Canada; il est en annexe dans le Brief recit de la navigation faicte es ysles de Canada.
1.2 Samuel de Champlain
Samuel de Champlain (1580-1635) fonda Québec en 1608, mais sur l'emplacement de Stadaconé il ne restait plus aucun des villages mentionnés par Cartier et, au lieu des Iroquoiens, il ne trouva que quelques rares bandes de chasseurs montagnais. C'est que, entre 1580 et 1590, les Iroquoiens avaient disparu en tant que peuples distincts, mais leurs descendants avaient rejoint divers groupes voisins, tant de langue iroquoienne que de langue algonquienne. Dès 1609, sur rapport de Champlain, Henri IV donna à la colonie le nom de Nouvelle-France. Champlain tenta d'établir des colons et devint lieutenant-gouverneur du territoire en 1612. Mais les succès se révélèrent minces puisqu'en 1627, lors de la création de la Compagnie de la Nouvelle-France (ou Compagnie des Cents Associés), on ne comptait encore qu'une centaine d'habitants dispersés en deux groupes, l'un à Québec (environ 60), l'autre à Port-Royal (en Acadie, aujourd'hui la Nouvelle-Écosse).
En 1641, la Nouvelle-France comptait 240 habitants, contre 50 000 dans les futures colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre. Bref, durant ce premier siècle, le peuplement de la Nouvelle-France s'est vraiment révélé un échec, et ce, d'autant plus qu'un édit royal de 1668 interdira le départ des huguenots vers le Canada. C'est là l'un des paradoxes de la colonisation française en Amérique du Nord: la France, alors le pays le plus peuplé d'Europe (avec 20 millions d'habitants), aurait dû compter, en dehors de son territoire métropolitain, plus d'habitants que la petite Angleterre (5,6 millions)! On peut penser que les Anglais, plus à l'étroits dans leur île de Grande-Bretagne, ont eu plus tendance à émigrer que les Français, plus sédentaires et plus intégrés à l'Europe. À la même époque, la marine française ne comptait que 18 vaisseaux et une dizaine de galères!
Il faut dire que l'image de la Nouvelle-France qui circulait alors dans la mère patrie ne motivait en rien les Français à venir au Canada, ni en Acadie, ni plus tard en Louisiane. L'imagination populaire ne pouvait être attirée par un pays au climat sévère, exposé en plus à l'hostilité des «Sauvages» (comme on appelait les Amérindiens à l'époque) qui guettaient leurs victimes derrière chaque arbre, puis des Anglais de la Nouvelle-Angleterre. Pour beaucoup de Français, le Canada n'était rien d'autre que la «terre de Caïn» découverte par Jacques Cartier et que Voltaire réduire plus tard à «quelques arpents de neige». Par contre, ceux qui étaient venus en Nouvelle-France pouvaient avoir une vision différente, sinon plus nuancée, comme en témoigne le jésuite François Le Mercier dans les Relations des jésuites de 1667:
Ce n'est plus ce païs d'horreurs et de frimas qu'on dépeignoit auparauant auec tant de disgrâces, mais vne uéritable Nouvelle France, tant pour la bonté du climat et la fertilité de la terre, que pour les autres commodités de la vie qui se découurent tous les iours de plus en plus. Malgré les nombreuses guerres qui sévissaient en Europe, malgré la pénurie de terres, les paysans et les petites gens préféraient sans doute vivre dans leur patelin plutôt que de s'aventurer dans des contrées inconnues peuplées de «Sauvages».
1.3 L'organisation de la Nouvelle-France

Avant le traité d'Utrecht de 1713, la Nouvelle-France comprenait cinq territoires ou colonies possédant chacune une administration propre: le Canada (incluant les «Pays d'en haut : la région des Grands Lacs), l'Acadie, la Baie-d'Hudson, Terre-Neuve (que la France partageait avec la Grande-Bretagne sous le nom de «Plaisance») et la Louisiane (voir la carte agrandie de la Nouvelle-France avant 1713), comprenant le «Pays des Illinois» au nord).
Après la perte de la Baie-d'Hudson, de Plaisance (Terre-Neuve) et d'une partie de l'Acadie en 1713, il faudra ajouter l'Île-Royale (Cap-Breton) avec la construction de Louisbourg (qui débuta en 1720); l'île Saint-Jean (île du Prince-Édouard), qui faisait partie de la colonie de l'Île-Royale, dépendait directement de l'Administration française. En principe, chacune des administrations locales était subordonnée au gouverneur général de la Nouvelle-France (en même temps gouverneur du Canada), qui résidait à Québec. Autrement dit, les autres colonies de la Nouvelle-France étaient administrées par un gouverneur local mais aussi par Québec et Versailles.
Le gouverneur général de la Nouvelle-France avait autorité pour intervenir dans les affaires des autres colonies de l'Amérique du Nord. En temps de guerre, le gouverneur local devait non seulement rendre des comptes au roi et au ministre de la Marine, mais devait aussi au gouverneur général et à l’intendant de Québec. Certains gouverneurs généraux, tels le comte de Frontenac, considéraient l'Acadie et Louisbourg comme leur arrière-cour et intervenaient de façon régulière, souvent même sans en avertir le gouverneur local. C'est que, juridiquement, l'Acadie, par exemple, était une division administrative au même titre que Montréal et Trois-Rivières. En temps de guerre, le commandement suprême était à Québec, pas à Port-Royal, ni à Louisbourg, ni à la Nouvelle-Orléans. De plus, la véritable autorité était à Versailles, non à Québec. Mais la distance et les difficultés des communications rendaient la mainmise du gouverneur général plus aléatoire.
Pour la France, la colonie du Canada représentait une charge, car le marché de la fourrure demeurait limité. La raison d'être du Canada était d'ordre stratégique. D'une part, il permettait de diminuer les forces britanniques sur l'échiquier européen; d'autre part, le Canada et la Louisiane empêchaient l'expansion des colonies britanniques en Amérique du Nord. Seule l'industrie de la pêche de l'île Royale était économiquement rentable en rapportant annuellement au moins deux millions de livres au Trésor royal. De plus, grâce à ces pêcheries, la France pouvait former des milliers de marins et construire une flotte de navires permettant de rivaliser avec les imposantes flottes navales britanniques. L'économie du Canada, de la Louisiane et de l'Acadie reposait sur la traite des fourrures et l'agriculture, mais celle de l'île Saint-Jean s'appuyait uniquement sur l'agriculture, celle de l'île Royale, sur la pêche.
Toutes les colonies de la Nouvelle-France étaient administrées par le secrétaire d'État à la Marine. Au temps de la Nouvelle-France, ce furent dans l'ordre Jean-Baptiste Colbert, le comte de Maurepas, le comte de Pontchartrain, le comte de Toulouse, Joseph Fleuriau d'Armenonville, Antoine Rouillé, Jean-Baptiste de Machault , François Marie Peyrenc de Moras, Claude Louis d'Espinchal, Nicolas René Berryer et Étienne-François de Choiseul (voir la liste). D'anciens officiers navals exerçaient généralement les fonctions du gouverneur général ou de gouverneur local; ils étaient responsables de la sécurité et des opérations militaires. À côté d'eux, il y avait des employés civils appartenant aux services de la Marine, notamment les intendants et leur personnel, qui contrôlaient les finances et s'occupaient à plusieurs tâches administratives. Bref, la France exerçait un contrôle étroit sur ses colonies de l'Amérique du Nord et avait à peu près réussi une unité nécessaire à la défense de son empire. C'est ce qui a d'ailleurs fait la force de la Nouvelle-France par comparaison aux colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre, toutes divisées entre elles et peu enclines à coopérer.
Si la frontière de la Nouvelle-France était précise à l'est, elle demeurait à l'ouest ouverte et sans limites sur le reste du continent nord-américain. À partir de la fondation de Montréal en 1642 jusqu'à la chute de la Nouvelle-France en 1760, soit 118 ans, le pays ne connaîtra que 29 années de paix réelle.
2 Le peuplement et la population
Au XVIIIe siècle, les habitants de la Nouvelle-France, que ce soit au Canada, en Louisiane ou en Acadie, étaient des Français pour les Britanniques; ils n'étaient des «Canadiens» que pour les Français de France, mais ce terme ne fut à peu près jamais employé par les autorités françaises, du moins dans les textes écrits officiels, puisque tout le monde était français. La «canadianité» ne fut jamais très prisée en Nouvelle-France, ce qui n'empêchait nullement les habitants du pays de se considérer comme des «Canadiens», non comme des «Français». Durant la guerre de Sept Ans, les miliciens canadiens s'affirmaient en tant que «Canadiens» par opposition aux «François» ("Français"). En 1756, Bougainville, dans une lettre à son frère, datée du 7 novembre, comparait ainsi Français et Canadiens: «Il semble que nous soyons d'une nation différente, ennemie même.» Par voie de conséquence, les Acadiens devaient être encore plus «différents» des Français que les Canadiens, car ils vivaient sous le régime britannique depuis 1713 et que le lien avec la France n’était maintenu que par quelques prêtres missionnaires.
Cependant, pour les Anglais, les Canadiens et les Acadiens étaient bel et bien des «Français», peu importe qu'ils viennent de France ou de la Nouvelle-France, du Canada ou de l'Acadie, il n'y avait pas de différence. En réalité, juste avant la Conquête de 1760, la plupart des habitants qui étaient nés au Canada n'étaient donc plus des immigrants, mais des «Canadiens» puisque le Canada était devenu leur patrie. Il faudra la Conquête et le Régime britannique pour que l'appellation de Canadiens ou Acadiens soit systématiquement employée parce que, aux yeux des Britanniques, les Canadiens n'étaient plus des Français depuis 1763; les Acadiens ne sont devenus des Acadiens qu'une fois déportés en Nouvelle-Angleterre, en France ou en Angleterre.
De même, les sujets de la Couronne britannique, quelle que soit leur origine, étaient des Britanniques, même s'ils étaient anglais, écossais, irlandais, virginiens, pennsylvaniens ou néo-angleterriens. En ce sens, les Anglais, Écossais, Virginiens, etc., formaient une collectivité unique: les Britanniques. Il en était ainsi des Français, des Canadiens et des Acadiens: c'étaient tous des Français. Les Américains n'existaient pas encore; il le deviendront avec la guerre de l'Indépendance.

- En 1627, le Canada, ne comptait encore qu'une centaine d'habitants. Il s'agissait d'un tout petit pays qui revendiquait, au surplus, une grande partie du territoire nord-américain: la Nouvelle-France. Il n'y avait pas de quoi impressionner face à la Nouvelle-Hollande, qui comptait déjà 10 000 habitants, et face aux colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre qui en avait 80 000. De plus, tout fonctionnait mal en Nouvelle-France, particulièrement au Canada, que ce soit sur le plan des institutions civiles, des autorités religieuses ou de l'économie. Jusqu'en 1660, la France parla d'abandonner les rives du Saint-Laurent.
2.1 Les provinces françaises d'origine
Néanmoins, entre 1627 et 1663, la population passa de 100 habitants à quelque 2500. En 35 ans, environ 1250 immigrants français vinrent augmenter la petite population d'origine; la natalité doubla le contingent. Déjà à cette époque, les immigrants venaient de presque toutes les provinces de France, soit de 29 provinces sur un total de 38, mais seulement quelques-unes d'entre elles sont numériquement importantes. Les données qui suivent proviennent des études de Marcel Trudel; par contre, le tableau 1 («L'origine des immigrants français de 1608 à 1700») renvoie aux statistiques de Stanislas A. Lortie, qui portent sur tout le XVIIe siècle.
Certaines provinces jouèrent un rôle prépondérant: la Normandie (282), l'Aunis (204), le Perche (142), Paris et l'Île-de-France (130), le Poitou (95), le Maine (65), la Saintonge (65) et l'Anjou (61). Selon les sources, les provinces pépinières demeurent fondamentalement les mêmes, mais la Bretagne, la Champagne et la Guyenne augmentèrent leur contingent après 1663. Il n'y a pas de réelle contradiction entre les deux sources, mais il nous a paru préférable de donner ici celles de Stanislas A. Lortie parce qu'elles portent sur tout le siècle.
En 1966, le Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l'Université de Montréal s'est donné comme mandat de reconstituer de façon exhaustive la population du «Québec ancien», depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle. Couvrant l'ensemble des XVIIe et XVIIIe siècles, la base de données du PRDH contient ainsi «l'histoire nominative» des ancêtres québécois issus de France. La base de données porte sur 8527 immigrants fondateurs couvrant la période du Régime français. Une origine des provinces françaises peut être attribuée à 7656 d'entre eux, soit 89,8 %. Selon ces résultats, les immigrants français se répartissent de la façon suivante par région (ou provinces regroupées):
- le Nord-Ouest: 28,1 % - le Sud-Ouest: 10,5 % - le Nord: 3,4 % - les Alpes: 1 %
- le Centre-Ouest: 26,3 % - l'Est: 8,2 % - le Massif central: 2,9 %
- la région parisienne: 14,3 % - le Val de Loire: 3,9 % - le Midi: 1,3 %Autrement dit, cette étude confirme le fait que la majorité des immigrants provenaient des provinces du nord et de l'ouest de la France, incluant la région de Paris: 14,5 % en Normandie, 14,3 % en Île-de-France, 9,8 % au Poitou, 8,9 % en Aunis, 6 % en Bretagne, 5,3 % en Saintonge, 4,4 % en Guyenne, etc. Bref, la grande majorité des immigrants français provenaient bien des provinces du Nord-Ouest, du Centre-Ouest, de l'Île-de-France et du Sud-Ouest.
On sait aussi que de rares immigrants sont arrivés de la Belgique (48), de l'Allemagne (34), de la Suisse (23), de l'Italie (14) et de l'Irlande (10). On peut consulter le tableau 3 pour visualiser les résultats complets du PRDH.
Cela signifie que les immigrants avaient pour origine principale des régions côtières et des villes portuaires davantage tournées vers l'extérieur, ainsi que de la grande région parisienne. Ces régions comptaient naturellement de nombreux marins et pêcheurs. Les villes françaises engendrèrent cinq fois plus d'immigrants que les campagnes.
2.2 Les origines sociales
En 1663, les différents groupes sociaux représentés au Canada étaient répartis ainsi: 68 % de paysans et d'artisans, 26,3 % de fonctionnaires, de commerçants et de militaires, 3 % de nobles et 2,5 % d'ecclésiastiques. Mais pour tout le Régime français (jusqu'en 1760), la répartition est plutôt la suivante: 43 % d'artisans, 26 % de paysans, 14 % de «manouvriers» ou de manœuvres, 12 % de bourgeois (contre 8 % en France) et 3 % de nobles (contre 1,5 % en France). Les membres du clergé représentaient 3,7 % de l'ensemble.
Il est pertinent d'ajouter quelques mots sur l'âge des émigrants français. Les jeunes adultes, surtout célibataires, dominent nettement les contingents qui arrivaient au Canada. La répartition est la suivante sur 9710 recensés: 28,6 % avaient entre 20 et 24 ans, 22,8 % entre 25 et 29 ans, 15,6 % entre 15 et 19 ans, 12,3 % entre 30 et 34 ans. Suivaient ensuite les 35-39 ans (6,4 %) et les enfants en bas âge de 0 à 14 ans (6,1 %). Il restait seulement 8,4 % d'adultes âgés de plus de 40 ans, ce qui devait comprendre principalement des officiers, des marchands, des commerçants et des membres du clergé (dont les religieuses).
2.3 Une colonie militaire
À partir de 1663, la Nouvelle-France connut une phase d'expansion décisive et les émigrants arrivèrent beaucoup plus nombreux. D'abord, Louis XIV décida l'envoi de tout un régiment, le Carignan-Salières, d'environ 1200 hommes (1665). Pour hâter le peuplement, l'État obligea les capitaines de navires marchands à transporter des colons et à instaurer le système seigneurial.
Il faut aussi considérer que 30 % des hommes sont arrivés au Canada, alors qu'ils faisaient partie de l'armée. De façon générale, le personnel militaire représente près du quart de l'ensemble de l'émigration française. Au total, 13 076 militaires sont passés au Canada pendant le Régime français, sans compter ceux qui se sont installés en Acadie et à Louisbourg dans l'île du Cap-Breton. Sont exclus également les militaires de la Louisiane et ceux de la colonie de Plaisance (Terre-Neuve). Les Compagnies franches de la Marine furent stationnées dans les villes de Québec, Montréal, Trois-Rivières et Louisbourg, ainsi que dans les forts de Frontenac, Niagara, Michilimackinac, Saint-Frédérick, Chambly, Beauséjour, Laprairie, Sault Saint-Louis, Lac-des-Deux-Montagnes et Détroit. De 1683 à 1760, les Compagnies franches de la Marine participèrent à tous les affrontements qui marquèrent l'histoire de la Nouvelle-France. Elles furent présentes à Québec, Montréal, Trois-Rivières (et Louisbourg), ainsi que dans les forts de Chambly, Lapraire, Détroit, Frontenac, Niagara, Michilimackinac, Sault Saint-Louis, etc.
Avec le temps, l'habillement des soldats s'est adapté, surtout l'hiver (tuque, mitaines, hachette, mocassins, etc.). En temps de paix, les soldats français étaient logés chez les habitants des villes ou des seigneuries avoisinantes.
En Nouvelle-France, il existait aussi, comme en France, un corps de la maréchaussée, qui constituait «le bras de la justice» de l'État. Dans les grands centres urbains comme Québec, Montréal, Louisbourg (Île-Royale) et La Nouvelle-Orléans (Louisiane), ces cavaliers servaient de police pour le gouverneur local. C'est pourquoi on les appelait «juges bottés». On en comptait 6 à 12 à Québec, généralement deux dans les autres centres. Leur travail consistait à assurer le transfert de prisonniers, patrouiller le territoire et faire des enquêtes policières, ce qui pouvait les mener d'un bout à l'autre de la colonie, tant à cheval qu'en canot. En général, les membres de la maréchaussée venaient de France et restaient dans la colonie pour une durée de trois ans. À la différence des Compagnies franches de la Marine, les membres de la Maréchaussée portaient la veste, la culotte et les bas rouges, le pourpoint étant bleu.
Rappelons que, dès 1669, tous les hommes âgés de 16 à 59 ans devaient faire partie de la «milice canadienne», sous les ordres de capitaines, de lieutenants et d'enseignes. Ces miliciens n'étaient donc pas des soldats professionnels et ne recevaient pas de solde en retour de leurs services. Ils recevaient une formation rudimentaire et devaient même fournir leur propre fusil, sinon ils devaient présenter un «certificat de pauvreté» signé par leur capitaine. Dans ce cas, l'armée leur remettait un fusil de chasse, lequel représentait à peu près le coût d'une vache.
Les miliciens se réunissaient par compagnie une fois par mois pour leurs exercices militaires. Contrairement aux troupes régulières françaises – les «Compagnies franches de la Marine», appelées aussi «troupes de la colonie», «troupes de la Marine», troupes du «détachement de l'infanterie de la Marine», etc. –, la milice canadienne adopta aussitôt les techniques militaires amérindiennes par des raids en forêts et des descentes de rivières en canot. Les miliciens canadiens entreprenaient régulièrement des expéditions avec des tribus indiennes alliées afin de semer la terreur chez les fermiers de la Nouvelle-Angleterre. Leur «efficacité militaire» – leur brutalité – devint rapidement légendaire chez les Anglais qui craignaient autant les miliciens que les Amérindiens.Les milices canadiennes n'avaient pas toujours bonne réputation auprès des officiers français. Ainsi, l'adjudant-major général Pierre-André Gohin, comte de Montreuil, semblait partager la piètre opinion du général Montcalm et de son état-major sur les Canadiens. Dans un rapport rédigé le 12 juin 1756, il écrivait: «Le Canadien est indépendant, méchant, menteur, glorieux, fort propre pour la petite guerre, très brave derrière un arbre et fort timide lorsqu’il est à découvert.» Montcalm, comme la plupart des officiers français, n’avait que du mépris pour la petite guerre à l'indienne et croyait que la milice canadienne était un ramassis d’indisciplinés, dont la valeur militaire était à peu près nulle. Il n'en demeure pas moins que, dans les conditions normales de combat en Amérique du Nord, les miliciens canadiens étaient, au contraire des colons anglais, de redoutables guerriers, bien supérieurs au plan militaire.
Au cours du Régime français, on a recensé 579 déportés, soit les deux tiers des prisonniers envoyés au Canada. Quelques-uns d'entre eux étaient des «fils de famille» (qu'on préférait voir déportés plutôt qu'emprisonnés), mais les autres étaient issus des classes populaires; c'étaient surtout des contrebandiers, des braconniers et des déserteurs. Certains autres furent des prisonniers anglais déportés par la France au Canada. Par comparaison, la France enverra en Nouvelle-Calédonie (océan Pacifique), devenue une colonie française en 1860, plus de 40 000 prisonniers, soit quatre fois le nombre de colons et d'engagés qu'elle avait envoyés en Nouvelle-France.
2.4 Les «filles du roy»
On ne fonde pas une colonie en envoyant des militaires et de jeunes hommes célibataires. Ils reviendront tous. Or, comme partout en Nouvelle-France, l'élément féminin de la population du Canada était trop minoritaire (376) par rapport à l'élément masculin (639). Une telle politique intensive de peuplement ne pouvait réussir que si elle s'appuyait sur une politique de mariages. Pour ce faire, il fallait des femmes.
- La politique de mariages
Entre 1665 et 1673, le roi de France fit donc passer près de 900 filles au Canada afin de procurer des épouses aux colons. Le roi devait financer le voyage et doter chacune des candidates pour une somme variant entre 100 (cinq seulement) à 500 livres (deux seulement) par fille (selon la classe sociale), soit l'équivalent d'au moins 200 jours de travail d’un ouvrier (jusqu'à deux ans). Les filles destinées aux colons recevaient généralement une dot de 50 livres (50£), soit 100 jours de salaire. À cet octroi statutaire s'ajoutaient d'autres frais jugés essentiels. En plus des vêtements, il devait être fourni une cassette (coffre), une coiffe un mouchoir de taffetas, un ruban à souliers, cent aiguilles, un peigne, un fil blanc, une paire de bas, une paire de gants, une paire de ciseaux, deux couteaux, un millier d'épingles, un bonnet, quatre lacets et deux livres (2£) en argent sonnant. Parmi les conditions d'acceptation, les filles du roy devaient être âgées entre 16 et 40 ans, et n’être «point folles» ni «estropiées». En principe, il fallait de «jeunes villageoises n'ayant rien de rebutant à l'extérieur et assez robustes pour résister au climat et à la culture de la terre». En fait, la moitié des filles du roy viendront de la région parisienne. Les autres seront originaires de la Normandie, de l'Aunis, du Poitou, de la Champagne, de la Picardie, de l'Orléanais et de la Beauce. Une fois au Canada, l'intendant de la Nouvelle-France remettait à chacune des filles à marier «la somme de cinquante livres, monnaie du Canada, en denrées propres à leur ménage». Au total, moins d'une cinquantaine de filles du roy seront sélectionnées avec une dot importante pour épouser un officier des régiments royaux et un bourgeois (fonctionnaire).
.L'arrivée des premières «filles du roy» suscita une certaine résistance dans la colonie où, semble-t-il, la décision d'organiser des mariages fut au début mal perçue. Encore en 1670, l'intendant Jean Talon faisait allusion à la résistance de curés qui pouvaient hésiter à bénir les mariage hâtifs:
Si le Roi fait passer d'autres filles ou femmes veuves de l'ancienne en la nouvelle France, il est bon de les faire accompagner d'un certificat de leur curé ou du juge du lieu de leur demeure qui fasse connaître qu'elles soient libres et en état d'être mariées, sans quoi les ecclésiastiques d'ici font difficulté de leur conférer ce sacrement, à la vérité ce n'est pas sans raison, deux ou trois doubles mariages s'étant ici reconnus, on pourrait prendre la même précaution pour les hommes veufs. Et cela devrait être du soin de ceux qui sont chargés des passagers. Devant ces difficultés, le ministre Jean-Baptiste Colbert tentait de rassurer l'intendant Talon à propos de la qualité des jeunes filles. Le 11 février 1671, il écrivit ce qui suit à Talon:
J'ai aussi donné ordre de vous envoyer des certificats des lieux où les dites filles seront prises, qui feront connaître qu'elles sont libres et en état de se marier sans difficulté. - Les origines des émigrantes
Or, les futures épousées, généralement les «filles du roy», étaient des orphelines élevées par des religieuses aux frais du roi dans les grands couvents et les Maisons d'éducation de Paris, Dieppe, Honfleur et La Rochelle. On sait aujourd'hui que 23,9 % d'entre elles étaient originaires de l'Île-de-France, 19,4 % de l'Aunis, 14,9 % de la Normandie. Les autres provenaient surtout de la Bretagne, du Perche, du Poitou, de la Picardie, de la Saintonge, de la Champagne, de l'Anjou et de la Bourgogne.
Près de 90 % de ces filles à marier étaient issues de familles de petits fonctionnaires, de militaires, d'artisans et de paysans (en petit nombre); le reste provenait de la petite noblesse et de la bourgeoisie. Elles constituaient, pour l'époque, une sorte d'élite «sagement élevée» et «formée aux travaux d'une bonne ménagère», et elles n'étaient pas nécessairement mieux instruites que la plupart de leurs contemporaines, mais elles avaient acquis un niveau d'éducation normal pour leur l'époque. Le problème avec les filles du roi vient du fait qu'elles paraissaient en général «assez délicates», «peu robustes», «élevées en vue du service des grandes dames». Les émigrantes étaient concentrées dans des régions qui se trouvaient relativement à proximité de la capitale; de plus, les trois quarts des émigrantes venaient de centres urbains. En effet, près de 20 % d'entre elles étaient originaires de l'Île-de-France, dont une bonne partie de la Salpétrière (50 %), qui dépendait de l'Hôpital général créé par Louis XIV.
Le ministre Colbert recevait régulièrement des avis – dont ceux de l’intendant Jean Talon – pour qu'on envoie plutôt des «filles de village», «propres au travail comme les hommes». Dans les faits, on a dirigé vers le Canada des Françaises (plus de 70 %) issues des centres urbains, donc peu initiées aux travaux agricoles ni à la tenue d'une maison d'habitants. Dans les faits, on estime que les femmes de la Nouvelle-France comptaient 47,8 % d'artisanes, 18 % de paysannes, 15,5 % de manouvrières, 15,4 % de bourgeoises et 3,3 % de nobles.
De plus, pour favoriser les mariages et la natalité, on soumit à l'amende les hommes célibataires, on accorda des dots aux filles et des gratifications aux familles nombreuses. Avantagée par un taux extraordinaire de natalité (7,8 enfants par femme) et par une immigration abondante, le Canada vit se multiplier sa population; de 2500 habitants en 1663, elle passe à 20 000 en 1713 et à 55 000 en 1755.
Durant tout le Régime français, seulement 400 femmes sont arrivées au Canada, déjà mariées et accompagnant leur mari. Ces familles déjà constituées ont amené avec elles 528 enfants âgés de moins de 14 ans.
2.5 La qualité des émigrants
Par ailleurs, certains des contemporains de l'époque ont prétendu que les filles du roi étaient en réalité des «filles de joie» embarquées de force à bord de navires en partance pour le Canada. Or, à part quelques très rares exceptions, cette thèse s'est révélé fausse et non fondée. Déjà en 1639, le supérieur de la mission des jésuites au Canada réagit ainsi à ces rumeurs qui circulaient en France:
On nous a dit, lit-on dans la Relation des Jésuites de 1641, qu'il courait un bruit dans Paris, qu'on avait mené en Canada un vaisseau tout chargé de filles dont la vertu n'avait l'approbation d'aucun docteur : c'est un faux bruit, j'ai vu tous les vaisseaux, pas un n'était chargé de cette marchandise. Entre 1730 et 1750, l'éventail des immigrants s'élargit. Des colons du sud de la France sont venus s'installer, de même, répétons-le, des «fils de famille» qu'on exilait, beaucoup de contrebandiers du sel et des braconniers. On laissa des militaires s'établir pour de bon dans la colonie. On ferma même les yeux sur l'arrivée de huguenots (environ 500 au total) et de fugitifs venus des colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre (environ 1000), sans oublier un certain nombre d'esclaves noirs (environ 300).
Dans le contexte nord-américain de l'époque, les autorités françaises se méfiaient des huguenots parce qu'ils étaient protestants. Or, le voisinage des Anglais, également protestants, semblait représenter un trop grand risque en raison de la déloyauté éventuelle des colons protestants. Seuls quelque 500 huguenots arrivèrent au Canada, en principe sur une base provisoire à la condition de s'abstenir de toute manifestation religieuse publique, car seuls quelque 150 d'entre eux se sont effectivement installés en permanence dans le pays. Les autorités coloniales étaient conscients du rôle estimable des huguenots dans la vie économique du Canada, même si l'évêque de Québec souhaitait leur expulsion. À la fin du XVIIe siècle, on comptait dix fois plus de huguenots parlant français en Nouvelle-Angleterre que dans toute la Nouvelle-France (Canada, Acadie, Louisiane). En fait, plus de 200 000 huguenots français iront s'établir dans les colonies anglaises au sud du Canada, et 100 000 se sont réfugiés dans les États allemands, aux Pays-Bas et en Suisse. Le sort du Canada et de la Nouvelle-France aurait pu changer du tout au tout si ces 300 000 Français s'étaient établis au nord plutôt qu'au sud, surtout que les huguenots français étaient réputés pour être de fort bons marchands, négociants, armateurs et de formidables prêteurs.
2.6 Les coureurs des bois

Dans cet ensemble, il faudrait mentionner les «coureurs des bois», qui faisaient la traite des fourrures. Chaque année, quelque 400 hommes devenaient coureurs des bois. Ils étaient fort mal perçus par le clergé, parce qu'ils vivaient dans le concubinage, l'adultère et la «débauche publique». Vivant parmi les autochtones, ils en adoptaient les mœurs. Mais cette vie d'aventure se faisait au détriment du développement social au Canada. C'est pourquoi l'Administration coloniale dut sévir et rendre des ordonnances contre les coureurs des bois. De l'avis de l'intendant Jean Talon: «Les petits enfants ne pensent qu'à devenir un jour coureur des bois.» De fait, toute une jeunesse s'est mise à courir les bois et les belles sauvagesses. Des militaires ont emboité le pas, puis des colons. Bien des autochtones furent scandalisés et ne pardonnèrent pas aux Français de faire des enfants à leurs femmes et à leurs filles pour ensuite les abandonner. Même de grandes figures de l'histoire de la Nouvelle-France ont pratiqué clandestinement la traite des fourrures: le gouverneur de Montréal François-Marie Perrot, le gouverneur général marquis de Frontenac, le gouverneur général Joseph-Antoine Lefèbre de La Barre, l'intendant Jean Talon, le marquis de Vaudreuil (père), l'intendant Jean Bochart de Champigny, l'explorateur Robert Cavelier de La Salle, Antoine de La Mothe-Cadillac, tour à tour flibustier, explorateur, coureur des bois, trafiquant d'alcool et de fourrures, officier de la Marine, fondateur de la ville de Détroit, gouverneur de la Louisiane. C'est tout dire! Au total, le nombre total des coureurs des bois atteignait bon an mal an environ 800 personnes, ce qui est considérable pour une population de 10 000 colons. Néanmoins, c'est grâce aux coureurs des bois que le français devint la langue des Métis, tous bilingues ou polyglottes, et demeura la «langue de la fourrure» jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les coureurs des bois propageaient ainsi la langue française dans les forêts de l'Amérique du Nord, en plus de servir parfois d'interprète auprès des autorités françaises, bien que les gouverneurs de Québec préféraient généralement leurs officiers réputés plus honnêtes pour traduire les «harangues des sauvages». La présence des nombreux coureurs des bois favorisa aussi la désignation des lieux au moyen de dénominations françaises, et ce, non seulement au Canada, mais aussi dans toute la Grande Louisiane.
2.7 Les esclaves
En 1689, Louis XIV avait autorisé la colonie à importer des esclaves noirs, à la suite d'une demande présentée par François-Madeleine-Fortuné Ruette d'Auteuil de Monceaux, aussi connu sous le nom de Jean-François Ruette d'Auteuil (1658-1737), procureur général du Conseil souverain dès 1681. En raison de la rareté des domestiques et de leur coût prohibitif, Ruette d'Auteuil avait proposé de recourir à une main-d'œuvre moins coûteuse et plus soumise:
La manufacture des bois, soit par le moyen des moulins a scies ou autrement et mesme la culture des terres seroit encore propre a faire des retours en france et dans les Isles de L’Amerique, mais comme pour reussir dans ses sortes d’entreprises, il faut avoir quelque avance, et que les domestiques sont d’une rareté et charté extraordinaire ils ruinent tous ceux qui osent faire quelque entreprise. Pour y remedier on croit que sil plaisoit au Roy accorder la permission d'avoir dans ledit pays des esclaves negres ou autres comme il luy a plu de l’agréér aux Isles de l’amerique, se seroit le meilleur moyen pour reussir en toute sorte de manufacture joint aux graces quil auroit la bonté d’accorder a ceux qui se porteroient au bien et a l'augmentation dudit Pays. [Archives nationales de France, Fonds des Colonies. Série C11A. Correspondance générale, Canada, vol. 10, fol. 344-345v.] C'est pourquoi le célèbre Code Noir de 1685 promulgué par Louis XIV s'appliquait en Nouvelle-France. Mais c'est en 1709 qu'une ordonnance de Jacques Raudot, intendant de la Nouvelle-France de 1705 à 1711, a légalisé l'esclavage dans la colonie. Bien que l'importation d'esclaves noirs aient reçu la sanction royale, il n'y eut jamais au Canada d'importation massive. À la fin du XVIIe siècle, le nombre des esclaves demeurait encore très restreint: une trentaine d'Amérindiens et une dizaine de Noirs. En 1721, l'intendant Michel Bégon (de 1710 à 1726) assurait qu'une cargaison de 200 nègres trouverait rapidement preneur. Cependant, en raison des conflits entre les Français et les Anglais, aucune cargaison de nègres n'arriva à Québec. Il n'y a jamais eu de navire négrier arriver au Canada.
Les esclaves noirs entrèrent un à la fois, souvent comme butins de guerre pris sur les Anglais. Entre 1714 et 1760, il arrivait rarement plus de quatre ou cinq nègres dans la colonie, les meilleures années étant de 16 à 18, en comptant les négrillons nés au pays. Quant aux esclaves amérindiens, ils venaient généralement du réseau de la traite des fourrures et constituaient des «présents» échangés entre Blancs et Indiens. Contrairement aux Noirs, les Amérindiens pouvaient s'enfuir et retrouver leur tribu. C'est pourquoi il était plus aisé d'acheter des esclaves amérindiens qui venaient de très loin: la plupart provenaient de la région des Grands-Lac et du Mississipi, afin qu'ils aient moins de chances de regagner leur pays d'origine. Les historiens ont recensé et identifié au moins 4000 esclaves (noirs et amérindiens) entre 1700 et 1834, année de l'abolition de l'esclavage par la Grande-Bretagne. En un siècle et demi, ce nombre est peu élevé par comparaison aux autres colonies. Par exemple, dans la seule année 1749, on comptait 10 500 esclaves noirs à New York, la Caroline du Sud en avait 12 000 en 1721. En 1744, il y en avait 250 000 dans toutes les Antilles.
Les esclaves du Canada étaient composés aux deux tiers d'Amérindiens, le tiers de Noirs. Ils étaient surtout concentrés à Montréal (63%) et à Québec (33 %), mais il y en avait un nombre important à Détroit (Pays d'en haut), ce qui démontre que l'esclavage était un phénomène urbain. Les grands commerçants (marchands, négociants, bourgeois) possédaient environ la moitié de tous les esclaves, les autres demeuraient la propriété des personnalités publiques, souvent le gouverneur général, l'intendant, un haut fonctionnaire, un officier militaire, l'évêque, parfois une communauté religieuse ou un notaire, voire l'État qui les employait à des tâches ignominieuses (comme bourreau par exemple). Parmi les religieux, ce sont les jésuites et le Séminaire de Québec qui en ont possédé le plus, notamment dans leurs lointaines missions. Au Canada, les esclaves servaient tous comme domestiques. En général, les propriétaires d'esclaves en avaient un ou deux, question au moins de «faire bonne figure». Les «petites gens», sauf exceptions, ne possédaient généralement pas d'esclave. Il fallait débourser environ 900 livres (ou plus) pour un Noir, environ 400 (ou moins) pour un Amérindien. Un Noir vaut en principe deux Amérindiens! En général, les petites gens de la Nouvelle-France gagnaient de 40 à 120 livres annuellement. On possédait des esclaves par prestige, non pour des motifs économiques. Les esclaves étaient rapidement francisés, mais demeuraient souvent illettrés. Français et Canadiens ont été impliqués dans 39 mariages avec une esclave amérindienne (31) ou noire (8). Ces familles ont laissé une descendance forcément métissée, celle-ci ne devant pas dépasser les 5 % de la population d'aujourd'hui. L'esclavage se poursuivra durant le Régime britannique.
3 Les autochtones (Indiens)

Les autochtones ne représentaient que 10 % de la population du territoire administré par les autorités françaises, ce qui ne vaut toutefois que pour le Canada. La population amérindienne des «Pays d'en haut», du «Pays des Illinois» et de la Louisiane était proportionnellement beaucoup plus importante que dans la vallée du Saint-Laurent. Les Français qui s'installèrent sur ses rives ne délogèrent jamais les populations autochtones, ni ailleurs en Nouvelle-France. Au Canada, ils s'allièrent s'allièrent avec les Micmacs, les Abénakis, les Montagnais et les Hurons; plus au sud (Louisiane), ils s'allièrent avec les Illinois, les Pieds-Noirs, les Saulteux, les Miami, les Kikapoux, les Chouanons, les Chacta, les Bayogoula, les Houma, les Quipa, les Ponca et les Ayohouais. 3.1 Des alliés incontournables
Les Français au Canada, comme dans toute la Nouvelle-France (Acadie, Louisiane et région des Grands Lacs, c'est-à-dire le «Pays des Illinois» et le «Pays des Ohio»), furent plutôt exceptionnels (comme Européens!) dans la façon dont ils s'allièrent avec les Premières Nations.
Contrairement aux Espagnols et aux Portugais qui érigèrent leur empire sur la conquête, la sujétion et la servitude, contrairement aussi aux Américains qui massacrèrent les autochtones pour s'approprier leurs terres, les Français ne furent jamais assez puissants pour agir de cette façon. Au contraire, il comblèrent les autochtones de cadeaux (outils, armes et munitions, aliments, vêtements, ustensiles de cuisine, animaux, etc.), afin de bénéficier de leur collaboration dans la traite des fourrures et, après 1680, pour recevoir leur appui militaire. C'est pourquoi les Français ont pu développer une version «plus subtile» du colonialisme européen.
Néanmoins, les Français ne perçurent jamais les autochtones comme des partenaires égaux, mais comme des subalternes indisciplinés avec lesquels il fallait savoir s'y prendre, de peur qu'ils oublient leurs «devoirs». Les Français les considéraient aussi comme des «sauvages», des «brutes» et des «païens» qu'ils fallait convertir ou exterminer. Lorsque des tributs partaient en guerre les unes contre les autres, brûlaient leurs propres villages, ravageaient leurs champs et s'exterminaient les uns les autres, les Français observaient une stricte neutralité, tout en se félicitant du «travail» accompli. En 1687, le gouverneur Denonville reçut de Versailles l'ordre de s'emparer du plus grand nombre possible de guerriers iroquois afin de les envoyer aux galères, «enchaînés et sous bonne garde». Quant aux officiers français, ils considéraient généralement les Indiens avec mépris, mais estimaient qu’il était préférable de les avoir avec soi plutôt que contre soi. Même s'ils vivaient au beau milieu de la colonie canadienne du roi de France, les autochtones ne reconnurent jamais la «souveraineté du roi de France» et conservèrent toujours leur autonomie.
Afin de compenser leur infériorité numérique face aux colonies britanniques, les Français développèrent toutes sortes d'habiletés à former des alliances avec les «Sauvages», et ce, dans toute l'Amérique du Nord, de l'Acadie jusqu'aux confins de la Louisiane en passant par le Canada. Évidemment, les Français se sont servis des autochtones pour attaquer les Anglais de la Nouvelle-Angleterre. Les gouverneurs de la Nouvelle-France ont organisé régulièrement des raids avec des Indiens afin de terroriser les colons de la Nouvelle-Angleterre. La présence des Indiens dans les rangs des milices canadiennes démoralisait l'ennemi par la terreur qu'elle suscitait. Les Français les formaient en escouades de guérilla qui étaient jetées sur les habitations britanniques. Quand il le fallait, il suffisait de convaincre les autochtones que les Anglais étaient de dangereux hérétiques pour les lâcher dans des «guerres saintes». En Acadie, ce genre de campagne était très fréquent. En général, ces expéditions étaient accomplies avec une audace folle par des miliciens canadiens ou acadiens et des Indiens intrépides, et elles n'étaient jamais suivies d'une occupation. Mais les représailles attiraient d'autres représailles, le sang appelait le sang, la vengeance entraînait la vengeance. On ne soupçonne pas assez jusqu'à quel point les «maudits Anglais», à force d'être constamment harcelés, ont décidé de prendre les grands moyens pour mettre fin à la présence française en Amérique.
3.2 La religion chrétienne
Bien que, dans l'ensemble, les relations entre les autochtones et les Français, ainsi que les Canadiens, aient été pacifiques, elles furent néfastes pour les autochtones qui attrapèrent des maladies et des épidémies, ce qui décima une grande partie de leur population. Ainsi, les Hurons ont vu leur nombre réduit de moitié par des épidémies au cours des premières décennies de l'histoire de la Nouvelle-France. C'est également ce qui explique le peu de considération des autochtones à l'égard des Européens. Il suffit de lire les comptes rendus des missionnaires et des explorateurs. Pour les autochtones, les Français barbus étaient des créatures physiquement inférieures, difformes, hirsutes et moralement dépravées, qui répandaient la maladie sur leur passage et faisaient fuir le gibier. Si le port de la barbe, perçu comme des «cheveux sur la bouche» par les autochtones, était mal considéré, la tenue vestimentaire, en revanche, les éblouissait et ils l'ont adoptée dès qu'ils l'ont pu, surtout les chapeaux. Il en était ainsi des boissons comme le vin et l'eau-de-vie.
Les missionnaires français considéraient les autochtones comme des «païens» parce qu'ils n'avaient pas de mots pour exprimer les notions telles que la vertu, le vice, la tentation, les anges, la grâce, etc. Par contre, les symboles de la religion chrétienne, comme la croix, les flammes de l'enfer, les foudres de Dieu, etc., terrifiaient les Indiens. C'est pourquoi les autorités françaises avaient tendance à se servir des missionnaires, en tant qu'agents de la politique de l'État, pour «civiliser» les «Sauvages». Le gouverneur de l'île Royale (île du Cap-Breton) de 1718 à 1739, Joseph de Monbeton de Brouillan, écrivait: «Il n'y a que ces hommes qui peuvent maîtriser les Sauvages pour qu'ils obéissent à Dieu et au Roy.» Les Anglais adopteront plus tard cette coutume française! En général, les autochtones ne portaient pas en haute estime les missionnaires qu'ils appelaient les «Robes noires». Il ne les trouvaient pas normaux parce qu'ils ne couchaient pas avec leurs femmes.
L'un des moyens efficaces de s'allier les Indiens consistait à leur vendre des mousquets et des fusils uniquement s'ils se convertissaient à la religion chrétienne. Comme le faisait remarquer un observateur de l'époque (voir Thwaites, éd., vol. XXV: 27, 10) : «L'emploi d'arquebuses, refusé aux Infidèles par Monsieur le Gouverneur et accordé aux néophytes chrétiens, est un puissant attrait pour les gagner: il semble que Notre Seigneur a l'intention de se servir de ce moyen afin de rendre le christianisme acceptable dans ces régions.» Malgré tous les efforts des missionnaires, les Amérindiens échappèrent néanmoins à leur emprise. Au cours de toute l'histoire de la Nouvelle-France, l'évangélisation n'a produit qu'un petit nombre de vocations religieuses chez les Amérindiennes, alors que pas un seul Amérindien n'est devenu prêtre! Il faut dire que la croix des missionnaires ne faisait pas le poids devant le castor.
Si l'on se fie aux registres des missions, par exemple ceux de Québec, Montréal, Tadoussac, etc., les autochtones étaient baptisés selon des appellations amérindiennes, bien que des prénoms européens vinrent remplacer graduellement les noms amérindiens. Les missionnaires n'avaient pas toujours en haute estime les autochtones. Voici le témoignage d'un jésuite décrivant l'assemblée générale d'une tribu:
C'est une troupe de crasseux, assis sur leur derrière, accroupis comme des singes et ayant leurs genoux auprès de leurs oreilles, ou bien couchés différemment, le dos ou le ventre en l'air, qui tous, la pipe à la bouche, traitent des affaires d'État avec autant de sang-froid et de gravité que la junte d'Espagne ou le Conseil des Sages à Venise. Mais les autochtones pouvaient aussi mépriser certains aspects des Français, notamment leur barbe.
3.3 La multitude des langues
Les premiers Français arrivés en Amérique se rendirent compte du multilinguisme qui caractérisait les populations amérindiennes. Dans son Thrésor de l'histoire des langues de cest univers (1613), Claude Duret décrivait ainsi les langues des autochtones de l'Amérique en faisant un parallèle avec la diversité des langues de France:
Les effects de la confusion de Babel sont parvenus jusques à ces peuples, desquels nous parlons, aussi bien qu'au Monde deça. Car je vois que les Patagons parlent autrement que ceux du Bresil, et ceux cy autrement que les Perouans, et les Perouans sont distinguez des Mexicains, les Isles semblablement ont leur langage à part, en la Floride on ne parle point comme en Verginia : nos Souriquois et Etchemins n'entendent point les Almonchiquois, ni ceux cy les Iroquois : bref chacun peuple est divisé par le langage : voire en une mesme Province il y a langage different, ne plus ne moins qu'ez Gaules le Flament, le bas Breton, le Gascon, le Basque ne s'accordent point. Pour Duret, l'Europe et l'Amérique étaient soumis aux «effets de Babel». Comme on peut le lire dans le Brief recit de la navigation faicte es ysles de Canada (1545), Jacques Cartier s'est souvent heurté au mur des langues lorsqu'il désirait communiquer avec les «Indiens»:
Et nous fut dict et monstre par signes par nosdictz trois hommes du pais qui nous avoient conduict, qu'il y avoit telz saulx d'aue audict fleuve, comme celuy où estoient nosdictes basques, mais nous ne peusmes entendre quelle distance il y avoit entre l'un et l'autre par faulte de langue: puis nous monstroient par signes que lesdiz saulx passez, l'on pouvoit naviguer, plus de trois lieues par ledict fleuve. De fait, les autochtones parlaient un grand nombre de langues différentes. Les principales familles de langues étaient les suivantes:
- Famille eskimo-aléoute (Grand Nord): inuktitut, inuinnaqtun, inuktun.
- Famille algonkienne (Canada): cri, montagnais (innu), naskapi, ojibwa, fox, chippewa, ottawa, delaware, abenaki, malécite, micmac, etc.
- Famille iroquoienne (Canada): mohawk, oneida, seneca, cayuga, wyandot, cherokee, etc.
- Famille muskogéenne (Louisiane): chacta, chicacha, têtes-plates, crics, natchez, bayogoula, houma, alibamou, chéraqui, quinipissa, yamassi.
- Famille sioux ou siouane (Canada et Louisiane): assiniboine, catawba, mandan, chiwere, iowa, dakota, lakota, stoney, dhegiha, kansa, winnebago, mississippi, missouri, etc.
- Famille iowa (Louisiane): ayohouais.Il fallut des décennies aux Français pour surmonter les obstacles linguistiques avec les autochtones.
3.4 Le métissage
Dès leur arrivée, les Français tentèrent une politique d'«intégration» des Amérindiens au moyen du mariage, de la culture et de la langue française, sans succès. Dès 1618, Champlain avait dit aux Hurons: «Nos jeunes hommes marieront vos filles, et nous ne formerons plus qu'un peuple.» L'Église approuvait cette politique dans la mesure où les mariés s'étaient préalablement convertis au catholicisme! Plus tard, vers 1680, Versailles prévoira même des frais de 3000 livres, divisés en dots de 50 livres, pour chaque Indienne qui épousera un Français. Cette politique de mariages mixtes ne s'est jamais vraiment matérialisée au Canada, avec seulement 120 unions officielles. Pourtant, au moment des premiers contacts avec les Européens, les Amérindiennes jouissaient dans leur société d'une plus grande liberté et d'une plus grande influence que les Européennes de la même époque. Dans les faits, il dut y avoir de nombreuses unions «à la façon du pays», c'est-à-dire sans mariage formel, ce qui était perçu par les missionnaires comme une forme de concubinage. Finalement, en 1735, les autorités coloniales édictèrent un décret exigeant le consentement du gouverneur pour tous les mariages mixtes! Bon nombre de coureurs des bois fondaient une seconde famille dans les forêts, car ils entretenaient des relations semi-permanentes avec des femmes amérindiennes. On appelait soit «Métis» soit «sangs-mêlés» les enfants de la traite des fourrures. Par ailleurs, le Régime français avait adopté une étrange pratique, qui consistait à «donner» aux Amérindiens les enfants illégitimes nés d'une Blanche. À l'exemple des prisonniers qu'on allait chercher dans les colonies anglaises, ces enfants étaient alors élevés comme des Indiens et parlaient leurs langues. D'ailleurs, en 1752, l'ingénieur militaire français Louis Franquet (1697-1768), inspecteur des fortifications et des constructions en Nouvelle-France, donne ainsi ce témoignage après une visite du village iroquois de Kahnawake (ancien Caughnawaga) près de Montréal : «Il y a parmi eux plusieurs bâtards français et beaucoup d'enfants anglais faits prisonniers en la dernière guerre et qu'ils ont adopté. Ces enfants sont élevés avec les façons et les inclinations sauvages.»
On sait, par exemple, que les autochtones alliés des Français ont fait de nombreux prisonniers parmi les colons anglais et qu'ils les ont mariés de force avec les femmes de leurs propres villages. On estime à environ 1000 le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés aux colonies anglaises et transplantés au Canada dans les communautés amérindiennes. Toutefois, la plupart des «Anglais» (aussi des Écossais et des Irlandais) ont ainsi capturés ont fini par s'intégrer à la société blanche, ce qui explique que des Canadiens de langue française ont porté des noms de famille anglais, sans jamais connaître un seul mot d'anglais.
En fait, il y a eu beaucoup plus de «sang blanc» chez les Indiens que de «sang indien» chez les Blancs. Il est erroné de croire que la plupart des Québécois d'aujourd'hui ont du «sang indien» dans leurs veines, car ce sont les Amérindiens, notamment les Mohawks, qui ont dû composer avec les effets du métissage dans leurs villages.
3.5 La politique française d'assimilation
Dans le but d'assurer la pérennité de la France, les autorités françaises fondèrent de grands espoirs et fournirent des efforts pour assimiler les Indiens, comme le laisse entendre une lettre de Mère Marie de l'Incarnation, responsable de l'éducation des enfants, en date de 1668:
Nous avons francisé plusieurs filles Sauvages, tant Huronnes qu'Algonquines, que nous avons ensuite mariées à des Français, qui font fort bon ménage. Il y en a une, entre autres, qui sait lire et écrire en perfection, tant en sa langue huronne qu'en notre française; il n'y a personne qui la puisse distinguer ni se persuader qu'elle soit née Sauvage. [...] Sa majesté [...] désire que l'on francise ainsi peu à peu tous les Sauvages, afin d'en faire un peuple poli. L'on commence par les enfants. Mgr notre Prélat en a pris un grand nombre à cet effet, les révérends Pères en ont pris aussi en leur collège de Québec; tous sont vêtus à la française, et on leur apprend à lire et à écrire comme en France. Nous sommes chargées des filles, conformément à notre esprit [...]. Dès cette époque, les récollets et les jésuites avaient même mis sur pied un programme destiné à envoyer des enfants amérindiens en France pour qu'ils adoptent un bon niveau de français et, que, à leur retour, ils puissent exercer sur leurs compatriotes une influence suffisante qui les pousserait à adopter la culture française. En 1636, le père Le Jeune écrivait dans les Relations des jésuites:
Afin de les dépaïser, & de leur donner le moyen d'apprendre la langue, & l'honnesteté Françoise, pour secourir par après leurs compatriotes; nous avons délibéré d'en envoyer deux ou trois en France, pour les faire loger & instruire en la maison des Hospitalières qu'on desire faire passer en la Nouvelle France. Mais le programme fut vite mis au rancart en raison du «caractère pervers» des Indiens!
Le puissant ministre Colbert tenta bien de relancer un «programme de francisation» en 1668. Celui-ci se plaignait à l'intendant Talon parce qu'on n'avait pas obligé les sauvages à «s'instruire dans notre langue, au lieu que pour avoir quelque commerce avec eux, nos Français ont été nécessités d'apprendre la leur». Dans une lettre à l'intendant Talon, Colbert écrivit le 13 novembre 1666:
Je vous avoiie que fay jugé comme vous que l'on s'est fort peu soucié jusques icy de la police et de la vie civile en Nouvelle
France envers les Algonkins et les Hurons qui sont il y a longtemps soumis à la domination du Roy en faisant peu d'efforts
pour les destacher de leurs coustumes sauvages et les obliger à prendre les nostres, et sur tout à s'instruire dans notre langue, au lieu que pour avoir quelque commerce avec eux nos françois ont été nécessitez d'apprendre la leur. Vous avez commencé de remédier à cette longue negligence. Et vous devez tascher d'attirer ces peuples sur tout ceux qui ont embrassé le Christianisme dans le voisinage de nos habitations et s'il se peut les y mesler, afin que pour la succession du temps n'ayant qu'une mesme loy et un mesme ministre ils ne fassent plus ainsy qu'un mesme peuple et un mesme sang.Un tel programme dit «de civilisation» reposait sur l'éducation de jeunes enfants dans le cadre des pensionnats. Mais les écoles-pensionnats de la colonie se vidèrent rapidement de leurs élèves autochtones, qui ne purent s'adapter à des horaires stricts.
Néanmoins, en juillet 1673, le gouverneur Frontenac, qui n'avait pas oublié la préoccupation des autorités royales à propos de l'assimilation des Amérindiens, s'adressait ainsi aux représentants des Cinq Nations iroquoises à Cataracoui, dans le style habituellement «paternaliste» propre aux gouverneurs français:
Mes enfants, je suis consolé de vous voir arriver ici où j'ai fait allumer un feu pour vous voir pétuner [«fumer du pétun» signifiant «tabac»] et vous parler. Ô que c'est bien fait, les enfants, d'avoir suivi les ordres et les commandements de votre père. Prenez donc courage, mes enfants, vous y entendrez sa parole qui vous est toute pleine de douceur et de paix. [...]. Je vous conjure avec toutes sortes d'instances de faire apprendre à vos enfants la langue française que les Robes-Noires [prêtres] peuvent leur enseigner, cela nous unirait davantage et nous aurions la satisfaction de nous entendre les uns les autres sans interprète. Toutefois, très tôt, les Français se rendirent compte du caractère utopique de cette entreprise d'assimilation. Les «Sauvages» se sont montrés très réfractaires à la francisation. «Ils ne se soucient guère d'apprendre nos langues», lit-on dans les Relations des jésuites. Les autorités françaises s'aperçurent que la francisation des Amérindiens, même pris «à la mamelle», était un mirage. L'intendant Antoine-Denis Raudot (de 1705 à 1710) estimait en 1710 qu'il s'agissait là d'«un ouvrage de plusieurs siècles»:
Il faudra un travail et un tems infiny pour affranchir ces peuples et pour pouvoir les réduire à prendre nos usages et nos coutumes, ce ne sera que par une application continuelle sur eux et peu à peu qu'on y pourra parvenir, et c'est, je vous assure, un ouvrage de plusieurs siècles. (Relation par lettres de l'Amérique septentrionale). Comme les Amérindiens contrôlaient le commerce des fourrures et qu'ils tenaient les Français à leur merci, ils ne se sentirent jamais obligés d'apprendre le français. Ce sont donc les Français qui durent «se mettre à l'école des Sauvages» et apprendre leurs langues. Cependant, seuls quelques Français les apprenaient, par nécessité, afin de servir d'interprète.
3.6 Les interprètes
Aux dires de mère Marie de l'Incarnation: «On fait plus facilement un Sauvage avec un Français qu'un Français avec un Sauvage.» Les missionnaires comprirent vite qu'il leur fallait maîtriser les rudiments des langues amérindiennes. Ils ne pouvaient pas attendre qu'on ait francisé les petits Amérindiens qu'on envoyait parfois en France. Ils se mirent donc au huron, au montagnais (innu), au naskapi, à l'abénaki, au malécite, au micmac, etc. Vers 1625, le récollet Joseph Le Caron (vers 1586 - 1632) présenta même au roi Louis XIII un dictionnaire huron. En 1632, le récollet Gabriel Sagard (vers 1580-1636) publia le Dictionnaire de la langue huronne (132 pages). Au XVIIe siècle, le huron servait de langue véhiculaire entre les Amérindiens de la région des Grands Lacs. Maîtriser la langue huronne, c'était se donner la possibilité d'entrer en contact avec plusieurs nations autochtones. Dès leur arrivée à Québec en 1639, les ursulines se sont mises aussi à l'étude des langues indiennes et rédigèrent des catéchismes en huron et en algonquin.
Il existait aussi une pratique qui consistait à retenir chez soi les services d'un autochtone qui jouait le rôle d'un «maître en langue sauvagine». Ce fut un échec complet, les maîtres improvisés manquant totalement de rigueur intellectuelle. De plus, il fallait leur distribuer du tabac et les nourrir de manière honorable. Par ailleurs, les Français se rendirent compte que les langues amérindiennes se prêtaient mal à la traduction des concepts religieux, théologiques ou abstraits. Il fallait constamment recourir à des périphrases.
À cette époque, plusieurs jeunes Français n'hésitaient pas à séjourner chez les Amérindiens pour devenir interprètes. Pour obtenir de bons interprètes, les gouverneurs devaient régulièrement envoyer des officiers français habiter dans les villages autochtones durant une année pour qu'ils apprennent les langues amérindiennes. Les individus qui avaient réussi à apprendre la langue des Amérindiens étaient très considérés et très recherchés auprès des commerçants et des compagnies de la Nouvelle-France. Quant aux gouverneurs, ils faisaient généralement appel à des officiers bilingues ou polyglottes qu'on avait envoyé auparavant séjourner chez les Indiens.
Bref, les autochtones se sont toujours satisfaits du service des interprètes blancs, ce qui les dispensait d'apprendre le français. Ils ne correspondaient guère à l'image que s'en faisaient beaucoup de Français: les «simples Sauvages» n'auraient été à l'état naturel qu'une pâte dans l'attente d'un modelage faite par une main civilisatrice!
3.7 L'art d'haranguer les «Sauvages»
Même les plus hautes autorités de la colonie, les gouverneurs en tête, durent s'adapter aux coutumes et valeurs des autochtones. Encore davantage que le réputé comte de Frontenac (gouverneur de 1672 à 1682, et de 1689 à 1698), le gouverneur Louis-Hector de Callières (1698-1703) était passé maître dans l'art d'haranguer les «Sauvages», lui qui avait rencontré souvent les ambassadeurs des Cinq Nations iroquoises. C'est pourquoi il est pertinent de citer cette harangue prononcée par M. de Callières, le 4 août 1701, devant 1300 représentants iroquois venus signer la Grande Paix à Montréal:
Je rattifie donc aujourd'huy la paix que nous avons faite [...] voulant qu'il ne Soit plus parlé detous les coups faits pendant la guerre, et je me saisy de nouveau de toutes vos haches, et detous vos autres instruments de guerre, que je mets avec les miens dans une fosse sy profonde que personne ne puisse les reprendre pour troubler la tranquilité que je rétablis parmy mes Enfants, [...] je vous invite a fumer dans ce calumet de paix ou je commence le premier, et a manger de la viande et du bouillon que je vous fais preparer. Comme tous les gouverneurs français du Canada, Callières se donnait le rôle du «père» qui parle à ses «enfants», tel le roi avec ses sujets. Mais, contrairement à Versailles, il a recours à plusieurs métaphores typiquement amérindiennes: la «fosse» dans laquelle les haches sont enterrées, le «bouillon» de la chaudière qu'on partage, le «calumet de paix» si vénéré par les Amérindiens, etc. Les propos du gouverneur étaient certes proclamés en français, mais de nombreux interprètes les traduisaient aussitôt pour les différentes nations indiennes. Ce type de discours imagé ne pouvait que plaire aux autochtones et il témoignait d'une certaine dose d'adaptation de la part du gouverneur. Par la suite, celui-ci et ses officiers allèrent rejoindre les «Sauvages» dans leurs danses cérémonielles, tomahawk à la main, avec de grands cris et hurlements. En réalité, le gouverneur Callières ne faisait qu'imiter l'un des ses plus illustres prédécesseurs, le comte de Frontenac, lors d'une cérémonie similaire en 1690. Le père Charlevoix avait alors apprécié le comportement de Frontenac dansant avec le tomahawk en hurlant des cris de guerre: «Les Sauvages furent enchantés de ces manieres du Conte de Frontenac, & ne lui répondirent que par des acclamations.»
Les Français prenaient soin d'adapter leurs propositions à l'auditoire et de se servir de notions facilement compréhensibles pour chaque groupe, comme l'illustre cette autre harangue (rapportée par Pierre Margry dans Découvertes et établissements dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique septentrionale, 1614-1754) destinée aux membres du clan saulteux des Cigognes:
Chaque matin, vous regarderez vers le soleil levant et vous verrez le feu de votre Père français se réfléchir vers vous, pour vous réchauffer, vous et votre peuple. Si vous avez des ennuis, vous, les Cigognes, devez vous élever dans les cieux et crier avec vos voix ''qui portent au loin'', et je vous entendrai. Le feu de votre Père français brûlera à jamais et réchauffera ses enfants. De fait, les Français devinrent très habiles dans l'emploi du langage imagé des autochtones.
Mais les Amérindiens ont dû, eux aussi, s'adapter à la langue des Français. Par exemple, le successeur de Champlain, le gouverneur Charles Jacques du Huault de Montmagny (1636-1648), avait un nom difficile à prononcer pour les autochtones. Ils traduisirent son nom par Ononthio, c'est-à-dire la «grande montagne» parce qu'ils avaient aussi été impressionnés par la stature imposante du gouverneur et sa grande dignité. Par la suite, ils imposèrent ce nom à tous les gouverneurs français. Quant au roi de France, ce très lointain souverain, il devint pour eux le «Grand Ononthio».
3.8 Le prix des alliances indiennes
Pour les gouverneurs du Canada, la «politique indienne» avait préséance sur tout le reste, car sans leurs alliés indiens les colonies de la Nouvelle-France (Acadie, Canada, Louisiane) auraient été des coquilles vides appelées très tôt à disparaître. D'ailleurs, sous la pression d'Indiens mécontents, les gouverneurs allaient jusqu'à démettre de leurs fonctions les officiers à la source des «mécontentements». De plus, les lois françaises ne s'appliquaient pas aux Amérindiens qui se percevaient comme des gens libres et souverains, non comme des «sujets français». Ils n'appréciaient guère d'être jetés dans les prisons françaises pour avoir enfreint des lois dont ils ignoraient tout, et qu'ils auraient encore moins acceptées s'ils les avaient connues. Un officier français, le chevalier Raymond de Nérac parle ainsi du prix à payer pour s'allier les «Sauvages»:
Il est incroyable la politique et les ménagements qu'il faut avoir pour les Sauvages, pour se les conserver fidèles. [...] C'est pourquoi toute l'attention que doit avoir un commandant pour servir utilement, c'est de s'attirer la confiance des Sauvages où il commande. Pour y parvenir, il faut qu'il soit affable, qu'il paraisse entrer dans leurs sentiments, qu'il soit généreux sans prodigalité, qu'il leur donne toujours quelque chose. Les autochtones ont donc toujours bénéficié d'un «statut particulier» en Nouvelle-France. La colonie consacrait en moyenne de 8 % à 10 % de son budget pour acheter la loyauté des chefs amérindiens: cadeaux, vêtements, alcool, armes, repas somptueux, etc. La plupart des chefs possédaient un médaillon représentant le roi de France surnommé «le Grand Onontio» ou «la plus grande montagne sur terre».
Grâce à leurs nombreux contacts avec les Indiens, les voyageurs, les négociants et les soldats utilisèrent de façon systématique les «méthodes indiennes», tellement il paraissait important de conserver les alliances avec les autochtones. Si les Français ont toujours su pratiquer une diplomatie intelligente avec les Amérindiens, c'est qu'ils n'avaient guère le choix. En réalité, il s'agissait d'une sorte de manipulation de la part des Français, et les Indiens le savaient, mais c'était une façon pour ces derniers de tirer profit de la situation. Les «Sauvages» ont maintes fois démontré qu'ils pouvaient être aussi roublards que courageux!
4 L'implantation du français au Canada
Compte tenu de la situation de fragmentation linguistique qui avait cours en France sous l'Ancien Régime, on peut supposer que les émigrants français parlaient leur «patois» d'origine avant d'arriver au Canada. Selon cette hypothèse, les colons auraient pu apporter avec eux leur normand, leur picard, leur aunisien, leur poitevin, leur breton, etc.
Cette question du «choc des patois» a soulevé déjà de nombreuses controverses, notamment en 1984 lorsque le linguiste Philippe Barbaud a publié une étude intitulée Le choc des patois en Nouvelle-France (Presses de l'Université Laval). Selon cet auteur, les colons français parlaient leur patois local, soit le normand, le picard, l'aunisien, le poitevin, le breton, etc., avant d'arriver au Canada. Mais ce livre a attiré les foudres des historiens qui contestent cette étude uniquement spéculative, car elle ne reposerait sur aucun fait vérifiable.
4.1 Les français régionaux importés de France
Les émigrants français sont arrivés plus massivement à partir de 1663, alors que la population canadienne n'atteignait que 2500 habitants, puis est passée à 10 000 en 1681 et 15 000 en 1700. On sait cependant que les villes françaises ont engendré cinq fois plus d'immigrants que les campagnes. Or, les habitants des villes françaises parlaient à l'époque un français régional, pas les patois. Cela signifie que les deux tiers des émigrants connaissaient déjà le français à leur arrivée au Canada, aussi régional qu'il fût! On sait aussi que les villes portuaires d'embarquement, telles que Bordeaux, La Rochelle, Rouen ou Dieppe (d'où partirent la majorité des émigrants), constituaient des centres urbains très francisés (entre 80 % à 90 %) et que les patoisants qui venaient y vivre devenaient rapidement des semi-patoisants bilingues. Les historiens croient aussi que la connaissance du français a pu servir de critère de sélection des candidats à l'émigration pour le Canada. Bref, les candidats à l'émigration pour le Canada ont généralement fait un long séjour en milieu urbain avant leur départ et avaient par conséquent acquis une bonne connaissance du français, ce qui ne signifie pas que le français était pour tous leur langue maternelle.
Cela étant dit, on peut supposer que, dans l'hypothèse la plus favorable, le tiers des émigrants ruraux arrivant au Canada aurait pu conserver encore leur patois d'origine, ce qui n'implique pas qu'ils ignoraient le français. En réalité, même les ruraux qui voulaient partir pour le Canada avaient une certaine connaissance du français, car ils n'habitaient jamais très loin des centres urbains qui furent les plus grands réservoirs d'émigrants. Selon toute vraisemblance, les pionniers d'origine rurale étaient majoritairement des francisants ou des semi-francisants (ou semi-patoisants), rarement de purs patoisants, à l'exception des émigrants provenant du sud de la France, mais pas ceux du Nord-Ouest. Quoi qu'il en soit, la plupart des ruraux étaient de toute façon en contact avec le français. Dans les faits, très rares devaient être les unilingues patoisants parmi la portion du tiers des émigrants ruraux connaissant encore leur parler régional.
De façon générale, les émigrants qu'on pourrait appeler des francisants comprenaient et parlaient l'une ou l'autre des variantes du français de l'Île-de-France ou d'une autre région importante. À part les nobles, les membres du clergé, les officiers militaires, les administrateurs et quelques grands négociants, les francisants ne parlaient pas la «langue du roy», mais un français populaire parsemé de provincialismes et d'expressions argotiques.
Les locuteurs semi-patoisants parlaient leur patois maternel, soit le normand, le poitevin, le bourguignon ou le lorrain, mais ils pouvaient comprendre l'une ou l'autre des diverses variétés du français; leur connaissance passive du français permettait donc une compréhension partielle. Quant aux patoisants, ils ignoraient totalement le français commun; lorsqu'on leur parlait en français, ils devaient recourir aux services d'un interprète. Les archives canadiennes ne révèlent qu'un seul cas connu de l'emploi d'un patois lors d'un procès qui a eu lieu dans les années 1660. Cela signifie que l'usage d'un tel patois pouvait être seulement possible, sans que l'on en sache davantage. Dans ce cas, il ne pouvait s'agir que d'émigrants du sud de la France. Selon toute probabilité, la présence des patois au Canada fut quasiment nulle ou, en tout cas, pas du tout significative.
Le professeur Lothar Wolf, de l'Université d'Augsburg en Allemagne et l'un des grands spécialistes du français québécois, conclut que la majorité des colons français qui sont arrivés en Nouvelle-France avaient déjà une connaissance du français:
Le provenance géographique des colons de la Nouvelle-France, leur condition sociale et leur instruction concordent avec le portrait linguistique global qui se dégage des témoignages cités et permettent raisonnablement de conclure que la majorité d'entre eux parlaient le français ou utilisaient le français avant d'émigrer. Cette situation n'aurait fait que se renforcer au sein même de la colonie, à la faveur des échanges, des mariages ou de l'instruction. («Les colons de la Nouvelle-France» dans Le français au Québec, 400 ans d'histoire et de vie, Publications du Québec, 2003, p. 25-27). Le français canadien semblait donc correspondre au français courant alors en usage dans la région de Paris et parlé par le peuple de Paris. Ce n'est qu'après la Conquête anglaise que les Canadiens évolueront différemment.
4.2 Les causes de l'unification linguistique
Très tôt, le français s'est assuré la dominance en Nouvelle-France sans qu'aucune politique linguistique n'ait été élaborée ni même pensée; ce n'était pas dans les habitudes de l'époque. Néanmoins, un certain nombre de facteurs, indéniables, ont favorisé cette unification.
- Le français du roy
Le français était la langue de l'administration royale, celle des fonctionnaires, des officiers, des milices et de l'armée. Chaque année, en janvier, le gouverneur général et toute sa cour, de même que l'intendant, quittaient Québec pour Montréal (en passant par la rive nord, avec des relais à Neuville, Trois-Rivières et Berthier) et y séjournaient deux ou trois mois, amenant avec eux les bagages du personnel, les archives, les vêtements, la vaisselle et les abondantes provisions de bouche. Montréal devenait ainsi une capitale provisoire. C'est ainsi que le français du roy était répandu et entendu dans presque toute la vallée du Saint-Laurent. Tous les documents administratifs étaient rédigés en français et les ordres étaient donnés en «français du roy» aux soldats, dont un bon nombre de mercenaires (allemands et suisses). C'était également la langue du clergé, premier ordre social de la colonie: les ecclésiastiques, hommes ou femmes, ne s'exprimaient qu'en français, à l'exception des missionnaires, qui évangélisaient les Amérindiens dans leur langue. Tous les marchands, commerçants et entrepreneurs français ne parlaient généralement que le français de France.
Dans les écoles, on enseignait la religion, les mathématiques, l'histoire, les sciences naturelles et le français, lequel, rappelons-le, n'était pas encore enseigné en France aux «petites gens». Cet enseignement primaire ouvert à tous les habitants, même dans les campagnes, constituait une première pour l'époque et a certes joué un rôle non négligeable dans le processus de francisation, surtout dans le développement de la norme parisienne.
On doit souligner aussi que l'arrivée des militaires au Canada fut certainement l'une des causes ayant favorisé le plus la francisation du pays. Lorsque le régiment de Carignan-Salières débarqua à Québec à l'été de 1665, la colonie ne comptait que quelque 3200 habitants. Or, la venue subite de 1200 soldats et d'environ 80 officiers ne put qu'avoir un impact considérable sur le développement de la colonie, notamment en matière linguistique, car les communications dans l'armée royale se déroulaient exclusivement en français. Une fois la guerre finie avec les Iroquois en 1667, on estime que 30 officiers, 12 sergents et 404 soldats se prévalurent de l'offre du roi et se sont établis au Canada; plusieurs épousèrent des filles du roy. Entre 1683 et 1760, quelque 10 000 soldats et officiers des troupes de la Marine furent envoyés au Canada. Plus de la moitié des militaires sont retournés en France, mais les autres se sont établis au Canada.
Il convient d'ajouter aussi les immigrants de passage tels les artisans, les négociants, les marchands, ceux qui exerçaient des métiers spécialisés et les «manouvriers» (des «hommes à tout faire») en forte demande au Canada. Avec les militaires, tous ces immigrants n'étaient au Canada que de passage. Eux aussi sont certainement responsables en partie de l'uniformisation linguistique dans ce pays.
- L'étroitesse des zones habitées
Le problème également, c'est d'expliquer comment les francisés et les francisants majoritaires, les semi-patoisants et les rares patoisants minoritaires en sont venus rapidement à n'utiliser qu'une variété de français parlée au Canada. Tout se serait joué entre 1663 et 1700, soit une période de quarante ans. Il s'agit d'un délai trop court pour des changements linguistiques majeurs, sauf si la population concernée est de taille très réduite et est installée dans un environnement restreint. Or, c'était le cas au Canada! À cette époque, la population canadienne était concentrée dans trois centres: Québec (zone régionale de 120 km), Trois-Rivières (une zone d'à peine 30 km) et Montréal (une zone d'environ 80 km). On peut même parler de deux véritables pôles d'habitation, puisque Trois-Rivières ne constituait qu'un bourg de transition entre les deux villes. Une autre zone s'était développée antérieurement: l'Acadie.
Pour les historiens et les démographes, il est évident que le petit nombre des immigrants et l'étroitesse des zones habitées ont assuré rapidement une cohésion non seulement sociale et spirituelle, mais aussi linguistique. C'est pourquoi les patois n'ont pu laisser de traces dans le parler des Canadiens; ils ont disparu presque aussitôt arrivés. Les rares patoisants sont rapidement devenus bilingues (souvent au cours du long voyage sur le navire) parce que leurs patois n'ont pu être utilisés de façon suffisamment fonctionnelle, le français prenant toute la place.
Bref, les quelques centaines de patoisants éventuels n'ont eu aucune chance de perpétuer leur langue au Canada, et ce, d'autant plus qu'ils provenaient de nombreuses provinces de France, dont les patois étaient différents. Non seulement le combat était perdu d'avance, mais il n'y a jamais eu de véritable «choc des patois».
Ce n'est qu'après 1700 que les Canadiens se sont dispersés dans toute la vallée du Saint-Laurent. La langue qui s'est disséminée le long du Saint-Laurent, le français, était issue soit de Québec soit de Montréal. Ces distinctions proviennent de l'origine de l'émigration française au Canada.
En 1631, l'Acadie fut intégrée en tant que colonie autonome de la Nouvelle-France sous le nom de Acadie; dans sa plus vaste extension (voir la carte), l'Acadie de la Nouvelle-France couvrait la Gaspésie (Québec), la baie des Chaleurs, le Nouveau-Brunswick actuel et une partie du Maine, l'île Saint-Jean (île du Prince-Édouard), la Nouvelle-Écosse, l'île Royale (Cap-Breton). Au début du XVIIIe siècle, la plupart des émigrants français qui s'étaient établis en Acadie étaient installés tout le long du littoral de la Nouvelle-Écosse (voir la carte de 1700). La grande majorité d'entre eux venaient de l'ouest de la France et étaient arrivés avant ceux qui se sont établis dans la région de Québec. Au moins la moitié était originaire de la province française du Poitou et ces émigrants sont géographiquement circonscrits à quelques villages : Martaizé, Aulnay, Angliers, La Chaussée et Guesnes, auxquels il convient d'ajouter le village d'Oiron. Ces villages sont tous situés dans le nord-est du Poitou, ce qui fait partie aujourd'hui du département de la Vienne (86). Ils sont tous localisés à quelques kilomètres les uns des autres. Il n'est pas dû au hasard si quelques centaines de colons ont quitté la région du Loudunais pour l'Acadie. C'est Isaac de Razilly, gouverneur de l'Acadie de 1632 à 1635, ainsi que l'un de ses successeurs, Charles de Menou d'Aulnay (de 1642 à 1650), étaient originaire du Loudunais. Ce sont eux qui entraînèrent de jeunes paysans de la région à fonder une colonie française en Nouvelle-France,
Par contre, dans la vallée du Saint-Laurent, les émigrants venaient de trois noyaux relativement équilibrés rattachés aux régions du nord (Normandie et Bretagne), du centre (Île-de-France et Paris) et de l'ouest (Poitou et Saintonge) de la France. De plus, les recherches historiques dans le domaine linguistique ont permis d'établir que la région de Québec a reçu proportionnellement davantage d'émigrants originaires du centre de la France, surtout le région parisienne, que celle de Montréal où l'influence des parlers ruraux de l'ouest de la France a été plus marquée. La région parisienne a donc exercé à Québec a une plus grande influence tant de la part du français populaire que du «français du roy», en raison de la présence du gouverneur et de sa cour, des fonctionnaires, des officiers et de l'armée, des ecclésiastiques, etc. À l'opposé, le français de la région de Montréal serait plus tributaire des usages français populaires et régionaux que celui de la région de Québec.

C'est pourquoi les linguistes (Claude Poirier, 1994) constatent encore aujourd'hui trois grandes zones dans le parler des Canadiens de langue française:
1) le «parler acadien» avec l'Acadie au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard et à Terre-Neuve, ainsi que la Gaspésie et une partie de la Côte-Nord du Québec;
2) le «parler de l'Est»: le Nord-Est avec Québec comme pôle, auquel le Saguenay-Lac-Saint-Jean est rattaché;
3) le «parler de l'Ouest»: le Sud-Ouest avec Montréal comme pôle, Trois-Rivières constituant la zone de transition (parler du Centre).Ces trois «parlers» ne sont guère différents entre eux tout en étant distinctifs, et l'intercompréhension demeure très aisée. Il est vrai que le parler acadien est légèrement plus distinct, mais les différences entres le «parler de l'Est» et le «parler de l'Ouest» sont aujourd'hui mineures. Tout au plus peut-on déceler un certain accent plus «montréalais» et une tendance des Montréalais à emprunter plus massivement à l'anglais. Les individus très observateurs peuvent parfois distinguer un certain accent chez les locuteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou ceux du Bas-Saint-Laurent, mais il faut parfois disposer de plusieurs minutes pour distinguer l'accent «montréalais» (Montréal) de l'accent «québécois» (Québec). Certains individus n'y arrivent jamais. Il est plus aisé de distinguer un «accent» chez certains habitants de la Gaspésie, de Havre-Saint-Pierre (Côte-Nord) et des îles de la Madeleine parce que l'origine de beaucoup d'entre eux est acadienne.
Quoi qu'il en soit, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le Québec et l'Acadie ont connu aussi des changements importants de population. En raison de sa grande force économique, la région de Montréal a attiré des citoyens de toutes les régions du Québec (Québec, Saguenay-Lac-St-Jean, Gaspésie), des citoyens des autres provinces (Ontario, Nouveau-Brunswick et Manitoba) et des immigrants internationaux. Au XXIe siècle, Montréal internationalise davantage son français que la région de Québec, puisque Montréal reçoit 90 % des immigrants internationaux, lesquels parlent un français plus européen. Au Nouveau-Brunswick, les Acadiens se sont «déruralisés» et urbanisés : beaucoup se sont installés dans la région de Moncton, notamment à Dieppe, sans oublier que des Québécois et des immigrants francophones habitent maintenant la grande région de Moncton. Les francophones du Nouveau-Brunswick ne sont plus tous des Acadiens.
- La langue des «filles du roy»
En Nouvelle-France, le «marché matrimonial» des habitants fut un terrain de conquête presque entièrement gagné au français au moment où s'ouvrit la décennie 1663-1673, marquée par l'arrivée massive de quelque 900 filles du roi (ou «filles du Roy»). Au plan linguistique, les filles du roi ont joué un rôle non négligeable au Canada, car c'est également par ces femmes que s'est propagée la langue française.

L'arrivée des «filles du Roy» à QuébecLes filles du roi n'ont pu qu'accélérer le processus d'assimilation des immigrants plus ou moins francisants. En effet, quelque 80 % d'entre elles avaient déjà le français comme langue maternelle; parmi les Parisiennes (la moitié de l'effectif), certaines parlaient même le «français du roy», phénomène plutôt exceptionnel.
Le reste du contingent féminin (environ 20 %) était formé probablement de semi-patoisantes (surtout des Normandes, mais aussi de l'Aunis et de la Picardie), de toute façon déjà familiarisées avec le français régional.
L'action conjuguée des femmes francisées et francisantes de la première génération, ainsi que de leur progéniture, a sûrement hâté l'usage du français au Canada vers les années 1680-1689. À partir de ce moment, la population canadienne a disposé d'une seule langue promue au rang de langue maternelle, qu'elle allait ensuite façonner à son image et à celle de l'Amérique.
Il faut donc souligner que les anciens Canadiens ont constitué la première population francophone du monde à réaliser son unité linguistique, et cela, deux siècles avant la France, et sans véritable intervention étatique.
4.3 La langue de l'Église
Les colons français ont certes apporté avec eux la langue française. Ils ont aussi amené de France la langue latine, la langue de leurs prières. Jusqu'à la toute fin du XVIIe siècle, le latin était aussi une langue internationale, ne l'oublions pas. C'était généralement, du moins en Europe, la langue des traités internationaux. Les États n'acceptaient pas la dominance d'une quelconque langue nationale quand il s'agissait de transiger entre eux. Le français viendra au siècle suivant remplacer le latin dans les instances internationales. Dans l'Église de France, les membres du haut clergé utilisaient fréquemment le latin entre eux. Au Canada, les jésuites parlaient couramment le latin. Mais les prêtres séculiers le parlaient peu, bien que tous leurs livres de prières ne soient écrits qu'en cette langue.
Le naturaliste suédois Pehr Kalm vint passer plus de quatre mois au Canada en 1749. Il parlait couramment le suédois, l'anglais et le latin, et s'était initié au français avant son voyage au Canada. Sa maîtrise du français était suffisante pour communiquer avec les Canadiens et pour saisir leurs différences phonétiques locales. Il rédigea en suédois un récit de son voyage en trois volumes, qu'il publia quelques années plus tard à Stockholm, sous le titre de En Resa til Norra America. L'ouvrage sera traduit d'abord en allemand, puis en néerlandais, en anglais (Travels into North America) et en français (Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749). Selon ce fin observateur, seuls quelques ecclésiastiques formés en France pouvaient s'exprimer en français, et pas tous:
Les prêtres ont beau avoir à dire en latin toutes leurs prières et à lire chaque jour leur bréviaire en cette langue [...], un petit nombre d'entre eux sont seuls capables de s'exprimer dans cette langue ou osent s'y aventurer. Kalm soupçonne même l'évêque de Québec, Mgr Pontbriand, de ne pas parler le latin couramment: «Le peu de fois qu'il s'est entretenu avec moi, il le fit toujours en français, sans que je puisse tirer de lui un seul mot latin.»
Pour communiquer avec leurs ouailles, les prêtres n'utilisaient évidemment que le français, mais le latin n'était jamais très loin lorsqu'il s'agissait de prier. Dès leur plus tendre enfance, les anciens Canadiens apprenaient leurs prières en latin. Kalm trouvait amusant de voir les Canadiens réciter des prières sans comprendre:
La plupart des prières, même les plus courantes, se disent en latin, langue qu'une grande partie des gens ne comprennent pas. Et c'est une chose comique que d'entendre un homme dire sa prière en latin, une langue qu'il ne comprend pas, et il ne semble même pas savoir lui-même ce qu'il dit en priant. Même les soldats prient en latin durant les offices religieux. La cérémonie finie, les soldats crient en français : «Vive le roi!» Et Kalm de conclure: «C'est là à peu près tout ce qu'ils comprennent de ce qu'ils ont récité.» Pehr Kalm fut un observateur bienveillant envers les Canadiens, la Suède étant alors une alliée de la France. Comme il était luthérien, il ne pouvait que trouver fort répréhensibles des individus qui priaient sans savoir ce qu'ils disaient. Pour ce Suédois de religion luthérienne, le plus grand défaut des Canadiens étaient d'être catholiques et non pas protestants comme les Anglais de la Nouvelle-Angleterre. Il s'offusquait de voir que la religion chez les Canadiens semblait correspondre à des pratiques strictement extérieures et que la Sainte Vierge y recevait plus d'hommage que Dieu lui-même.
Le français parlé au Canada par les anciens habitants ne pouvait pas être très différent de celui utilisé en France à la même époque. La «langue du roy» devait être identique des deux côtés de l'océan: les nobles et les fonctionnaires de la colonie parlaient la même variété de français. Quant au peuple, une fois l'unité linguistique réalisée, il utilisait la même variété de français que les classes populaires, qui ne correspondait vraiment ni au français parisien ni à celui d'aucune région de France en particulier, si ce n'est un amalgame du français populaire de Paris ainsi que des variétés populaires du nord et de l'ouest de la France.
5.1 Un français similaire à celui de la France
La variété parlée par les anciens Canadiens se caractérisait par une prononciation populaire influencée toutefois par les origines du français régional des habitants, une syntaxe simple apparentée à celle de Montaigne et de Marot, un vocabulaire légèrement archaïque, teinté de provincialismes, surtout de la Normandie et du sud-ouest de la France. Bref, rien qui puisse vraiment distinguer le «francophone» de la Nouvelle-France de celui de la mère patrie. D'ailleurs, les témoignages des contemporains de l'époque sont unanimes sur cette question.
En 1691, le père Chrestien Le Clercq (1641-vers 1685) disait qu'«un grand homme d'esprit» lui a appris que le Canada possède «un langage plus poli, une énonciation nette et pure, une prononciation sans accent»:
J'avois peine à concevoir qu'une peuplade formée de personnes de toutes les provinces de France, de mœurs, de nation, de condition, d'interest, de genie si differents & d'une manière de vie, coûtumes, éducation si contraires fut aussi accomplie qu'on me la représentoit [...], mais il est vray que lorsque je fus sur les lieux, je connus qu'on ne m'avoit rien flatté. Le père Pierre François-Xavier de Charlevoix (1682-1761) est presque idyllique lorsqu'il écrivit: «Nulle part ailleurs, on ne parle plus purement notre langue. On ne remarque ici aucun accent.»
Le témoignage du contrôleur général de la Marine au Canada en 1698, le sieur Le Roy Bacqueville de La Potherie (1663-1736) est assez significatif à cet égard (1702):
Les personnes du sexe de ce dernier Etat [la ville et la région de Québec] ont des manieres bien differentes de celles de nos bourgeoises de Paris & de nos provinciales. On y parle ici parfaitement bien sans mauvais accent. Quoiqu'il y ait un mélange de presque toutes les Provinces de France, on ne sauroit distinguer le parler d'aucune dans les Canadiennes. Le sieur Bacqueville de La Potherie parle d'un groupe restreint de personnes: les bourgeoises de la ville de Québec.
Jean-Baptiste d'Aleyrac (1737-1796), un officier français qui vécut au Canada de 1755 à 1760, écrivait en 1755 que les Canadiens parlaient «un français pareil au nôtre»:
Il n'y a pas de patois en ce pays. Tous les Canadiens parlent un français pareil au nôtre. Hormis quelques mots qui leur sont particuliers, empruntés d'ordinaire au langage des matelots, comme amarrer pour attacher, hâler pour tirer non seulement une corde mais quelque autre chose. Ils en ont forgé quelques-uns comme une tuque ou une fourole pour dire un bonnet de laine rouge... Ils disent une poche pour un sac, un mantelet pour un casaquin sans pli... une rafale pour un coup de vent, de pluie ou de neige; tanné au lieu d'ennuyé, chômer pour ne manquer de rien; la relevée pour l'après-midi; chance pour bonheur; miette pour moment; paré pour prêt à. L'expression la plus ordinaire est de valeur, pour signifier qu'une chose est pénible à faire ou trop fâcheuse. Ils ont pris cette expression aux sauvages. Les Canadiens donnent au mot sot la signification d'homme trompé par sa femme. Si employant cet adjectif, ils n'ajoutent: «honneur à ta femme ou ta mère» — réserve qui montre qu'il s'agit d'un badinage —, il est tenu pour l'insulte la plus grave qui soit. Quant au marquis Louis-Joseph de Montcalm (1712-1759), il ne put s'empêcher de reconnaître en 1756 que «les paysans canadiens parlent très bien le françois». Il ajoutait: «Comme sans doute ils sont plus accoutumés à aller par eau que par terre, ils emploient volontiers les expressions prises de la marine.»
Le comte Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811) a fait carrière au Canada comme aide de camp de Montcalm entre 1756 et 1760. Après la mort de Montcalm en 1759, il dirigea la retraite et fut promu colonel, puis fut fait prisonnier lors de la capitulation de Montréal; il rentra en France au début de 1761. En 1757, il a rédigé un «Mémoire sur l’état de la Nouvelle-France à l’époque de la guerre de Sept Ans», qui parut seulement en 1867 dans Relations et mémoires inédits pour servir à l’histoire de la France dans les pays d’outre-mer chez l'éditeur Pierre Margry. Bougainville y a écrit ces commentaires sur la langue des Canadiens:
Il faut convenir que, malgré de défaut d'éducation, les Canadiens ont de l'esprit naturellement; ils parlent avec aisance, ils ne sçavent pas écrire, leur accent est aussi bon qu'à paris, leur diction est remplie de phrases vicieuses, empruntées de la langue des sauvages ou des termes de marine, appliqués dans le style ordinaire. Bougainville semble être le premier Français à porter un jugement normatif sur la langue des Canadiens en parlant des «phrases vicieuses», c'est-à-dire des mots incorrectement employés (cf. la marine) ou empruntés (cf. les sauvages).
Rappelons les précieux commentaires du botaniste suédois Pehr Kalm sur la langue des Canadiens de l'époque. Kalm parlait le français avec un fort accent étranger. Il fit rire de lui par «les dames canadiennes, celles de Montréal surtout», à cause de ses «fautes de langage» et il s'en montra fort choqué. Voici ce qu'il dit à ce sujet:
Les dames canadiennes, celles de Montréal surtout, sont très portées à rire des fautes de langage des étrangers; mais elles sont excusables jusqu'à un certain point, parce qu'on est enclin à rire de ce qui paraît inusité et cocasse, et, au Canada on n'entend presque jamais parler le français que par des Français, les étrangers n'y venant que rarement. Quant aux sauvages, ils sont trop fiers pour s'exprimer dans une autre langue que la leur, et les Français sont bien obligés de l'apprendre. Il suit de là, que les belles dames du Canada ne peuvent entendre aucun barbarisme ou expression inusitée sans rire. Son point de vue sur la langue des Canadiens est très clair:
Tous ici tiennent pour assuré que les gens du commun parlent ordinairement au Canada un français plus pur qu'en n'importe quelle Province de France et qu'ils peuvent même, à coup sûr, rivaliser avec Paris. Ce sont les Français de Paris, eux-mêmes, qui ont été obligés de le reconnaître. La plupart des habitants du Canada, hommes et femmes, peuvent lire un texte, mais aussi écrivent assez bien. J'ai rencontré des femmes qui écrivaient comme le meilleur des écrivains publics et je rougis, pour ma part, de n'être pas en mesure de le faire de la sorte. Kalm nous apprend comment on prononçait «Montréal»: «Les Français de la région et ceux qui habitent dans cette ville prononcent ce mot "Moreal", en mettant l'accent sur la dernière syllabe.» Aujourd'hui, on dit [mont-réal] et non [mòréal].
Ces divers témoignages peuvent paraître un peu trop élogieux, mais ils ont le mérite de concorder. Étant donné que ces témoignages proviennent de personnes instruites et ayant séjourné assez longtemps en Nouvelle-France, il est préférable de leur accorder un certain crédit. C'est pourquoi, malgré certaines réserves, ces témoignages demeurent précieux et utiles pour connaître la perception qu'on avait de l'état de la langue des anciens Canadiens.
Quoi qu'il en soit, ces témoignages confirment ce que les historiens de la langue peuvent constater à partir de leurs recherches. On sait qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle il existait deux types de français employés à Paris: le style familier et le style soutenu. Le style familier correspondait à celui de la cour et des salons (la noblesse), alors que le style soutenu était rattaché au barreau (justice), à la chaire (prédication et enseignement) et au théâtre, c'est-à-dire à la bourgeoisie. Durant au moins un siècle et demi, les deux usages se concurrenceront, jusqu'à ce que le style soutenu commence à supplanter le style familier à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le français employé en Nouvelle-France était celui de la cour et des salons. Ainsi, les témoignages des voyageurs en Nouvelle-France sont tout à fait plausibles, car ils confirment une communauté d'accent et de prononciation entre les Parisiens et les Canadiens. Par exemple, autant à Paris qu'à Québec, on disait «ste femme-là», «cré moé», «yé ben adret», «not' seigneur», «leux cousins», etc. Dans le style soutenu parisien, pas encore à la mode, on disait plutôt: «cette femme-là», «crois moi», «il est ben adroit», «notr' seigneur», «leurs cousins», etc. Après la révolution de 1789, c'est le style soutenu qui triomphera, facilité en cela par la quasi-disparition de la noblesse. De plus, le trait le plus marquant semble être le fait qu'en Nouvelle-France les Canadiens parlaient une langue commune autant chez l'élite que chez le peuple, sans distinction de classes.
5.2 Des divergences dans le vocabulaire
On pourrait donc affirmer qu'on parlait en Nouvelle-France une langue française qui n'avait rien à envier à celle de Paris ou des grandes villes françaises. On sait aussi que, à la fin du Régime français, les Français et les Canadiens avaient une prononciation et un accent assez identiques, mais que le vocabulaire commençait à diverger quelque peu, le témoignage de l'officier Jean-Baptiste d'Aleyrac étant le plus significatif à cet égard; Bougainville et Montcalm mentionnent aussi la question du vocabulaire de la marine. Ainsi, ce qui distinguait déjà les Canadiens des Français, ce n'était pas la prononciation, mais le vocabulaire qui commençait à se différencier, ce qui signifiait que l'identité canadienne était née.
En 1743 et 1752, le père Louis-Philippe Potier (1708-1781), un missionnaire d'origine belge, a rapporté dans Façons de parler proverbiales, triviales, figurées, etc., des Canadiens au XVIIIe siècle plus de deux milliers d'expressions inusitées pour lui et employées par les Canadiens. Le père Potier voulait décrire les expressions et les mots qui se différenciaient du français de l’époque. En voici quelques exemples:
abrier (couvrir), affalé (arrêter sur la côte), être allege (vide, sans charge), attisée (bon feu), bredasser (faire mille petits ouvrages), bûcher du bois (abattre, couper), calé (chauve), chiard (hachis de bœuf bouilli et de pommes de terre), chicot de bois (morceau), corder le bois (empiler), éjarré (avoir les jambes écartées), embouveté (enchâssé), garrocher (jeter, lancer), gratte (grattoir), gravois (gravier), mouiller (pleuvoir), se mouver (agir), poudrerie (fine neige chassée par le vent), raser (frôler), ripe de bois (copeaux de bois), solage d'une maison (fondations), tuque (bonnet pointu en laine), de valeur (c'est dommage).
Ces exemples révèlent que la plupart de ces mots sont encore employés aujourd'hui (sauf bredasser, gravois et affalé qui a changé de sens). D'autres mots sont complètement sortis de l'usage des Canadiens: fourgailler (remuer), mandacable (mangeable), tympaniser (railler), etc. En réalité, ces mots proviennent généralement de termes empruntés aux anciens patois ou à un ancien français régional normand, angevin, saintongeais, etc. En raison de leur ancienneté, les notes recueillies par Louis-Philippe Potier constituent le premier et le seul lexique du français parlé en Nouvelle-France. Évidemment, le document du père Potier demeure une précieuse source pour l’étude de l’histoire de la langue au Québec.
Ces légères différences dans la langue témoignaient des distorsions qui commençaient à se manifester entre les Canadiens et les Français. Les rivalités entre les deux groupes devenaient de plus en plus fréquentes à la fin du Régime français. L'exemple le plus manifeste concerne la rivalité entre le gouverneur Vaudreuil et le général Montcalm. La conduite parfois arrogante et le mépris de certains officiers français affermissaient les Canadiens dans leur désir de se différencier de la France. Les miliciens canadiens se vantaient de pouvoir affronter «au moins trois Anglais» chacun.
5.3 Les influences amérindiennes
Pour ce qui est des influences amérindiennes sur la langue français des premiers Canadiens, elles furent de peu d'importance, sauf en ce qui a trait à la toponymie. Parmi les plus anciens amérindianismes, on peut relever achigan (poisson, 1656), atoca (airelle canneberge, 1656), babiche (lanière de cuir cru, 1669), cacaoui (canard, 1672), carcajou (mammifère, 1685), etc. Ces emprunts aux langues amérindiennes se poursuivirent au cours du XVIIIe siècle, mais ils demeurèrent toujours relativement modestes, ne dépassant guère une centaine de termes; ces emprunts seront un peu plus nombreux au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Par contre, les colonisateurs empruntèrent massivement à la toponymie amérindienne (plusieurs centaines de mots à cette époque). Voici une description de la linguiste contemporaine Marthe Faribault à ce sujet:
Lors de son deuxième voyage (1535-1536), Jacques Cartier remonte pour la première fois le Saint-Laurent. Il rencontre des Iroquoiens à Stadaconé («grande falaise» dans leur langue, aujourd'hui Québec) et nomme la région le «Royaume de Canada», du mot iroquoien kanata qui signifie «village», tandis que la région de Montréal reçoit le nom de «Royaume d'Hochelaga».
À la fin du XVIe siècle, les Iroquoiens laurentiens se retirent de la vallée du Saint-Laurent. Les Micmacs des Maritimes, qui y venaient déjà depuis longtemps par une route de portages le long des rivières Restigouche, Matapédia et Matane ou, plus au sud, par le bassin des rivières Etchemin et Chaudière, se firent alors plus présents dans la vallée. Ce sont donc les toponymes de la langue micmaque qui seront adoptés par les Français à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Ainsi, Gaspé, du mot micmac gespeg signifiant «extrémité», remplace le toponyme Honguedo, d'origine iroquoienne et employé par Cartier. De même, Québec, du mot micmac gepèg signifiant «détroit», remplace l'iroquoien Stadaconé. Quant à Anticosti, du toponyme micmac Natigosteg («terre avancée»), il remplace le nom d'île de l'Assomption donné par Cartier. Enfin, le site de Tadoussac, du toponyme micmac Giatosog signifiant «entre les rochers», est ainsi nommé par les Français autour de 1600.De façon générale, les emprunts aux langues amérindiennes, que ce soit pour des mots ou des toponymes, proviennent presque tous des langues algonkiennes et concernent les mêmes champs sémantiques (faune, flore, coutumes locales). Les emprunts à la toponymie amérindienne seront encore plus massifs dans les siècles à venir au point où ils constitueront une part importante de la toponymie québécoise.
À l'époque de la Nouvelle-France, l'éducation demeurait entre les mains des autorités religieuses. Comme en France, l'instruction devait être au service de la religion. L'objectif fondamental de l'Églises catholique étant la christianisation de la population, l'enseignement de la lecture et de l'écriture visait avant tout à permettre aux fidèles de lire les textes religieux et de bien suivre la messe dans leur missel. Quant à l'État, il y trouvait son compte, car l'instruction prônait le respect des autorités.
L'enseignement était dispensé dans les petites écoles primaires et quelques rares écoles secondaires. Le Collège de Québec et le Petit Séminaire de Québec sont demeurés les seuls établissements de l'enseignement supérieur au Canada.
6.1 Les petites écoles
Au début du XVIIIe siècle, la ville de Québec comptait au moins six écoles primaires où l'on enseignait (en français) les savoirs de base que sont le lecture, l'écriture et le calcul. Les jésuites s'occupaient de l'enseignement à Québec pour les garçons; les ursulines enseignaient aux filles. À Montréal, c'étaient les sulpiciens pour les garçons, les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame pour les filles. Les communautés religieuses ouvrirent des petites écoles non seulement à Trois-Rivières, mais aussi dans les environs de Montréal (Lachine, Boucherville, etc.) et de Québec (île d'Orléans, Château-Richer, etc.).
À la fin du Régime français, alors que la population était à son maximum, il y avait environ une cinquantaine de petites écoles le long du fleuve Saint-Laurent. La plupart de ces écoles consistaient en de petites pièces attenantes au presbytère de la paroisse; en général, une dizaine d'enfants pouvaient se présenter en même temps. Rares étaient les bâtiments de pierre prévus spécifiquement à des fins d'enseignement, sauf dans les villes. Bien que ces écoles fussent gratuites et ouvertes à tous, elles sont demeurées peu fréquentées. Dans les campagnes, la plupart des parents ne voyaient pas la nécessité d'apprendre à leurs enfants à lire et à écrire pour exploiter le patrimoine familial. La population était rurale à plus de 75 % et s'étendait sur un immense territoire sillonnés de routes en mauvais état. C'est pourquoi, en général, les élèves restaient à l'école primaire quelques mois, deux ans au maximum. La naturaliste suédois Pehr Kalm (1716-1779) passa quelque cent trente jours au Canada, dont sept à Montréal et trois semaines à Québec. Il donna ce témoignage dans Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749, en parlant des fillettes du Couvent des ursulines de Québec: «Quand elles ont appris à lire et qu'elles connaissent les éléments du christianisme, leurs parents les retirent du couvent et les reprennent à la maison.» La plupart des enfants entraient à l'école vers l'âge de onze ou douze ans, mais ils pouvaient le faire dès l'âge de six ans, rarement après quinze ans.
En Nouvelle-France, il était interdit aux hommes d'enseigner aux filles et interdit aux femmes d'enseigner aux garçons, quel que soit l'âge des écoliers. Les garçons et les filles ne fréquentaient jamais les mêmes locaux, ni les mêmes lieux de récréation.
Les manuels étaient rares et provenaient tous de France. Les enseignants, généralement des membres des communautés religieuses, s'inspiraient d'un livre publié en 1654: L'Escole paroissiale ou la manière de bien instruire les enfans dans les petites escoles. Au début du XVIIIe siècle, on trouvait aussi La Conduite des écoles chrétiennes (1706) de Jean-Baptiste de La Salle et le Catéchisme du diocèse de Québec (1702) de Mgr de Saint-Vallier (Jean-Baptiste de la Croix de Chevrières), évêque de Québec.
6.2 Les grandes écoles
Les élèves qui poursuivaient des études secondaires ou supérieures appartenaient à la bourgeoisie ou à l'aristocratie. La plupart des enseignants qui enseignaient au Collège des jésuites (Québec) ou au Petit Séminaire de Québec étaient formés en France. Les manuels étaient français et la pédagogie était tout à fait similaire à celle pratiquée en France. Dans toute la Nouvelle-France, le Collège des jésuites de Québec était le seul établissement à offrir les deux niveaux d'enseignement: le primaire, comme dans les petites écoles, et le secondaire (ou collégial). Ce second niveau correspondait au cours classique donné à la même époque en France: trois années de français et de grammaire, une année d'humanités, une année de rhétorique et deux années de philosophie. On estime qu'environ 150 élèves fréquentaient chaque année le Collège des jésuites, principal foyer culturel de la Nouvelle-France.
Le Petit Séminaire de Québec, le seul établissement d'enseignement supérieur, formaient des clercs pour assister les prêtres, mais préparaient également ceux qui se destinaient à la menuiserie, la charpenterie, la dorure, la peinture, la sculpture, l'arpentage, l'hydrograhie et la cartographie pour les pilotes et navigateurs); on y enseignait en français notamment les mathématiques, la physique, la géométrie, la chimie et l'astronomie. Ceux qui se destinaient à la prêtrise étaient formés au Grand Séminaire de Québec pour des études de théologie. Quant aux médecins et aux avocats, ils étaient formés en France; les médecins ne travaillaient que pour les établissements hospitaliers, alors que les avocats étaient recyclés dans l'enseignement ou l'administration judiciaire.
6.3 La qualité de l'instruction
Bien que peu poussée, l’instruction au Canada semble cependant d'un degré presque remarquable pour l'époque. En se fondant sur les études les plus sérieuses portant sur la période 1680 à 1765, il semble que 25 % des adultes étaient en mesure d'apposer leur signature sur leur contrat de mariage. Il s'agit là d'une moyenne, car le taux de signature des couples lors du contrat de mariage étaient de 41 % dans les villes et de 10 % dans les campagnes. Chez les fils et filles d'officiers militaires, de hauts fonctionnaires, de bourgeois et de grands marchands, le taux de signature était de 90 %. Chez les soldats, les petits fonctionnaires et les artisans, le taux de signature ne dépassait jamais les 30 %.
Cela étant dit, il faut comprendre que lire et écrire étaient à l'époque deux activités différentes. Il était en effet plus facile d'apprendre à lire qu'à écrire. Lire pouvait ne nécessiter que quelques mois d'apprentissage, surtout si la lecture demeurait rudimentaire. Mais écrire autrement que signer son nom demandait des études plus prolongées et exigeait du papier, de l'encre et des plumes, donc de l'argent. C'est ainsi que les citadins, même parmi les peu instruits, pouvaient aisément lire les enseignes des boutiques de commerçants, d'artisans ou des cabarets. Si tous savaient déchiffrer les quelques mots des enseignes commerciales, la plupart comprenaient aussi les affiches d'ordonnance, les convocations en justice, les mandements du clergé, etc. Beaucoup de Canadiens, qui ne pouvaient pas signer leur nom, comprenaient la signification de tous ces écrits publics.
En somme, l'instruction en Nouvelle-France était comparable à celle dispensée en France à la même époque. Le degré d'instruction était différent selon la classe sociale, le sexe et la richesse, comme en France, en Nouvelle-Angleterre ou en Angleterre.
Entre 1635 et 1760, plus de 300 000 Français ont quitté la France pour les colonies, mais la plupart ont préféré les Antilles ou ce qu'on appelait alors les «Indes occidentales» (Martinique, Guadeloupe, Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Domingue, Guyane, etc.). Par exemple, alors que 7000 émigrants français sont arrivés aux Antilles entre 1635 et 1642, seulement 2400 Français avaient choisi le Canada entre 1632 et 1644. Plus tard, entre 1749 et 1763, le port de La Rochelle enregistra en moyenne quelque 98 départ annuels de navires pour les Antilles, mais seulement 16 pour le Canada et 14 pour la Louisiane. En 1663, on comptait 8000 Français aux Antilles, mais seulement 2500 au Canada.
7.1 Le déficit démographique
Entre 1635 et 1760, plus de 300 000 Britanniques (Anglais, Écossais, Gallois et Irlandais) ont quitté la Grande-Bretagne pour la seule Amérique du Nord. Par ailleurs, les deux tiers des Français sont repartis en France après quelques années, alors que plus de 90 % des colons anglais sont restés en Nouvelle-Angleterre. Un sujet britannique sur six vivait dans les colonies, contre un sujet français sur 300! De son côté, le ministre Colbert a toujours cru naïvement que pour peupler le Canada il fallait dépeupler la France! Voici ce qu'il écrivait à l'intendant Jean Talon le 5 janvier 1666 (`«Correspondance entre la cour et l'intendant Talon»):
Le Roi ne peut convenir de tout le raisonnement que vous faites sur les moyens de former au Canada un grand et puissant État, y trouvant divers obstacles qui ne sauraient être surmontés que par un très long espace de temps, parce que quand même il n'aurait pas d'autre affaire, et qu'il pourrait employer, et son application, et sa puissance à celle-là, il ne serait pas de la prudence de dépeupler son Royaume comme il faudrait faire pour peupler le Canada. Or, l'exemple anglais démontre que ce raisonnement était erroné: l'Angleterre ne semble pas avoir beaucoup souffert de l'émigration d'une partie de ses ressortissants vers l'Amérique. Si, au cours du règne de Louis XIV (1661-1715), la France n'avait envoyé chaque année que 500 émigrants au Canada, la population aurait atteint en 1760 plus de 500 000 habitants, de quoi tenir tête aux Anglais! Il aurait sans doute fallu une série de cataclysmes en France ou de vastes opérations de racolage manu militari étendues sur plusieurs années pour drainer un grand nombre d'émigrants vers la lointaine Nouvelle-France (Acadie, Canada, Plaisance, Louisiane ou Louisbourg).
Si plusieurs mesures, surtout à partir de 1663, n'étaient venues redresser la situation, on n'aurait probablement jamais parlé de la Nouvelle-France par la suite. Considérée en elle-même, la Nouvelle-France avait fait un progrès remarquable entre 1663 et 1754: l'Acadie française comptait 10 000 habitants, le Canada 55 000. Le recensement officiel de la lointaine Louisiane en date de 1735 révélait que la colonie comptait 2450 Français et 4225 esclaves noirs, pour un total de 6675 habitants; selon les historiens, ces chiffres, qui ne tiennent pas compte des militaires (environ un millier d'hommes), seraient inexacts et certainement en-deça de la réalité démographique. Quoi qu'il en soit, c'est le déficit démographique entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre, qui entraînera en partie la perte de l'Amérique française, mais aussi l'incompétence de certains officiers français et l'indifférence de la France.
7.2 La population résidente temporaire
Non seulement il est venu peu d'émigrants français au Canada, mais la plupart de ceux-ci sont retournés en France et n'ont résidé au Canada que de provisoirement. En effet, au total, plus de 27 000 émigrants se sont embarqués pour le Canada. De ce nombre, seulement 9000 sont restés de façon définitive. Cela signifie qu'au moins les deux tiers des immigrants du Canada retournaient en France ou encore quittaient la colonie septentrionale pour les Antilles méridionales. La présence d'une clause de retour dans tous les contrats d'engagement signifiait bien que l'immigration définitive au Canada constituait davantage une exception qu'une pratique courante. C'était, entre autres, l'une des grandes différences entre les colonies de la Nouvelle-France et celles de la Nouvelle-Angleterre: alors que la plupart des émigrants français arrivaient en Amérique sur une base temporaire, les émigrants britanniques arrivaient en Nouvelle-Angleterre pour y rester.
On se rend compte aujourd'hui que la croissance démographique de la colonie canadienne dépendait moins de l'émigration française que de la seule croissance naturelle. Les Canadiens affichaient des taux de natalité plus élevés qu'en France, comme c'était aussi le cas immigrants de la Nouvelle-Angleterre. Alors qu'on dénombrait 40 naissances par 1000 habitants dans la France du XVIIe siècle, ce taux était de 55 au Canada (contre 10 aujourd'hui). Le taux élevé de fertilité des couples canadiens s'expliquait par le fait d'une meilleure alimentation, de mariages plus précoces et d'une espérance de vie plus longue. En 1740, le Canada d'origine française comptait plus de 50 000 habitants, dont 5000 à Québec et 3500 à Montréal. Québec restait la capitale politique, militaire et spirituelle non seulement de la colonie, mais de toute la Nouvelle-France (Canada, Île-Royale, Louisiane). Montréal jouait le rôle de centre névralgique de la traite des fourrures.
7.3 Une population restreinte
La France contrôlait un immense territoire qui s'étendait du Labrador au lac Winnipeg jusqu'à la Nouvelle-Orléans et dont l'économie, assez florissante, était axée sur la fourrure, la pêche et les sociétés d'État (l'armée, les forges de Saint-Maurice, les chantiers navals, la pêche). Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, le territoire qu'on appelait la Nouvelle-France couvrait une superficie considérable et s'étendait de la terre de Baffin au nord jusqu'au Mexique au sud et comprenait pratiquement la moitié du Canada et des États-Unis actuels. Mais la Nouvelle-France du milieu du XVIIIe siècle était déjà réduite par rapport à celle de 1712 (avant le traité d'Utrecht: voir la carte).
Après le traité d'Utrecht de 1713, la France avait perdu non seulement la Baie-d'Hudson, mais Plaisance (Terre-Neuve) et une partie du Labrador, puis une partie de l'Acadie (la Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui). Il lui restait le Canada, une partie de l'Acadie (l'île Saint-Jean et l'île Royale, aujourd'hui respectivement l'île du Prince-Édouard et l'île du Cap-Breton) et la Grande Louisiane (voir la carte après 1713). Louis XIV a préféré perdre l'Acadie, la Baie-d'Hudson et Plaisance (Terre-Neuve) pour voir son son petit-fils sur le trône d’Espagne sous le nom de Philippe V. Il faut dire que la France avait généralement l'habitude d'annuler les pertes subies en Europe en renonçant à ses possessions en Amérique du Nord. Elle l'a fait en 1713 (traité d'Utrecht) et le refera en 1763 (traité de Paris), en préférant perdre toute la Nouvelle-France au profit de la Grande-Bretagne, en échange de la Guadeloupe, et la Louisiane au profit de l'Espagne. Il ne restera que le minuscule archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
À la fin du Régime français, en regard des colonies anglaises, le Canada se révélait bien peu de chose. La colonie menaçait constamment d'être étouffée par des territoires anglais au nord (la région de la Baie-d'Hudson) et au sud (les Treize Colonies de la Nouvelle-Angleterre), lesquels opposaient une population globale d'un million d'habitants, sans compter une main-d'œuvre de plus de 300 000 esclaves. Néanmoins, vers 1750, la ville de Québec (6000) constituait l'une des quatre villes les plus importantes de l'Amérique du Nord, avec celles de Boston (16 000), de Philadelphie (13 000) et de New York (11 000). À cette époque, la population urbaine du Canada comptait environ 10 000 habitants, dont 6000 à Québec et 4000 à Montréal, ce qui équivalait à près de 20 % de la population de toute la colonie.
7.4 Les moyens de la politique
Pour les colons de la Nouvelle-Angleterre, l'implantation française au nord était devenue insupportable, d'une part, parce qu'elle établissait à l'ouest une barrière pour leur expansion géographique en raison de la possession de la Louisiane, de la vallée de l'Ohio, sans oublier l'implantation d'une série de forts qui servaient de postes de défense pour le Canada, d'autre part, parce qu'à partir de ces points d'appui il était possible de la part des Canadiens de mener des raids meurtriers contre les colonies anglaises. Dès 1755, les généraux anglais connaissaient l'imminence de la rébellion américaine et de l'éventuelle indépendance des Treize Colonies. Il leur fallait au plus tôt éliminer la Nouvelle-France avant que ne commence la guerre de l'indépendance. Militairement, la conquête du Canada offrait aux Britanniques une voie de retraite sûre vers l'Atlantique et une tête de pont utilisable dans l'éventualité d'une guerre de reconquête des Treize Colonies. C'est pourquoi la Grande-Bretagne avait décidé de prendre les grands moyens pour satisfaire ses ambitions: bouter définitivement les Français hors d'Amérique. Il lui fallait d'abord prendre Louisbourg pour couper les communications avec la France, puis prendre le contrôle de la vallée de l'Ohio entre les Grands Lacs et la Louisiane, et finalement prendre Québec et Montréal. La Grande-Bretagne mit sur pied un plan d'ensemble qui comprenait l'envoi de 23 000 soldats et d'une formidable flotte navale. Après la défaite totale des Français en Amérique du Nord, l’attention des Britanniques pourrait ensuite se porter dans les Antilles où ils prendront la Guadeloupe, puis la Dominique, la Martinique, ainsi que toute les autre îles, françaises ou espagnoles.
Quant à la France, elle semblait accepter de perdre sa colonie du Canada. Dans une missive adressée au général Montcalm, datée du 19 février 1959, le maréchal de Belle-Isle (1684-1761), alors secrétaire d'État à la Guerre, écrivait que le Canada ne devait plus attendre de recevoir des renforts de la France:
Quant à la besogne que vous aurez pendant cette campagne, je suis bien fâché d'avoir à vous mander que vous ne devez point espérer de recevoir des troupes de renfort. Outre qu'elles augmenteroient la disette des vivres que vous n'avez que trop éprouvée jusqu'à présent, il seroit fort à craindre qu'elles ne fussent interceptées par les Anglois dans le passage. Comme le roi ne pourroit jamais vous envoyer des secours proportionnés aux forces que les Anglois sont en état de vous opposer, les efforts que l'on feroit ici n'auroient d'autre effet que d'exciter le ministère de Londres à en faire de plus considérables pour conserver sa supériorité qu'il s'est acquise dans cette partie du monde. Or, selon Louis-Antoine de Bougainville, l'aide de camp du général Montcalm, la France devait envoyer 8000 soldats supplémentaires pour défendre adéquatement la Nouvelle-France contre la puissante invasion britannique. Parce que Louis XV avait envoyé 100 000 hommes en Autriche, il n'en disposait que de 1200 en renforts pour la Nouvelle-France. Montcalm n'a pu que répondre au maréchal Belle-Isle: «J'ose vous répondre de mon entier dévouement à sauver cette malheureuse colonie ou à mourir.» Les historiens ont beaucoup reproché au général Montcalm son défaitisme, car dès son arrivée au Canada il n'a cessé de prédire la défaite et de l'annoncer comme inéluctable. Il ne devait pas sauver la colonie et allait décéder le 14 septembre 1759 lors de la prise de Québec. La réponse du ministre Berryer (alors secrétaire d'État à la Marine) à Bougainville venu solliciter des renforts pour la Nouvelle-France ne laisse pas de doute sur les intentions de la France: «Quand le feu est à la maison, on ne doit pas chercher à sauver les écuries.» Ce à quoi Bougainville avait rétorqué: «On ne dira pas, du moins, que vous parlez comme un cheval.»
Au milieu du XVIIIe siècle, la France n'avait plus les moyens de sa politique d'expansion territoriale. Les dirigeants de la Nouvelle-France ont longtemps rêvé de chasser les Britanniques hors du continent. Leur grand rêve était d'étendre la domination française sur toute l'Amérique du Nord. Mais les extravagances de Louis XIV avaient grandement affaibli la puissance économique de la France. Embourbée dans des problèmes financiers constants et des guerres sans fin, la France de Louis XV revendiquait un vaste territoire sous-peuplé qu'elle ne contrôlait pas. Elle croyait sans doute qu'il suffisait d'arpenter de long en large les grands espaces de l'Amérique pour en revendiquer la propriété. Des explorateurs avaient découvert les Rocheuses à l'ouest et le Mississipi au sud, mais le fait de parcourir un continent ne signifie pas le posséder, pas davantage qu'un marin n'a des droits sur l'Atlantique parce qu'il en a fait la traversée. Autrement dit, les Français de l'époque étaient probablement de meilleurs conquérants que de bons colonisateurs.
Quant aux autorités coloniales de la Nouvelle-France, elles n'avaient jamais cessé, avec la complicité des Canadiens, des Acadiens et des Indiens, de harceler les établissements britanniques de la Nouvelle-Angleterre, ce qui constitue pour beaucoup d'historiens l'une des causes directes du soulèvement généralisé des habitants de la Nouvelle-Angleterre. Les Britanniques avaient du ressentiment à l'égard des Français (Canadiens ou Acadiens, sans distinction) qui avaient terrorisé, pendant des décennies, les colons de la Nouvelle-Angleterre. D'ailleurs, dans son Manifeste de 1759, Wolfe souleva cette question à deux reprises.

En résumé, la langue française s'est imposée très tôt dans la colonie canadienne. Et ce français ressemblait grandement à celui qui était parlé en France, sans nécessairement être celui de la région parisienne, ni d'aucune autre région en particulier. Mais, déjà à la fin du Régime français, certains termes commençaient à diverger au point où certains voyageurs français pouvaient lui trouver une couleur «provinciale», sans pouvoir déceler une seule province plus qu'une autre. Le français du Canada se comparait donc à celui parlé en France, même s'il était fortement influencé par les divers français régionaux de la Métropole. Il n'était pas encore imprégné des influences anglaises et reflétait une tendance nettement archaïsante.
Dernière mise à jour: 04 septembre, 2011
Histoire du français au Québec
(menu)(1) La Nouvelle-France
(1534-1760)(2) Le régime britannique (1760-1840)
(3) L'Union et la Confédération (1840-1960)
(4) La modernisation du Québec (1960-1981)
(5) Réorientations et nouvelles stratégies (de 1982 à aujourd'hui)
(6) Bibliographie
Histoire de la langue françaiseConsulter aussi:
- La Louisiane
- La colonie française de Plaisance (1650-1713)
- La colonie française de Louisbourg (1713-1758)
- La colonie française de l'Acadie (1604-1755)SOURCES : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
La période féodale :
l'ancien français
(IXe - XIIIe siècle)
Plan du présent article
1. La naissance du français
L'avènement des Capétiens
Le premier «roi de France»
L'expansion du français en Angleterre
La langue du roi de France
2. L'état de l'ancien français
Le système phonétique
La grammaire
3. Les langues parlées en France
4. La domination culturelle du latin
La langue de prestige
La création des latinismes
Un phénomène ininterrompu de latinisation
5. L'influence de la langue arabe
Les emprunts au français
Les chiffres arabesLes caractéristiques principales du régime féodal furent le morcellement et la fidélité. Afin de s'assurer la fidélité de ses vassaux, un suzerain (seigneur) accordait à chacun d'eux un fief (une terre) qui leur servait de moyen de subsistance; en retour, les vassaux s'engageaient à défendre leur seigneur en cas d'attaque extérieure.
Quelles furent les conséquences politiques de ce système?
Le morcellement du pays et la constitution de grands fiefs, eux-mêmes divisés en une multitude de petits fiefs; les guerres entre seigneurs étaient très fréquentes parce qu'elles permettaient aux vainqueurs d'agrandir leur fief. Chacun vivait par ailleurs relativement indépendant dans son fief, sans contact avec l'extérieur. Dans un tel système, la monarchie demeurait à peu près sans pouvoir.
1 La naissance du français
On situe la naissance du français vers le IXe siècle, alors qu'il faut attendre le Xe ou le XIe siècle pour l'italien, l'espagnol ou l'occitan.
Mais ce français naissant n'occupait encore au IXe siècle qu'une base territoriale extrêmement réduite et n'était parlé que dans les régions d'Orléans, de Paris et de Senlis (voir les zones en rouge sur la carte) par les couches supérieures de la population. Le peuple parlait, dans le Nord, diverses variétés d'oïl: le françois dans la région de l'Île-de-France, mais ailleurs c'était le picard, l'artois, le wallon, le normand ou l'anglo-normand, l'orléanais, le champenois, etc. Il faut mentionner aussi le breton dans le Nord-Ouest. Les rois de France, pour leur part, parlaient encore le francique (une langue germanique) tout en utilisant le latin comme langue seconde pour l'écrit. À cette époque, les gens du peuple étaient tous unilingues et parlaient l'un ou l'autre des nombreux dialectes alors en usage en France. Seuls les «lettrés» écrivaient en «latin d'Église» appelé alors le «latin des lettrés» et communiquaient entre eux par cette langue.
Dans le Sud, la situation était toute différente dans la mesure où cette partie méridionale du royaume, qui correspondait par surcroît à la Gaule la plus profondément latinisée, avait été longtemps soumise à la domination wisigothe plutôt qu'aux Francs. Les variétés d'oc, plus proches du latin, étaient donc florissantes (provençal, languedocien, gascon, limousin, etc.), surtout que l'influence linguistique wisigothe avait été quasiment nulle, sauf dans la toponymie. Dès le Xe siècle, le catalan se différencia de l'occitan par des traits particuliers; en même temps, le basque était parlé dans les hautes vallées des Pyrénées.
Quant aux langues franco-provençales (voir le texte de Manuel Meune à ce sujet) du Centre-Est, elles correspondaient plus ou moins à des anciennes possessions des Burgondes, puis de l'empereur du Saint Empire romain germanique. Bref, à l'aube du Xe siècle, l'aire des grands changements distinguant les aires d'oïl, d'oc et franco-provençale étaient terminées, mais non la fragmentation dialectale de chacune de ces aires, qui ne faisait que commencer. Soulignons qu'on employait au singulier «langue d'oïl» ou «langue d'oc» pour désigner les langues du Nord et du Sud, car les gens de l'époque considéraient qu'il s'agissait davantage de variétés linguistiques mutuellement compréhensibles que de langues distinctes.
1.1 L'avènement des Capétiens
Hugues Capet (987-996)
En mai 987, Louis V, le roi carolingien de la Francie occidentale était décédé subitement dans un accident de chasse en ne laissant aucun héritier direct. Le 1er juin, les grands seigneurs du royaume se réunir à Senlis pour élire un successeur au trône de la Francie occidentale. L'aristocratie franque élit Hugues Ier qui fut sacré quelques jours plus tard, le dimanche 3 juillet 987, dans la cathédrale de Noyon. Il fut surnommé aussitôt le «roi à chape» en raison de son titre d'abbé laïc qu'il détenait dans les nombreuses «chapes» ecclésiastiques — la chape (la «capa» ou cape) étant le manteau à capuchon que portaient les abbés —, d'où le terme Capet.
Avant d'être couronné «roi des Francs» (rex Francorum), Hugues Ier était un puissant seigneur respecté; il était comte de Paris, comte d'Orléans, duc des Francs et marquis de Neustrie (nord-ouest de la France sans la Bretagne), et possédait de nombreuses seigneuries laïques et abbayes (Saint-Martin-de-Tours, Marmoutier, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Denis). Ses alliances familiales avaient favorisé son élection comme «roi des Francs» par l'aristocratie: il était frère d’Othon (duc de Bourgogne), beau-frère de Richard (duc de Normandie), et gendre de Guillaume III Tête d’Étoupe (duc d’Aquitaine), depuis son mariage en 970 avec la princesse Adélaïde, la fille de Guillaume III.
C'est avec l'avènement de Hugues Capet (en 987) que le premier roi de France (encore désigné comme le «roi des Francs») en vint à parler comme langue maternelle la langue romane vernaculaire (plutôt que le germanique), ce qui sera appelé plus tard comme étant le françois ou françoys (prononcé [franswè]).
Dans le système féodal de l'époque, la France était dirigée par une vingtaine de seigneurs territoriaux, descendants de fonctionnaires ou de guerriers carolingiens, qui détenaient des pouvoirs considérables parfois supérieurs à ceux du roi, comme ce fut le cas, par exemple dans le Nord, avec les comtes de Flandre et les ducs de Normandie, à l'est avec les ducs de Bourgogne et, au sud, avec les ducs d'Aquitaine.
En raison des invasions étrangères, ces seigneurs avaient obtenu du roi de vastes territoires en échange de leurs services. La légitimité de Hugues Capet état alors relativement fragile. Par exemple, lorsqu'il s'opposa à son vassal Adalbert de Périgord qui refusait de lever le siège de Tours, le roi lui lui demanda : «Qui t'as fait comte?» Et le vassal de lui répondre: «Qui t'as fait roi?»
Hugues Ier sera le fondateur de la dynastie des Capétiens et s'appuiera sur des règles d'hérédité, de primogéniture (priorité de naissance) et d'indivisibilité des terres domaniales. C'est donc Hugues Capet qui remplaça la monarchie élective en vigueur sous les derniers Carolingiens en une monarchie héréditaire.
D'ailleurs, Hugues Capet avait fait élire et sacrer son fils aîné Robert quelques mois après sa propre élection, soit le 25 décembre 987. La dynastie des Capétiens réussit à renforcer ainsi l'autorité royale et entreprit la tâche d'agrandir ses domaines. Contrairement aux rois précédents qui transportaient leur capitale d'une ville à l'autre, les Capétiens se fixèrent à Paris.
1.2 Le premier «roi de France»
Ce n'est qu'en 1119 que le roi Louis VI le Gros (qui régna de 1108 à 1137), un descendant de Hugues Capet, se proclama, dans une lettre au pape Calixte II «roi de France» (rex Franciai), plus précisément «roi de la France», non plus des Francs, et «fils particulier de l’Église romaine». C'est le premier texte où il est fait référence au mot France.
D'où le mot français (et «françois» ou «françoys»). En réalité, c'est le mot françois ou françoys (prononcé [franswè]) qui était attesté à l'époque, le mot francien ayant été créé en 1889 par le philologue Gaston Paris pour faire référence au «français de l'Île-de-France» du XIIIe siècle, par opposition au picard, au normand, au bourguignon, au poitevin, etc.
Mais il faut aussi considérer qu'au début du XIIIe siècle le terme françois ou françoys désignait autant la langue du roi que le parler de l'Île-de-France ou même toute autre variété d'oïl (picard, champenois, normand, etc.). Autrement dit, la notion de «françoys» recouvrait une réalité linguistique encore assez floue. Les mots France, Franc et françoys étaient souvent utilisés de façon interchangeable, que ce soit pour désigner le pays, le pouvoir ou la langue du pouvoir.
Dans les conditions féodales, les divergences qui existaient déjà entre les parlers locaux se développèrent et s'affermirent. Chaque village ou chaque ville eut son parler distinct: la langue évolua partout librement, sans contrainte. Ce que nous appelons aujourd'hui l'ancien français correspondait à un certain nombre de variétés linguistiques essentiellement orales, hétérogènes géographiquement, non normalisées et non codifiées.
Les dialectes se multipliaient et se divisaient en trois grands ensembles assez nettement individualisés, comme on les retrouve encore aujourd'hui (voir la carte de la France dialectale): l
es langues d'oïl au nord, les langues d'oc au sud, le franco-provençal en Franche-Comté, en Savoie, au Val-d'Aoste (Italie) et dans l'actuelle Suisse romande. L'une des premières attestations de l'expression langue d'oc est attribuée à l'écrivain florentin Dante Alighieri (1265-1321. Dans son De Vulgari Eloquentia («De l'éloquence vulgaire») rédigé vers 1305 en latin, celui-ci classait les trois langues romanes qu'il connaissait d'après la façon de dire oui dans chacune d'elles (par exemple, oïl, oc, si), d'où la distinction «langue d'oc» (< lat. hoc) au sud et «langue d'oïl» (< lat. hoc ille) au nord, pour ensuite désigner les parlers italiens (sì < lat. sic). Le célèbre Florentin distinguait dans leur façon de dire «oui» les trois grandes branches des langues romanes (issues du latin) connues: «Nam alii Oc; alii Oil, alii Sì, affirmando loquuntur, ut puta Yispani, Franci et Latini», ce qui signifie «les uns disent oc, les autres oïl, et les autres si, pour affirmer, par exemple, comme les Espagnols, les Français et les Latins».
Bien que le français («françoys») ne soit pas encore une langue officielle (c'était le latin à l'écrit), il était néanmoins utilisé comme langue véhiculaire par les couches supérieures de la société et dans l'armée royale qui, lors des croisades, le porta en Italie, en Espagne, à Chypre, en Syrie et à Jérusalem.
La propagation de cette variété linguistique se trouva favorisée par la grande mobilité des Français: les guerres continuelles obligeaient des transferts soudains de domicile, qui correspondaient à un véritable nomadisme pour les soldats, les travailleurs manuels, les serfs émancipés, sans oublier les malfaiteurs et les gueux que la misère générale multipliait. De leur côté, les écrivains, ceux qui n'écrivaient plus en latin, cessèrent en même temps d'écrire en champenois, en picard ou en normand pour privilégier le «françoys».
Cette langue «françoise» du Moyen Âge ne paraît pas comme du «vrai français» pour les francophones du XXIe siècle. Il faut passer par la traduction, tellement cette langue, dont il n'existe que des témoignages écrits nécessairement déformés par rapport à la langue parlée, demeure différente de celle de notre époque. Les étudiants anglophones des universités ont moins de difficultés à comprendre cet ancien français que les francophones eux-mêmes, la langue anglaise étant bien imprégnée de cette langue! Voici un texte d'ancien français rédigé vers 1040 et extrait de La vie de saint Alexis. Dans ce document, Alexis renonce à sa femme, à sa famille et à la «vie dans le monde» pour vivre pauvre et chaste.
C'est l'un des premiers textes écrits en ancien français qui nous soit parvenu. Il s'agit ici d'un petit extrait d'un poème de 125 strophes. Ce n'est donc pas une transcription fidèle de la langue parlée du XIe siècle, même s'il faut savoir que la graphie était relativement phonétique et qu'on prononçait toutes les lettres:
Ancien français
1. bons fut li secles al tens ancïenur
2. quer feit iert e justise et amur,
3. si ert creance, dunt ore n'i at nul prut;
4. tut est müez, perdut ad sa colur:
5. ja mais n'iert tel cum fut as anceisurs.
6. al tens Nöé et al tens Abraham
7. et al David, qui Deus par amat tant,
8. bons fut li secles, ja mais n'ert si vailant;
9. velz est e frailes, tut s'en vat remanant:
10. si'st ampairet, tut bien vait remanant
11. puis icel tens que Deus nus vint salver
12. nostra anceisur ourent cristïentet,
13. si fut un sire de Rome la citet:
14. rices hom fud, de grant nobilitet;
15. pur hoc vus di, d'un son filz voil parler.
16. Eufemïen -- si out annum li pedre --
17. cons fut de Rome, des melz ki dunc ieret;
18. sur tuz ses pers l'amat li emperere.
19. dunc prist muiler vailante et honurede,
20. des melz gentils de tuta la cuntretha
21. puis converserent ansemble longament,
22. n'ourent amfant peiset lur en forment
23. e deu apelent andui parfitement:
24. e Reis celeste, par ton cumandement
25. amfant nus done ki seit a tun talent.Français contemporain
1. Le monde fut bon au temps passé,
2. Car il y avait foi et justice et amour,
3. Et il y avait crédit ce dont maintenant il n'y a plus beaucoup;
4. Tout a changé, a perdu sa couleur:
5. Jamais ce ne sera tel que c'était pour les ancêtres.
6. Au temps de Noé et au temps d'Abraham
7. Et à celui de David, lesquels Dieu aima tant.
8. Le monde fut bon, jamais il ne sera aussi vaillant;
9. Il est vieux et fragile, tout va en déclinant:
10. Tout est devenu pire, bien va en déclinant (?)
11. Depuis le temps où Dieu vint nous sauver
12. Nos ancêtres eurent le christianisme.
13. Il y avait un seigneur de Rome la cité:
14. Ce fut un homme puissant, de grande noblesse;
15. Pour ceci je vous en parle, je veux parler d'un de ses fils.
16. Eufemïen -- tel fut le nom du père --
17. Il fut comte de Rome, des meilleurs qui alors y étaient
18. L'empereur le préféra à tous ses pairs.
19. Il prit donc une femme de valeur et d'honneur,
20. Des meilleurs païens de toute la contrée.
21. Puis ils parlèrent ensemble longuement.
22. Qu'ils n'eurent pas d'enfant; cela leur causa beaucoup de peine.
23. Tous les deux ils en appellent à Dieu parfaitement
24. «Ô! Roi céleste, par ton commandement,
25. Donne-nous un enfant qui soit selon tes désirs.»Pour un francophone contemporain, il ne s'agit pas d'un texte français, mais plutôt d'un texte qui ressemble au latin. Pourtant, ce n'est plus du latin, mais du français, un français très ancien dont les usages sont perdus depuis fort longtemps.
1.3 L'expansion du français en Angleterre
Au cours du Xe siècle, les rois furent souvent obligés de mener une vie itinérante sur leur petit domaine morcelé et pauvre. Incapable de repousser les envahisseurs vikings (ces «hommes du Nord» — Northmans — venus de la Scandinavie), Charles III le Simple leur concéda en 911 une province entière, la Normandie. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte cédait au chef Rollon le comté de Rouen, qui deviendra le duché de Normandie. En échange, Rollon s'engageait à bloquer les incursions vikings menaçant le royaume des Francs et demeurait vassal du roi et devenait chrétien en 912 en la cathédrale de Rouen sous le nom de Robert (Robert Ier le Riche).
- L'assimilation des Vikings
Les Vikings de Normandie, comme cela avait été le cas avec les Francs, perdirent graduellement leur langue scandinave, le vieux norrois apparenté au danois. Dans leur duché, désormais libérés de la nécessité de piller pour survivre, les Vikings devinrent sédentaires et fondèrent des familles avec les femmes du pays. Celles-ci parlaient ce qu'on appellera plus tard le normand, une langue romane qu'elles ont apprise naturellement à leurs enfants. On estime que le langue des Vikings, encore vivante à Bayeux au milieu du
Xe siècle, n'a pas survécu bien longtemps au-delà de cette date. Autrement dit, l'assimilation des vainqueurs vikings s'est faite rapidement et sans trop de problèmes. L'héritage linguistique des Vikings se limite à moins d'une cinquantaine de mots, presque exclusivement des termes maritimes: cingler, griller, flâner, crabe, duvet, hauban, hune, touer, turbot, guichet, marsouin, bidon, varech, homard, harfang, etc.
Moins d'un siècle après leur installation en Normandie, ces anciens Vikings, devenus des Normands, prirent de l'expansion et partirent chercher fortune par petits groupes en Espagne en combattant les Maures aux côtés des rois chrétiens du Nord (1034-1064), ainsi qu'en Méditerranée, en Italie du Sud et en Sicile, jusqu’à Byzance, en Asie mineure et en «Terre Sainte» lors des croisades. Partout, les Normands répandirent le français hors de France.
- Les prétentions à la couronne anglaise
De plus, le duc de Normandie devint plus puissant que le roi de France avec la conquête de l'Angleterre. Rappelons que les Normands étaient depuis longtemps en contact avec l'Angleterre; ils occupaient la plupart des ports importants face à l’Angleterre à travers la Manche.
Cette proximité entraîna des liens encore plus étroits lors du mariage en 1002 de la fille du duc Richard II de Normandie, Emma, au roi Ethelred II d'Angleterre. À la mort d'Édouard d'Angleterre en 1066, son cousin, le duc de Normandie appelé alors Guillaume le Bâtard — il était le fils illégitime du duc de Normandie, Robert le Magnifique, et d'Arlette, fille d'un artisan préparant des peaux — décida de faire valoir ses droits sur le trône d'Angleterre.
C'est par sa parenté avec la reine Emma (décédée en 1052) que Guillaume, son petit-neveu, prétendait à la couronne anglaise. Selon les anciennes coutumes scandinaves, les mariages dits en normand à la danesche manere («à la danoise») désignaient la bigamie pratiquée par les Vikings implantés en Normandie et, malgré leur conversion officielle au christianisme, certains Normands avaient plusieurs femmes. Or, les enfants nés d'une frilla, la seconde épouse, étaient considérés comme parfaitement légitimes par les Normands, mais non par l'Église. Autrement dit, Guillaume n'était «bâtard» qu'aux yeux de l'Église, car il était légalement le successeur de son père, Robert le Magnifique (v. 1010-1035).
- La bataille de Hastings (14 octobre 1066)
Avec une armée de 6000 à 7000 hommes, quelque 1400 navires (400 pour les hommes et 1000 pour les chevaux) et... la bénédiction du pape, Guillaume II de Normandie débarqua dans le Sussex, le 29 septembre, puis se déplaça autour de Hastings où devait avoir lieu la confrontation avec le roi Harold II. Mais les soldats de Harold, épuisés, venaient de parcourir 350 km à pied en moins de trois semaines, après avoir défait la dernière invasion viking à Stamford Bridge, au centre de l'Angleterre, le 25 septembre 1066.
Le 14 octobre, lors de la bataille de Hastings, qui ne dura qu'une journée, Guillaume réussit à battre Harold II, lequel fut même tué. Le duc Guillaume II de Normandie, appelé en Angleterre «William the Bastard» (Guillaume le Bâtard), devint ainsi «William the Conqueror» (Guillaume le Conquérant). Le jour de Noël, il fut couronné roi en l'abbaye de Westminster sous le nom de Guillaume Ier d'Angleterre.
- Les nouveaux maîtres et la langue
Le nouveau roi s'imposa progressivement comme maître de l'Angleterre durant les années qui suivirent. Il évinça la noblesse anglo-saxonne qui ne l'avait pas appuyé et favorisa ses barons normands et élimina aussi les prélats et les dignitaires ecclésiastiques anglo-saxons en confiant les archevêchés à des dignitaires normands.
On estime à environ 20 000 le nombre de Normands qui se fixèrent en Angleterre à la suite du Conquérant. Par la suite, Guillaume Ier (1066-1087) exerça sur ses féodaux une forte autorité et devint le roi le plus riche et le plus puissant d'Occident. Après vingt ans de règne, l'aristocratie anglo-saxonne était complètement disparue pour laisser la place à une élite normande, tandis qu'il n'existait plus un seul Anglais à la tête d'un évêché ou d'une abbaye. La langue anglaise prit du recul au profit du franco-normand.
Guillaume Ier d'Angleterre et les membres de sa cour parlaient une variété de français appelé aujourd’hui le franco-normand (ou anglo-normand), un «françois» teinté de mots nordiques apportés par les Vikings qui avaient, un siècle auparavant, conquis le nord de la France. À partir ce ce moment, le mot normand perdit son sens étymologique d'«homme du Nord» pour désigner un «habitant du duché de Normandie».
La conséquence linguistique de Guillaume le Conquérant fut d’imposer le franco-normand, considéré comme du «françois» plus local, dans la vie officielle en Angleterre. Alors que les habitants des campagnes et la masse des citadins les plus modestes parlaient l’anglo-saxon, la noblesse locale, l’aristocratie conquérante, ainsi que les gens d'Église et de justice, utilisaient oralement le franco-normand, mais le clergé, les greffiers, les savants et les lettrés continuaient pour un temps d'écrire en latin.
Le françois de France, pour sa part, acquit également un grand prestige dans toute l'Angleterre aristocratique. En effet, comme tous les juges et juristes étaient recrutés en France, le «françois» de France devint rapidement la langue de la loi et de la justice, sans compter que de nombreuses familles riches et/ou nobles envoyaient leurs enfants étudier dans les villes de France.
Le premier roi de la dynastie des Plantagenêt, Henri II, du fait de son mariage avec Aliénor d'Aquitaine en 1152, englobait, outre l'Irlande et l'Écosse, plus de la moitié occidentale de la France. Bref, Henri II gouvernait un royaume allant de l'Écosse aux Pyrénées: c'était la plus grande puissance potentielle de l'Europe. Par la suite, Philippe Auguste reprit aux fils d'Henri II, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, la majeure partie des possessions françaises des Plantagenêt (Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Poitou, Aquitaine, Limousin et Bretagne). À ce moment, toute la monarchie anglaise parlait «françois», et ce, d'autant plus que les rois anglais épousaient uniquement des princesses françaises (toutes venues de France entre 1152 et 1445). Il faut dire aussi que certains rois anglais passaient plus de temps sur le continent qu'en Grande-Bretagne. Ainsi, Henri II passa 21 ans sur le continent en 34 ans de règne.
Lorsque, en 1259, Henri III d’Angleterre renonça officiellement à la possession de la Normandie, la noblesse anglaise eut à choisir entre l'Angleterre et le Continent, ce qui contribua à marginaliser le franco-normand au profit, d'une part, du français parisien, d'autre part, de l'anglais.
1.4 La langue du roi de France
Au cours du XIIe siècle, on commença à utiliser le «françois» à l'écrit, particulièrement dans l'administration royale, qui l'employait parallèlement au latin. Sous Philippe Auguste (1165-1223), le roi de France avait considérablement agrandi le domaine royal: après l'acquisition de l'Artois, ce fut la Normandie, suivie de la Touraine, de l'Anjou et du Poitou. C'est sous son règne que se développa l'administration royale avec la nomination des baillis dans le nord du pays, des sénéchaux dans le Sud.
Mais c'est au XIIIe siècle qu'apparurent des œuvres littéraires en «françois». À la fin de ce siècle, le «françois» s'écrivait en Italie (en 1298, Marco Polo rédigea ses récits de voyages en françois), en Angleterre (depuis la conquête de Guillaume le Conquérant), en Allemagne et aux Pays-Bas. Évidemment, le peuple ne connaissait rien de cette langue, même en Île-de-France (région de Paris) où les dialectes locaux continuaient de subsister.
Lorsque Louis IX (dit «saint Louis») accéda au trône de France (1226-1270), l 'usage du «françois» de la Cour avait plusieurs longueurs d'avance sur les autres parlers en usage. Au fur et à mesure que s'affermissait l'autorité royale et la centralisation du pouvoir, la langue du roi de France gagnait du terrain, particulièrement sur les autres variétés d'oïl. Mais, pour quelques siècles encore, le latin gardera ses prérogatives à l'écrit et dans les écoles. De fait, après plusieurs victoires militaires royales, ce françois prit le pas sur les les autres langues d'oïl (orléanais, champenois, angevin, bourbonnais, gallo, picard, etc.) et s'infiltra dans les principales villes du Nord avant d'apparaître dans le Sud. À la fin de son règne, Louis IX était devenu le plus puissant monarque de toute l'Europe, ce qui allait assurer un prestige certain à sa langue, que l'on appelait encore le françois.
A l'époque de l'ancien français (françois), les locuteurs semblent avoir pris conscience de la diversité linguistique des parlers du nord de la France. Comme les parlers d'oïl différaient quelque peu, ils étaient généralement perçus comme des variations locales d'une même langue parce que de village en village chacun se comprenait.
Thomas d'Aquin (1225-1274), théologien de l'Église catholique, donne ce témoignage au sujet de son expérience: «Dans une même langue [lingua], on trouve diverses façons de parler, comme il apparaît en français, en picard et en bourguignon; pourtant, il s'agit d'une même langue [loquela].» Cela ne signifie pas cependant que la communication puisse s'établir aisément. De plus, les jugements de valeur sur les «patois» des autres étaient fréquents. Dans le Psautier de Metz (ou Psautier lorrain) rédigé vers 1365, l'auteur, un moine bénédictin de Metz, semble déplorer que les différences de langage puisse compromettre la compréhension mutuelle:
En françois d'époque Et pour ceu que nulz ne tient en son parleir ne rigle certenne, mesure ne raison, est laingue romance si corrompue, qu'a poinne li uns entent l'aultre et a poinne puet on trouveir a jour d'ieu persone qui saiche escrire, anteir ne prononcieir en une meismes meniere, mais escript, ante et prononce li uns en une guise et li aultre en une aultre.
En traduction [Et parce que personne, en parlant, ne respecte ni règle certaine ni mesure ni raison, la langue romane est si corrompue que l'on se comprend à peine l'un l'autre et qu'il est difficile de trouver aujourd'hui quelqu'un qui sache écrire, converser et prononcer d'une même façon, mais chacun écrit, converse et prononce à sa manière.]
Conon de Béthune (v. 1150-1220) est un trouvère né en Artois et le fils d'un noble, Robert V de Béthune. Il a participé aux croisades et a tenu à son époque un rôle politique important. Il doit surtout sa renommée aux chansons courtoises qu'il a écrites. Lors d'un séjour à la cour de France en 1180, il chanta ses œuvres devant Marie de Champagne et Adèle de Champagne, la mère du roi Philippe Auguste. Le texte qui suit est significatif à plus d'un titre, car Conon de Béthune oppose deux «patois», le picard d'Artois et le «françois» de l'Île-de-France:
La roine n'a pas fait ke cortoise,
Ki me reprist, ele et ses fieux, li rois,
Encor ne soit ma parole françoise;
Ne child ne sont bien apris ne cortois,
Si la puet on bien entendre en françois,
S'il m'ont repris se j'ai dit mots d'Artois,
Car je ne fui pas norris à Pontoise.[La reine ne s'est pas montrée courtoise,
lorsqu'ils m'ont fait des reproches, elle et le roi, son fils.
Certes, mon langage n'est pas celui de France,
mais on peut l'apprendre en bon français.
Ils sont malappris et discourtois
ceux qui ont blâmé mes mots d'Artois,
car je n'ai pas été élevé à Pontoise.]Si le poète considère que ses «mots d'Artois» constituent une variante légitime du français, le roi et la reine estiment que l'emploi des picardismes est une façon de ne pas respecter le bon usage de la Cour et qu'il faut adopter une langue plus proche de celle du roi, ce qu'on appelle alors le «langage de France», c'est-à-dire la «langue de l'Île-de-France». Déjà à cette époque, les parlers locaux sont perçus de façon négative. Dans le Tournoi de Chauvency écrit en 1285, le poète Jacques Bretel oppose le «bon françois» au «valois dépenaillé» (walois despannei):
Lors commença a fastroillier
Et le bon fransoiz essillier,
Et d'un walois tout despannei
M'a dit: «Bien soiez vos venei,
Sire Jaquemet, volontiers.»[Il commença alors à baragouiner
et à massacrer le bon français,
dans un valois tout écorché
il me dit: «Soyez le bienvenu,
Monsieur Jacquemet, vraiment!»]Dans d'autres textes, on parle du «langage de Paris». Ce ne sont là que quelques exemples, mais ils témoignent éloquemment que le «françois» parlé à la Cour du roi et à Paris jouissait dans les milieux aristocratiques d'un prestige supérieur aux autres parlers. Ainsi, la norme linguistique choisie devient progressivement le «françois» de l'Île-de-France qui se superposa aux autres «langages», sans les supprimer.
Mais il faut faire attention, car la langue nationale qui commence à s'étendre au royaume de France n'est pas le «langage de Paris», plus précisément le parler des «vilains», c'est-à-dire celui des manants, des paysans et des roturiers, mais c'était le «françois» qui s'écrivait et qui était parlé à la Cour de France, donc la variété cultivée et socialement valorisée du «françois». Voici un témoignage intéressant à ce sujet; il provient d'un poème biblique (1192) rédigé par un chanoine du nom de Evrat, de la collégiale Saint-Étienne de Troyes:
Tuit li languages sunt et divers et estrange
Fors que li languages franchois:
C'est cil que deus entent anchois,
K'il le fist et bel et legier,
Sel puet l'en croistre et abregier
Mielz que toz les altres languages.[Toutes les langues sont différentes et étrangères
si ce n'est la langue française;
c'est celle que Dieu perçoit le mieux,
car il l'a faite belle et légère,
si bien que l'on peut l'amplifier ou l'abréger
mieux que toutes les autres.]Selon ce point de vue, le «françois» est ni plus ni moins de nature divine! C'est la plus belle langue, après le latin, et après le grec et l'hébreu, les trois langues des Saintes Écritures. Mais ce français c'était également le «françois» de l'Administration royale, celui des baillis et des sénéchaux, qui devaient être gentilshommes de nom et d'armes, ainsi que de leurs agents (prévôts, vicomtes, maires, sergents, forestiers, etc.).
Ce personnel administratif réparti dans toute la France exerçait au nom du roi tous les pouvoirs: ils rendaient la justice, percevaient les impôts, faisaient respecter la loi et l'ordre, recevaient les plaintes des citoyens, etc. Ces milliers de fonctionnaires — déjà 12 000 vers 1500 — étaient bilingues et pouvaient s'exprimer dans un «françois» assez normalisé. Près du tiers des commis de l'État se trouvait à Paris, que ce soit au Parlement, à la Chambre des comptes, à la Chancellerie, à la Cour du trésor, à la Cour des aides, etc.
À la fin du Moyen Âge, on trouvait partout en France des gens pouvant se faire comprendre en «françois». Dans son Esclarcissement de la langue francoyse écrit en anglais (1530), John Palsgrave apporte ce témoignage: «Il n'y a pas non plus d'homme qui ait une charge publique, qu'il soit capitaine, ou qu'il occupe un poste d'indiciaire, ou bien qu'il soit prédicateur, qui ne parle le parfait françois, quel que soit son lieu de résidence.» D'ailleurs, dès 1499, une ordonnance royale exigeait que les sergents royaux sachent lire et écrire le «françois».
T
ous ces gens écrivaient et produisaient en français des actes, procès-verbaux, comptes, inventaires, suppliques, pétitions, etc. C'est ainsi que la bureaucratisation a pu jouer un rôle primordial dans l'expansion de la «langue du roi». À partir du XIIe siècle, on s'est mis à écrire des chansons de geste, des chansons de trouvère, des fabliaux, des contes, des ouvrages historiques, des biographies de saints, des traductions de la Bible, etc., le tout en «françois du roi». Avec l'apparition de l'imprimerie dès 1470 en France, le français du roi était assuré de gagner la partie sur toute autre langue dans le royaume.
En même temps, les paysans qui constituaient quelque 90 % de la population, continuaient de pratiquer leur langue maternelle régionale. Parfois, des mots du «françois» pouvaient s'implanter dans leur vocabulaire, mais sans plus. Dans les écoles, on enseignait le latin, quitte à passer par le «françois» ou le patois pour expliquer la grammaire latine. Avec le temps, les écoles des villes se mirent à enseigner la langue françoise.
À la fin du Moyen Âge, la majorité des citadins pouvait lire le «françois», sans nécessairement l'écrire. Dans les campagnes, l'analphabétisme régnait, mais beaucoup de paysans pouvaient lire en «françois» des textes simples comme des contrats de mariage, des testaments, des actes de vente, des créances, etc.
2 L'état de l'ancien français
L'ancien français a transformé considérablement la langue romane au point de la rendre méconnaissable.
2.1 Le système phonétique
L'ancien français présentait un système phonétique de transition très complexe, qui ne devait pas durer. Il possédait de nombreux sons ignorés aussi bien du latin et du roman que du français moderne. Cet ancien français du XIIe siècle se caractérise par la surabondance au plan phonétique. Il s'agit bien de surabondance plutôt que de richesse fonctionnelle, car si le nombre des voyelles et des consonnes demeure élevé, leur rendement phonologique s'avère faible.
- La prononciation des consonnes
En finale de mot, la règle était de prononcer toutes les consonnes écrites. Cependant, les lettres n'avaient pas la même valeur qu'on leur donne actuellement. Ainsi, le -t final s'est prononcé [θ] (comme le th sourd de l'anglais) jusqu'à la fin du XIe siècle, dans des mots comme aimet, chantet et vertut; toutefois, ce [θ] constrictif est tombé en désuétude et il devait être rare dès le début du XIIe siècle.
Contrairement à ce qui se passe en français moderne, tous les -s du pluriel se faisaient entendre. Par exemple, chevaliers et les omes (hommes) se prononçaient [tchëvaljèrs] et [lèzom-mës]. La lettre finale -z des mots tels amez (aimez), chantez, dolz (doux) avait la valeur de l'affriquée [ts]. Enfin, la lettre -l était mouillée (palatalisée) en [λ] en fin de mot: il = [iλ], soleil = [sòlèλ], peril = [periλ].
Rappelons que la période romane avait introduit la prononciation d'un [h] dit «aspiré» dans des mots d'origine francique comme honte, haine, hache, haïr, hêtre, héron. etc. Cette prononciation du [h] s'est atténuée au cours de l'ancien français, qui finira par ne plus écrire le h initial dans la graphie. Par exemple, le mot « homme» du français moderne s'écrivait ome (du latin hominem) en ancien français. Le h graphique a été réintroduit dans les siècles suivants soit par souci étymologique (p. ex. ome < lat. hominem > homme) soit pour interdire la liaison (p. ex. harnais, hutte, etc.).
L'un des traits caractéristiques de cet état de langue ancien résidait dans la présence des consonnes affriquées. Au nombre de quatre, elles correspondaient aux sons [ts], [dz], [tch] et [dj]comme dans djihad. Dans la graphie, elles étaient rendues respectivement par c (devant e et i) et -z en finale, par z à l'intérieur du mot, par ch, et par g (devant e et i) ou j (devant a, o, u). Le graphème ë correspond au son [e] neutre comme dans cheval ou chemin; en finale de mot, les e se prononçaient tous: cire, place, argile, d'où le [ë] dans le tableau ci-dessous.
Lettres Son Ancien français Prononciation Français moderne c + i
c + e-z
[ts]
cire
placeamez
marz[tsirë]
[platsë][amèts]
[marts]cire
placeaimez
mars-z- [dz]
treize
raizon[treidzë]
[raidzon-n]treize
raisong + e
g + ij + a
j + o
j + u[dj]
gesir
argilejambe
jorn
jugier[djézir]
[ardjilë][djam-mbë]
[djòrn]
[djudjjèr]gésir
argilejambe
jour
jugerch- [tch]
chief
sache
riche[tchièf]
[satchë]
[ritchë]chef
sache
richeDans certains mots, les consonnes nasales [m] et [n], comme on les connaît en français contemporain, avaient déjà perdu leur articulation propre à la finale dans des mots comme pain, faim, pont, blanc, brun, etc. En fait, la consonne nasale était combinée avec la voyelle qui la précède et on ne la prononçait plus, et ce, même si elle était conservée dans la graphie: pain , bon, faim, etc.
En général, en ancien français, les consonnes nasales pouvaient garder leur articulation propre et n'étaient pas nasalisées avec la voyelle précédente (comme aujourd'hui): on prononçait distinctement la voyelle nasale ET la consonne nasale. Par exemple, on prononçait les mots bien, bon, jambe, sentir, rompre, etc., en faisant bien sentir la consonne [n] ou [m].
Par exemple, dans l'adjectif bonne, non seulement la consonne était prononcée (comme aujourd'hui), mais la voyelle [ò] était nasalisée (ce qui n'est plus le cas) et la voyelle finale, prononcée: [bon + n + në], [bien + n], [djam + bë], [sen + tir], [rom + m + prë]. Il faudrait noter aussi la chute de [s] devant une consonne sourde: hoste > hôte; maistre > maître; teste > tête; coustume > coutume; forest > forêt.
- La prononciation des voyelles
Comparé au système consonantique, le système vocalique (voyelles) est encore plus complexe en ancien français du
XIIe siècle. En fait, on à peine à imaginer aujourd'hui cette surabondance des articulations vocaliques dont était caractérisée l'ancienne langue française. De plus, il est difficile de déterminer si ces articulations étaient toutes des phonèmes ou si plusieurs de celles-ci correspondaient plutôt à des variantes combinatoires; certains spécialistes n'hésitent pas à croire qu'il s'agissait d'un système phonologique plutôt que simplement phonétique.
Les voyelles de l'ancien français étaient les suivantes:
- 9 voyelles orales: [i], [é], [è], [a], [o], [ò], [ou], [u], [ë]
- 5 voyelles nasales: [an], [ein], [in], [oun], [un]
- 11 diphtongues orales: [ie], [ue], [ei], [òu], [ai], [yi], [oi], [au], [eu], [èu], [ou]
- 5 diphtongues nasalisées: [an-i], [ein-i], [i-ein], [ou-ein], [u-ein]
- 3 triphtongues: [ieu], [uou], [eau]
Ce système donne un total impressionnant de 33 voyelles. Le français moderne en compte maintenant 16 et, par rapport aux autres langues, on peut considérer que c'est déjà beaucoup. Il s'agit là d'un système que l'on pourrait qualifier d'«anormal» dans l'histoire; d'ailleurs, il sera simplifié au cours dès le XIIIe siècles.
Au début du XIIe siècle, les voyelles notées avec deux lettres correspondaient à des diphtongues. On en comptait 16, dont 11 orales et 5 nasales. Autrement dit, toutes les lettres écrites se prononçaient. Le groupe oi était diphtongué en [oi], comme dans le mot anglais boy que l'on transcrirait phonétiquement [bòj] ou [bòi]; par exemple, roi se prononçait [ròj] (ou [ròi]. Pour les autres diphtongues, il fallait prononcer en une seule émission les deux «parties» de la voyelle: [ie], [ue], [ei], etc.
Voici des exemples d'anciennes diphtongues dont on retrouve les traces encore dans la graphie d'aujourd'hui: fou, voir, feu, sauver, saut, douleur, chaise, causer, truite, etc. La diphtongue [au] était prononcée [ao] plutôt que [au], et elle est demeurée diphtonguée durant tout le début du Moyen Âge dans des mots comme saut, sauver, etc. Elle se réduira à [o] au cours du XVIe siècle.
L'ancien français possédait aussi des triphtongues: [ieu], [uou], [eau]. On en retrouve des vestiges dans des mots contemporains en [eau] comme oiseau, beau, drapeau; en ancien français ces mêmes voyelles étaient triphtonguées, plus du tout aujourd'hui.
Au cours des XIIIe et XIVe siècles, l'ancien français continuera d'évoluer. Ainsi, la graphie oi est passée de la prononciation en [oi] comme dans boy à [oé], puis [oè] et finalement [wè]: des mots comme roi, moi, loi, toi, etc., étaient donc prononcés [rwè], [mwè], [lwè], [twè], etc. La prononciation en [wa] était déjà attestée au XIIIe siècle, mais elle n'était pas généralisée. Certains critiquaient cette prononciation en [wa], car elle était surtout employée par les classes modestes; elle triomphera à la Révolution française.
Il est difficile de se faire une idée de ce qu'était, au XIIIe siècle, la prononciation de l'ancien français. En guise d'exemple, prenons ce vers tiré de la Chanson de Roland:
des peaux de chievres blanches
[des peaux de chèvres blanches]À cette époque, l'écriture était phonétique: toutes les lettres devaient se prononcer. Par rapport à la prononciation actuelle [dé-po-t'chèvr' blanch], on disait donc alors, en prononçant toutes les lettres: dé-ss péawss de tchièvress blan-ntchess. Ce qui donne 26 articulations contre 13 aujourd'hui, où l'on ne prononce plus les -s du pluriel. C'est donc une langue qui paraîtrait rude à plus d'une oreille contemporaine, sans compter la «truculence verbale» courante à l'époque.
À cet égard, on aura intérêt à lire le petit extrait du Roman de Renart (fin du XIIIe siècle) reproduit ici:
Fin XIIIe siècle
1. Dame Hermeline ot la parole
2. Respond li comme dame fole
3. jalouse fu & enflamee
4. q'ses sires lavoit amee
5. & dist : ne fuce puterie
6. & mauvestie & lecherie
7. Grant deshonor & grant putage
8. Felstes vos & grant outrage
9. q'ant vos soufrites monbaron
10. Q'vos bati vostre ort crepon.Traduction contemporaine
1. Dame Hermeline prit la parole,
2. Elle lui répond en femme folle;
3. elle était jalouse et enflammée
4. parce que son mari Hersant l'avait possédée.
5. Et elle dit : ne fut-ce conduite de putain
6. et mauvaiseté et dévergondage?
7. Un grand déshonneur et une grande putinerie,
8. voilà ce que vous avez fait avec grand outrage
9. quand vous avez laissé mon mari
10. vous frotter votre sale croupion.4.2 La grammaire
Au plan morpho-syntaxique, l'ancien français conservait encore sa déclinaison à deux cas (déclinaisons) et l'ordre des mots demeurait assez libre dans la phrase, généralement simple et brève. Jusqu'au
XIIIe siècle, les deux cas de l'ancien français sont les mêmes que pour la période romane: le cas sujet (CS) et le cas régime (CR) issu de l'accusatif latin.
Déclinaison I: CS (cas sujet)
CR (cas non sujet)li murs (le mur)
le mur (le mur)li mur (les murs)
les murs (les murs)Déclinaison II: CS (cas sujet)
CR (cas non sujet)li pere (le père)
le pere (le père)le pere (les pères)
les peres (les pères)Déclinaison III: CS (cas sujet)
CR (cas non sujet)li cuens (le comte)
le comte (le comte)li comte (les comtes)
les comtes (les comtes)De façon générale, c'est le cas régime (autre que sujet) qui a persisté en français, car la déclinaison à deux cas a commencé à s'affaiblir dès le XIIIe siècle et, à la fin du XIVe siècle, le processus était rendu à son aboutissement: il ne restait plus qu'un seul cas, le cas régime. C'est sur celui-ci que repose la forme des mots français d'aujourd'hui.
- L'article
Une autre innovation concerne l'apparition de l'article en ancien français, alors que le latin n'avait pas d'article, son système sophistiqué de déclinaison pouvant se passer de ce mot outil. Le français a développé un système d'articles à partir des démonstratifs ille/illa/illud, qui ont donné les déterminants appelés «articles définis». Les articles en ancien français se déclinaient comme les noms en CS et CR, au masculin comme au féminin. Alors qu'en français moderne, on a l'opposition le / la / les, l'ancien français opposait li / le (masc.), la (fém.) et les (plur.).
Article
définiMASCULIN FÉMININ Singulier Pluriel Singulier Pluriel CS li li la les CR le les Pour l'article indéfini, ce sont les formes uns / un (masc.) et une (fém.), alors que le pluriel était toujours marqué par uns (en français moderne: des).
Article
indéfiniMASCULIN FÉMININ Singulier Pluriel Singulier Pluriel CS uns uns une unes CR un L'emploi du genre
De façon générale, la marque du genre se trouvait en latin dans la désinence des noms et des adjectifs, c'est-à-dire dans leur terminaison. Dans l'évolution du latin vers l'ancien français, les marques du genre ont perdu leurs caractéristiques d'origine. Pour simplifier la description, on peut indiquer les grandes tendances suivantes:
1) La déclinaison féminine en -as a donné des mots du genre féminin en français: rosam > rose / rosas > roses.
2) Les pluriels neutres latins en -a ont également donné des mots au féminin en français: folia > feuille; arma > arme.
3) Les mots masculins latins en -is sont devenus masculins en français: canis > chien; panis> pain; rex/regis > roi.
4) Les noms latins terminés en -er sont aussi devenus masculins: pater > père; frater > frère; liber > livre.
Pendant la période romane, le latin a perdu le neutre qui a été absorbé par le masculin; par exemple, granum > granus > grain (masc.). Du neutre latin, granum et lactis sont passés au masculin en français; du masculin latin, floris est passé au féminin en français; par contre, gutta et tabula sont restés au féminin; mais burra (bure) a conservé le féminin du latin pour passer au masculin lorsqu'il a désigné le «bureau» en français.
Cependant, beaucoup de mots d'ancien français ont changé de genre au cours du Moyen Âge. Ainsi, étaient féminins des mots comme amour, art, évêché, honneur, poison, serpent; aujourd'hui, ces mots sont masculins. À l'opposé, des mots aujourd'hui féminins étaient alors masculins: affaire, dent, image, isle (île), ombre, etc.
- La féminisation
L'ancien français semble une langue moins sexiste que le français contemporain, du moins si l'on se fie à certaines formes qui existaient à l'époque. Voici une liste de mots au masculin et au féminin:
Notons aussi l'opposition damoiselle (fém.) / damoisel (masc.) ou damoiselle/damoiseau pour désigner les jeunes nobles (femmes ou hommes), qui n'étaient pas encore mariés; au cours des siècles, seul le mot demoiselle est resté dans la langue, alors que les formes masculines damoisel/damoiseau sont disparus. Après tous ces changements, on ne se surprendra pas qu'on en soit arrivé à une répartition arbitraire des genres en français moderne.
Dans le Guide Guide d’aide à la féminisation des noms (1999), les auteurs rapportent des exemples de termes féminisés tirés du Livre de la Taille de Paris de l’an 1296 et 1297 :
aiguilliere, archiere, blaetiere, blastiere, bouchere, boursiere, boutonniere, brouderesse, cervoisiere, chambriere, chandeliere, chanevaciere, chapeliere, coffriere, cordiere, cordoaniere, courtepointiere, couturiere, crespiniere, cuilliere, cuisiniere, escueliere, estuveresse, estuviere, feronne, foaciere, fourniere, from(m)agiere, fusicienne, gasteliere, heaulmiere, la(i)niere, lavandiere, liniere, mairesse, marchande, mareschale, merciere, oublaiere, ouvriere, pevriere, portiere, potiere, poulailliere, prevoste, tainturiere, tapiciere, taverniere, etc.
- La numération
Il faut mentionner également le système de numération qui a profondément été modifié en ancien français. Les nombres hérités du latin correspondent aux nombres de un à seize. Le nombre dix-sept, par exemple, est le premier nombre formé d'après un système populaire (logique) qui sert pour tous les nombres suivants: 10 + 7, 10 + 8, 10 + 9, etc. En ce qui concerne les noms des dizaines, le latin possédait un système décimal; ainsi, dix (< decem) vingt (< viginti), trente (< tringinta), quarante (< quadraginta), cinquante (< quinquageni) et soixante (< sexaginta) sont d'origine latine. Il en est de même pour les formes employées en Belgique et en Suisse telles que septante (< septuaginta > septante), octante (< octoginta) ou huitante (< octoginta > oitante) et nonante (< nonaginta) dans septante-trois, octante-neuf (ou huitante-neuf), nonante-cinq, etc.
Mais, l'ancien français a adopté dès le XIIe siècle la numération normande (d'origine germanique) qui était un système vicésimal, ayant pour base le nombre vingt (écrit vint ou vin). Ce système était courant chez les peuples d'origine germanique. Selon ce système, on trouvait les formes vingt et dix (écrites vins et dis) pour 30, deux vins pour 40, trois vins pour 60, quatre vins pour 80, cinq vins pour 100, six vins pour 120, dis vins pour 200, quinze vins pour 300, etc. Encore au XVIIe siècle, des écrivains employaient le système vicésimal. Ainsi, Racine écrivait à Boileau: «Il y avait hier six vingt mille hommes ensemble sur quatre lignes.»
Le système de numération du français standard est donc hybride: il est à la fois d'origine latine et germanique. Quant à un numéral comme soixante-dix, c'est un mot composé (soixante + dix) de formation romane populaire; il faudrait dire trois-vingt-dix pour rester germanique (normand). Le numéral quatre-vingt-dix est également d'origine normande auquel s'ajoute le composé populaire [+ 10].
C'est l'Académie française qui, au XVIIe siècle, a adopté pour toute la France le système vicésimal pour 70, 80, 90, alors que le système décimal (avec septante, octante, nonante) étaient encore en usage de nombreuses régions; d'ailleurs, ce système sera encore en usage dans certaines régions en France jusque qu'après la Première Guerre mondiale.
- Les verbes
Au Moyen Âge, plusieurs verbes avaient des infinitifs différents de ceux d'aujourd'hui. Ainsi, au lieu de l'infinitif en -er (issu du latin des verbes en -are, par exemple dans cantare > chanter), on employait celui en -ir: abhorrir, aveuglir, colorir, fanir, sangloutir, toussir, etc. On trouvait aussi des infinitifs tout à fait inexistants aujourd'hui: les verbes tistre (tisser), benistre (bénir) et benire (bénir). De plus, de très nombreux verbes, fréquents au Moyen Âge, sont aujourd'hui disparus: ardoir (<ardere: brûler), bruire (<*brugere: faire du bruit), chaloir (<calere: avoir chaud), doloir (<dolere: souffrir), enfergier (<en fierges: mettre aux fers), escheler (<eschiele: monter dans une échelle), ferir (<ferire: combattre), nuisir <nocere: nuire), oisever (<*oiseus : être oisif), plaisir <placere: plaire), toster <*tostare: rôtir), vesprer < vesperare: faire nuit).
L'ancien français a fait disparaître certains temps verbaux du latin: le plus-que-parfait de l'indicatif (j'avais eu chanté), le futur antérieur (j'aurais eu chanté), l'impératif futur (?), l'infinitif passé (avoir eu chanter), l'infinitif futur (devoir chanter). En revanche, l'ancien français a créé deux nouvelles formes: le futur en -rai et le conditionnel en -rais. Le latin avait, pour le futur et le conditionnel, des formes composées du type cantare habes (mot à mot: «tu as à chanter»: chanteras), cantare habebas (mot à mot: «tu avais à chanter»: chanterais). Fait important, l'ancien français a introduit le «que» pour marquer le subjonctif; il faut dire que la plupart des verbes étaient semblables au présent et au subjonctif (cf. j'aime / il faut que j'aime).
Enfin, la conjugaison en ancien français ne s'écrivait pas comme aujourd'hui. Jusqu'en moyen français, on n'écrivait pas de -e ni de -s à la finale des verbes de l'indicatif présent: je dy, je fay, je voy, je supply, je rendy, etc. De plus, l'emploi du futur n'a pas toujours été celui qu'il est devenu aujourd'hui. Beaucoup écrivaient je priray (prier), il noura (nouer), vous donrez (donner), j'envoirai (envoyer), je mouverai (de mouver), je cueillirai (cueillir), je fairai (faire), je beuvrai (boire), je voirai (voir), j'arai (avoir), je sarai (savoir), il pluira (pleuvoir).
- Le participe passé
Le participe passé (avec avoir et avec être) existait en ancien français, mais il n'y avait pas de règles d'accord systématique. On pouvait au choix faire accorder le participe passé avec être ou sans auxiliaire, mais on n'accordait que rarement le participe avec avoir.
anc. fr.: Passée a la première porte.
fr. mod.: Elle a passé la première porte.En général, le participe passé ne s'accordait pas avec un nom qui le suivait: Si li a rendu sa promesse.
Néanmoins, cette langue restait encore assez près du latin d'origine. En fait foi cette phrase, extraite de la Quête du Graal de 1230, correspondant certainement à du latin francisé: «Sache que molt t'a Notre Sire montré grand débonnaireté quand il en la compagnie de si haute pucelle et si sainte t'a amené.» Pour ce qui est de l'orthographe, elle n'était point encore fixée et restait très calquée sur les graphies latines.
- La phrase
La phrase de l'ancien français ressemble relativement à celle du français moderne dans la mesure où elle respecte l'ordre sujet + verbe + complément avec certaines différences, alors que l'ordre des mots en latin pouvait être plus complexe. En voici un exemple tiré de La Mort du roi Arthur, rédigé vers 1120-1240 par un auteur anonyme:
"Sire, fet Agravains, oïl, et ge vos dirai comment." Lors le tret a une part et li dist a conseill : "Sire, il est einsi que Lancelos ainme la reïne de fole amour et la reïne lui. Et por ce qu'il ne pueent mie assembler a leur volenté quant vos i estes, est Lancelos remés, qu'il n'ira pas au tornoiement de Wincestre ; einz i a envoiez ceus de son ostel, si que, quant vos seroiz meüz ennuit ou demain, lors porra il tout par loisir parler a la reïne." [«Oui, sire, dit Agravain, je vais vous expliquer comment.» Il l'entraîna à l'écart et lui dit à voix basse : «Sire, la situation est telle que Lancelot et la reine s'aiment d'un amour coupable. Comme ils ne peuvent pas se rencontrer à leur aise quand vous êtes là, Lancelot est resté chez lui et n'ira pas au tournoi de Wincestre; mais il y a envoyé ceux de sa maison, si bien qu'après votre départ, ce soir ou demain, il aura tout le loisir de parler avec la reine.»] 3 Les langues parlées en France
Dans la France de cette époque, les locuteurs du pays parlaient un grand nombre de langues. Généralement, ils ignoraient le latin d'Église, à moins d'être instruits, ce qui était rarissime. Ils ignoraient également le «français du roy», sauf dans la région de l'Île-de-France, d'où allait émerger une sorte de français populaire parlé par les classes ouvrières.
Pour résumer rapidement la situation linguistique, on peut dire que les habitants de la France parlaient, selon les régions:
- diverses variétés de langues d'oïl: françois picard, gallo, poitevin, saintongeais, normand, morvandiau, champenois, etc.
- diverses variétés des langues d'oc (gascon, languedocien, provençal, auvergnat-limousin, alpin-dauphinois, etc.) ainsi que le catalan;
- diverses variétés du franco-provençal: bressan, savoyard, dauphinois, lyonnais, forézien, chablais, etc., mais aussi, en Suisse, genevois, vaudois, neuchâtelois, valaisan, fribourgeois et, en Italie, le valdôtain.
- des langues germaniques: francique, flamand, alsacien, etc.
Bref, à cette époque, le français n'était qu'une langue minoritaire parlée dans la région de l'Île-de-Francemme langue maternelle) et en province par une bonne partie de l'aristocratie (comme langue seconde)
4 La domination culturelle du latin
Pendant la période féodale, le prestige de l'Église catholique en Europe était immense. Le pape agit comme un véritable arbitre supranational à qui devaient obéissance les rois et l'empereur du Saint Empire romain germanique.
4.1 La langue de prestige
Non seulement le latin était la langue du culte, donc de tout le clergé et des abbayes, mais il demeurait l'unique langue de l'enseignement, de la justice et des chancelleries royales (sauf en France et en Angleterre, où l'on employait le français pour les communications entre les deux royaumes); c'était aussi la langue des sciences et de la philosophie. Il faudra attendre le
XIIIe siècle pour voir apparaître timidement les premiers textes de loi en «françois». Sous Charles IV (1322-1328), une charte sur dix seulement était rédigée en «françois». Sous Philippe VI (1328-1350), le latin dominait encore largement au début de son règne, mais à la fin les trois quarts des chartes étaient rédigées en «françois».
Les gens instruits devaient nécessairement se servir du latin comme langue seconde: c’était la langue véhiculaire internationale dans tout le monde catholique. Hors d'Europe, le turc, l'arabe, le chinois et le mongol jouaient un rôle analogue. C'est pourquoi les princes du royaume de France se devaient de connaître le latin. Le poète Eustache Deschamps (v.1346-v.1407) affirme, par exemple, qu'un roi sans lettres (comprendre «illettré» ou «sans latin» était un «âne» couronné:
Roy sanz lettres comme un asne seroit
S'il ne sçavoit l'Escripture ou les loys,
Chacun de ly par tout se moqueroit;
Thiés doivent savoir, latin, françoys,
Pour miex garder leurs pas et leurs destrois
Et sagement à chascun raison rendre.[Un roi illettré serait comme un âne
s'il ne connaissait l'écriture ou les lois,
car partout chacun se moquerait de lui ;
les Allemands doivent connaître le latin et le français,
pour mieux conserver leurs droits et leur juridiction
et que chacun rende justice avec sagesse.]Néanmoins, malgré cette exigence du latin chez les aristocrates de haut rang, les faits ont souvent démontré que la maîtrise du latin demeurait souvent un voeu pieux. C'est pourquoi beaucoup de nobles, qui qui avaient des connaissances rudimentaires de latin, embauchaient des traducteurs. S'il est difficile de savoir le degré de connaissance du latin de l'aristocratie française du Moyen Âge, il est par contre plus aisé de supposer que l'aristocratie occitane ait pu maintenir un plus grand bilinguisme.
4.2 La création des latinismes
De fait, le Moyen Âge fut une époque de traduction des oeuvres rédigées en latin. Or, ces traductions furent très importantes, car elles ont introduit une quantité impressionnante de mots savants issus du latin biblique, surtout à partir du
XIIe siècle. Ainsi, des noms de peuples juifs ont été francisés: israelite, philistin, sodomite, etc. De nombreux mots grecs sont passé au français dans les traductions du Nouveau Testament: ange, cataracte, Christ, eglise, synagogue, holocauste, orphelin, paradis, patriarche, prophete/prophetesse, psaume, psautier, scandale, etc. Les latinismes passent au français par les traductions de la Vulgate: abominer, abomination, abominable, adorer, arche, circoncision, confondre, confusion, consommer, consommation, contrition, convertir, deluge, etc.
Dans la Bible historiale completee (vers 1380-1390) de Guyart des Moulins, on peut relever plusieurs doublets pour traduire un même mot latin, l'un provenant du latin biblique (lingua latina), l'autre du «françois» vulgaire (lingua gallica):
arche
iniquité
misericorde
omnipotent
opprobe
redempteur
ternerhuche
felunie
merci
tout puissant
reproce
rachateor
assayerAutrement dit, dès l'apparition du plus ancien français, la langue puisa directement dans le latin les mots qui lui manquaient. Il était normal que l'on songe alors à recourir au latin, langue que tout lettré connaissait. Dans de nombreux cas, le mot emprunté venait combler un vide; dans d'autres cas, il doublait, comme on vient de le voir, un mot latin d'origine et les deux formes (celle du latin populaire et celle de l'emprunt savant) coexistèrent avec des sens et des emplois toujours différents. Commençons avec les mots nouveaux qui ne viennent pas doubler une forme déjà existante.
Afin de combler de nouveaux besoins terminologiques, l'Église catholique a elle-même donné l'exemple en puisant dans le vocabulaire latin pour se procurer les mots qui lui manquaient: abside, abomination, autorité, discipline, glorifier, majesté, opprobe, pénitence, paradis, quotidien, résurrection, humanité, vérité, virginité, etc. La philosophie a fait de même et est allée chercher des mots comme allégorie, élément, forme, idée, matière, mortalité, mutabilité, multiplier, précepte, question, rationnel, substance, etc. Nous devons aux juristes des termes comme dépositaire, dérogatoire, légataire, transitoire, etc. Mais c'est du domaine des sciences que l'ancien français a dû puiser le plus abondamment dans le fonds latin: améthiste, aquilon, aromatiser, automnal, azur, calendrier, diurne, emblème, équinoxe, fluctuation, occident, solstice, zone, etc. Les emprunts au latin classique comptent sûrement quelques dizaines de milliers de termes.
4.3 Un phénomène ininterrompu de latinisation
En fait, cet apport du latin classique n'a jamais cessé d'être productif au cours de l'histoire du français. Le mouvement, qui a commencé même un peu avant le
IXe siècle, s'est poursuivi non seulement durant tout le Moyen Âge, mais aussi à la Renaissance et au XVIIIe siècle pour se perpétuer encore aujourd'hui.
C'est au cours de cette période de l'ancien français que commença la latinisation à l'excès et qui atteindra son apogée au XVe siècle, avec le moyen français. L'expression «escumer le latin» est apparue au début du XIIe siècle. Elle désignait les latiniseurs qui «volaient» ou «pillaient» les ressources du latin, à l'exemple des pirates qui écumaient les mers. Les savants latiniseurs avaient développé un procédé lexical efficace qui consistait à ajouter une désinence «françoise» à un radical latin (savant).
Dans ces conditions d'usage intensif du latin par les savants du Moyen Âge, il était préférable d'écrire dans cette langue pour acquérir un prestige supérieur à celui qui n'écrivait qu'en «françois» (ou en tudesque), car le latin écrit était une langue européenne internationale permettant de communiquer avec l'ensemble des autres savants de l'époque. Qui plus est, une œuvre écrite en français pouvait être traduite en latin afin d'atteindre la célébrité. Cependant, à la fin du
XIIIe siècle, la production latine sera en baisse auprès de la Cour et aura tendance à se replier vers l'école et les sciences, sauf en Angleterre qui avait déjà tourné le dos au latin et qui considérait que le français était aussi une langue de vulgarisation scientifique.
5 L'influence de la langue arabe
C'est grâce à la diffusion de l'islam que la langue arabe s'est répandue après le VIe siècle. Cette langue, l'arabe littéraire ou coranique, fut codifiée et acquit alors le statut de langue savante, ce qui n'était pas le cas du français de l'époque. Puis le rayonnement de la langue et de la culture arabes progressa lors des conquêtes territoriales pendant tout le Moyen Âge. Les villes saintes de La Mecque et de Médine devinrent des centres religieux et intellectuels très importants. C'est par les ouvrages traduits en arabe que les intellectuels chrétiens d'Occident découvrirent la philosophie grecque ainsi que les sciences et les techniques des Anciens. Par exemple, les œuvres du mathématicien Euclide, de l'astronome Ptolémée, des médecins Hippocrate et Galien, du philosophe Aristote. De cette façon, les Arabes transmirent également les cultures indienne, perse et grecque, notamment en algèbre, en médecine, en philosophie, en alchimie, en botanique, en astronomie et en agronomie. Il faut comprendre qu'avec les œuvres se sont aussi transmis les mots.5.1 Les emprunts au français
De fait, la langue arabe a donné quelques centaines de mots au français, notamment au cours des XIIe et XIIIe siècles, mais encore au XIVe siècle. Ainsi, les savants arabes fournirent au français, directement ou par l'intermédiaire d'autres langues (le latin médiéval et l'espagnol), des termes d'origine arabo-persane tels que échec (jeu), jasmin, laque, lilas, safran ou timbale. C'est ainsi que le français emprunta à l'arabe des mots liés aux sciences, aux techniques et au commerce : abricot, alambic, alchimie, algèbre, almanach, ambre, azur, chiffre, coton, douane, girafe, hasard, épinard, jupe, magasin, matelas, nénuphar, orange, satin, sirop, sucre, tare. N'oublions pas qu'au XIe siècle les plus grands noms de la littérature, de la philosophie et de la science sont arabes. La science moderne, particulièrement la médecine, l'alchimie, les mathématiques et l'astronomie, est d'origine arabe. Dans ces conditions, il était normal que la langue arabe exerce une influence importante sur les autres langues. Cependant, l'arabe n'a transmis directement au français qu'un petit nombre de mots; la plupart des mots arabes nous sont parvenus par l'intermédiaire du latin médiéval, de l'italien, du provençal, du portugais et de l'espagnol. De plus, les Arabes avaient eux-mêmes emprunté un certain nombre de mots au turc, au persan ou au grec. Comme on le constate, les mots «voyagent» et prennent parfois de longs détours avant de s'intégrer dans une langue donnée. En voici quelques exemples de l'arabe ayant passé auparavant par le grec, le portu8gais, le latin, l'italien, l'espagnol, etc.:
abricot (port.)
alambic (grec)
alchimie (grec)
alcool (lat.)
alezan (esp.)
algarade (esp.),
algèbre (lat.)
algorithme
amiral
arabesque (it.)
arsenal (it.)
assassin (it.)
azimut
balais (lat.)
bédouincalife (it.)
carafe (it./esp.),
cheik
chiffre (it.)
coton (it.),
couscous
douane (it.)
échec (persan)
élixir (grec)
épinard (lat.)
estragon (grec)
fakir
gazelle,
gilet (esp.)
girafe (it.)goudron
guitare (esp.)
hachisch
harem
iman (turc)
jarre (prov.)
jupe (it.)
laquais (esp.)
laque (prov.)
lilas (it.)
matelas (it.)
minaret (turc)
moka
momie
mosquée (it.)nénuphar (lat.)
orange (prov.)
raquette (lat.)
récif (esp.)
safran (persan)
satin (esp.)
sofa (turc)
sorbet (it.)
sucre (it.)
talisman (grec)
tamarin (lat.)
timbale (esp.)
zénith
zéro (it.)
Les emprunts à l'arabe ont surtout été faits entre les XIIe et XIXe siècles, mais les XVIe et XVIIe siècles ont été particulièrement productifs. Après 1830, c'est-à-dire après la conquête de l'Algérie par la France, d'autres mots arabes (une cinquantaine environ) ont pénétré dans la langue française: zouave, razzia, casbah, maboul, barda, kif-kif, toubib, bled, matraque, etc.
5.2 Les chiffres arabes

C'est la langue arabe qui a permis au français, comme à bien d'autre langues, de découvrir la numérotation en «chiffres arabes». Les Arabes avaient eux-mêmes emprunté à l'Inde ce système de numérotation qu'ils nommaient «chiffres hindîs». En France, un moine mathématicien et astronome du nom de Gerbert d'Aurillac (938-1003) avait découvert les chiffres arabes lors de ses études en Catalogne (Barcelone). À cette époque, les monastères catalans possédaient de nombreux manuscrits de l'Espagne musulmane; Gerbert s'initia à la science arabe, étudiant les mathématiques et l'astronomie. Il se rendit vite compte des avantages de la numérotation décimale, même s'il ignorait encore le zéro. Il fut l'un de ceux qui favorisa l'élection de Hugues Capet comme roi de France en juin 987. Devenu pape en 999 sous le nom de Sylvestre II (le premier pape français), il employa toute son autorité pour promouvoir la numérotation arabe, ce qui lui valut le surnom de «pape des chiffres». L'érudition de Sylvestre II était si considérable qu'il fut considéré comme l'un des plus grands savants de son temps, puis il tomba dans l'oubli. Cependant, dans leur forme actuelle avec le zéro, les chiffres arabes furent introduits en Europe par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci (v. 1175 - v. 1250). En 1202, celui-ci publia son Liber abaci (« Le livre des calculs »), un traité sur les calculs et la comptabilité basé sur le système décimal à une époque où toute l'Europe recourait encore aux chiffres romains. Ce sont des clercs, qui au retour des croisades, furent les véritables diffuseurs de la numérotation arabe en France. Bien que les chiffres arabes soient plus performants que la notation romaine, ils ne se sont pas imposés très rapidement. Le système fut même mal reçu, en raison notamment du zéro, qui désignait alors le néant ou le vide, une notion familière aux hindous, mais étrangère aux Occidentaux. En 1280, Florence interdit même l’usage des chiffres arabes par les banquiers. En réalité, le conservatisme des Européen en la matière faisait en sorte que les chiffres romains furent perçus comme l'un des «piliers de la civilisation» occidentale. Se considérant les fidèles héritiers de l'Empire romain, beaucoup d'Européens croyaient qu'ils ne pouvaient utiliser que les chiffres romains ou les chiffres grecs, pourtant très peu pratiques en matière de calcul. Il faudra attendre le XIVe siècle pour que les chiffres arabes soient acceptés grâce à l'influence de mathématiciens comme Chuquet, Viète et Stevin; ce fut la Révolution française qui généralisa en France l'emploi systématique de cette numérotation.

L'époque de l'ancien français a fait faire des pas de géant à la langue française. Mais le français n'était pas encore une langue de culture et ne pouvait rivaliser ni avec le latin ni même avec l'arabe, dont la civilisation était alors très en avance sur celle des Occidentaux. On comprendra pourquoi le latin de l'Église se perpétua: il n'avait pas de rival. Cependant, le français allait encore s'affranchir de ce qui lui restait du latin lors de la période du moyen français.
SOURCES : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s3_Ancien-francais.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-

1° période: 1330 - 1380 2° période: 1380 - 1413
La Guerre de Cent Ans est un conflit qui a opposé deux grandes dynasties féodales, les Plantagenets et les Capétiens pendant plus d'un siècle. L'enjeu en était la possession du Royaume de France.
Ces deux dynasties s'étaient déjà trouvées en conflit pendant un siècle entre 1150 et 1250, en effet dans les années 1150 l'Empire Plantagenet couvrait l'Angleterre et tout l'Ouest de la France. La Guerre de Cent Ans doit donc etre resituée dans le contexte d'un conflit familial beaucoup plus large.
Plantagenet et Capétiens sont des dynasties d'origine Francaise et au départ de cette guerre la part du nationalisme est relativement faible, il s'est cependant amplifié au fur et à mesure de son déroulement.
La Guerre de Cent Ans peut etre divisée en trois grandes périodes:
- la première va de 1330 à 1380, aprés des succés initiaux les Plantagenets sont quasiment chassés de France par le Roi Charles V.
- la seconde va de 1380 à 1413, elle est plus calme en terme militaire. Chaque pays est est occupé à règler ses difficultés et conflits internes.
- la troisième va de 1413 à 1453, les Plantagenets-Lancastre s'installent dans le Nord de la France. Avec l'aide initiale de Jeanne d'Arc, le Roi Charles VII finit par bouter les Anglais hors de France. Cette page décrit cette troisième période.Voici une présentation générale de la dynastie Capétienne. Une autre partie raconte l'histoire et l'ascension des ancetres des Capétiens, les Robertiens jusqu'à l'arrivée de Hugues Capet sur le trone de France puis l'histoire des Premiers Rois Capétiens. Vous trouverez aussi l'épopée étonnante d'une branche des Capétiens, la Maison des Capétiens-Anjou, issue du frère de Saint Louis, Charles d'Anjou. Elle a règné sur la Sicile puis Naples et enfin la Hongrie et la Pologne.
Les Capétiens-Valois se sont installés dans le Val de Loire du début du XVème jusqu'à la fin du XVIème siècle. Ce sont les Rois de France en Val de Loire.Sur un plan plus général découvrez cette présentation du Moyen-Age en Val de Loire et un rappel synthétique de l'Histoire de France pendant le Le Haut Moyen-Age (VI - Xèmes siècles) et le Le Moyen Age (XI - XVèmes siècles). Visitez les Cathédrales et Abbayes et Chateaux-forts du Moyen-Age.
Sources : http://www.francebalade.com/histo/guerrecentans3.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
1° période: 1330 - 1380 3° période: 1413 - 1453
La Guerre de Cent Ans est un conflit qui a opposé deux grandes dynasties féodales, les Plantagenets et les Capétiens pendant plus d'un siècle. L'enjeu en était la possession du Royaume de France.
Ces deux dynasties s'étaient déjà trouvées en conflit pendant un siècle entre 1150 et 1250, en effet dans les années 1150 l'Empire Plantagenet couvrait l'Angleterre et tout l'Ouest de la France. La Guerre de Cent Ans doit donc etre resituée dans le contexte d'un conflit familial récurrent.
Plantagenet et Capétiens sont des dynasties d'origine Francaise et au départ de cette guerre la part du nationalisme est relativement faible, il s'est cependant amplifié au fur et à mesure de son déroulement.
La Guerre de Cent Ans peut etre divisée en trois grandes périodes:
- la première va de 1330 à 1380, aprés des succés initiaux les Plantagenets sont quasiment chassés de France par le Roi Roi Charles V.
- la seconde va de 1380 à 1413, elle est plus calme en terme militaire. Chaque pays est est occupé à règler ses difficultés et conflits internes. Cette page décrit cette seconde période.
- la troisième va de 1413 à 1453, les Plantagenets-Lancastre s'installent dans le Nord de la France. Avec l'aide initiale de Jeanne d'Arc, le Roi Charles VII finit par bouter les Anglais hors de France.Voici une présentation générale de la dynastie Capétienne. Une autre partie raconte l'histoire et l'ascension des ancetres des Capétiens, les Robertiens jusqu'à l'arrivée de Hugues Capet sur le trone de France puis l'histoire des Premiers Rois Capétiens. Vous trouverez aussi l'épopée étonnante d'une branche des Capétiens, la Maison des Capétiens-Anjou, issue du frère de Saint Louis, Charles d'Anjou. Elle a règné sur la Sicile puis Naples et enfin la Hongrie et la Pologne.
Les Capétiens-Valois se sont installés dans le Val de Loire du début du XVème jusqu'à la fin du XVIème siècle. Ce sont les Rois de France en Val de Loire.Sur un plan plus général découvrez cette présentation du Moyen-Age en Val de Loire et un rappel synthétique de l'Histoire de France pendant le Le Haut Moyen-Age (VI - Xèmes siècles) et le Le Moyen Age (XI - XVèmes siècles). Visitez les Cathédrales et Abbayes et Chateaux-forts du Moyen-Age.
sources : http://www.francebalade.com/histo/guerrecentans2.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
2° période: 1380 - 1413 - 3° période: 1413 - 1453
La Guerre de Cent Ans est un conflit qui a opposé deux grandes dynasties féodales, les Plantagenets et les Capétiens pendant plus d'un siècle (1330-1450). L'enjeu en est la possession du Royaume de France.
Ces deux dynasties s'étaient déjà trouvées en conflit pendant un siècle entre 1150 et 1250. En effet dans les années 1150 se développe l'Empire Plantagenet qui couvre l'Angleterre et tout l'Ouest de la France. Au début du XIIIème siècle le Roi de France Philippe Auguste conquiert une large part du domaine Francais des Plantagenets. Ceux-ci ont donc toujours en tete la récupération de leur ancien patrimoine. L'origine de la Guerre de Cent Ans doit donc avant tout etre resituée dans le contexte d'un conflit familial récurrent.
Plantagenets et Capétiens sont des dynasties d'origine Francaise et au départ de cette guerre la part du nationalisme Francais ou Anglais est relativement faible, il s'est cependant amplifié au fur et à mesure de son déroulement. (Ce n'est qu'a posteriori et pour justifier des choix politiques qu'une perspective nationale a été donnée à ce conflit).
Les Capétiens vont sortir vainqueur de cette guerre et rester encore plus de quatre siècles sur le trone de France. Par contre en Angleterre la défaite entrainera la perte du trone Britannique pour les Plantagenets.
La Guerre de Cent Ans peut etre divisée en trois grandes périodes:
- la première va de 1330 à 1380, aprés des succés initiaux les Plantagenets sont quasiment chassés de France par le Roi Charles V.
- la seconde va de 1380 à 1413, elle est plus calme en terme militaire. Chaque pays est est occupé à règler ses difficultés et conflits internes.
- la troisième va de 1413 à 1453, les Plantagenets-Lancastre s'installent dans le Nord de la France. Avec l'aide initiale de Jeanne d'Arc, le Roi Charles VII finit par bouter les Anglais hors de France.Voici une présentation générale de la dynastie Capétienne. Une autre partie raconte l'histoire et l'ascension des ancetres des Capétiens, les Robertiens jusqu'à l'arrivée de Hugues Capet sur le trone de France puis l'histoire des Premiers Rois Capétiens. Vous trouverez aussi l'épopée étonnante d'une branche des Capétiens, la Maison des Capétiens-Anjou, issue du frère de Saint Louis, Charles d'Anjou. Elle a règné sur la Sicile puis Naples et enfin la Hongrie et la Pologne.
Les Capétiens-Valois se sont installés dans le Val de Loire du début du XVème jusqu'à la fin du XVIème siècle. Ce sont les Rois de France en Val de Loire.Sur un plan plus général découvrez cette présentation du Moyen-Age en Val de Loire et un rappel synthétique de l'Histoire de France pendant le Le Haut Moyen-Age (VI - Xèmes siècles) et le Le Moyen Age (XI - XVèmes siècles). Visitez les Cathédrales et Abbayes et Chateaux-forts du Moyen-Age.
SOURCES : http://www.francebalade.com/histo/guerrecentans.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
Dans la deuxième moitié du XIIème siècle, l'Anjou, le Maine et la Touraine sont au coeur de l'Epopée des Plantagenets. En effet avec Henri II Plantagenet la famille des Comtes d'Anjou se trouve propulsée au premier rang en Europe, avec un Empire dans l'Ouest de l'Europe s'étendant de l'Ecosse aux Pyrénées.
Pendant près de cinquante ans les Plantagenets sont prédominants en Europe et paraissent capables de balayer les Rois de France Capétiens. Le Roi Louis VII est débordé par l'énergie de Henri II Plantagenet qui lui prend meme l'Aquitaine et sa Duchesse, la célèbre Aliénor, la femme la plus extraordinaire du Moyen-Age en Europe de l'Ouest.
Pourtant le fils de Louis VII, le Roi Philippe II Auguste, qui est particulièrement habile, parviendra à casser l'Empire Plantagenet. Au final la famille des Comtes d'Anjou ne conservera que le Royaume d'Angleterre sur lequel elle règnera plus de trois siècles.
Cependant cette lutte avec les Rois de France trouvera son prolongement deux siècles plus tard avec la Guerre de Cent Ans dont un des objectifs principaux était de permettre à la famille Plantagenet de recouvrer ses anciens domaines patrimoniaux en France.Geoffroy Plantagenet
Aliénor d'Aquitaine
Henri le Jeune
Jean sans TerreHenri II Plantagenet
Thomas Beckett
Richard Coeur de Lion
Henri III Plantagenet
Visitez : Angers Chinon Saumur
Chateau de Chinon
l'Abbaye de Fontevraud
SaumuroisDécouvrez les dynasties Francaises concurrentes des Plantagenets :
Les Capétiens : Résumé sur les Capétiens, De Hugues Capet à Louis VII le Jeune,
De Philippe II Auguste à Philippe III le Hardi
Autres dynasties : Comtes de Poitou et Comtes de Blois.
Des familles Comtales et Seigneuriales importantes ont été vassales des Plantagenets :
Comtes de Vendome, Vicomtes de Thouars, Sires d'Amboise. votre commentaire
votre commentaire
Dona Rodrigue