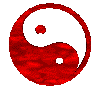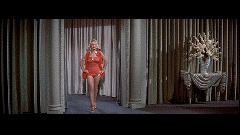-
 La chevalerie est une caste supérieure de guerriers au code moral très strict, et se donnant pour mission de protéger la veuve et l’orphelin.
La chevalerie est une caste supérieure de guerriers au code moral très strict, et se donnant pour mission de protéger la veuve et l’orphelin.Au cours du XIe siècle, dans tout l’Occident chrétien, se développe une nouvelle classe sociale, celle des chevaliers. En fait, pour être juste, on devrait dire la caste des chevaliers, car les chevaliers n’ont jamais fait partie de la grande classification qui va de soi au Moyen Âge parce qu’au départ, ils sont recrutés dans toutes les classes. Ils sont d’abord et avant tout des spécialistes de la guerre, rassemblés autour des maîtres du pouvoir, les aidant à défendre le territoire et à maintenir la paix.
La guerre au XIIe siècle n’est pas seulement une lutte opposant deux peuples, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. Elle est intégrée à la vie quotidienne, conséquence, souvent, du régime féodal. Quelles qu’en soient les motivations, elle est un facteur de troubles et d’insécurité, provoquant la misère et la famine du peuple, qui ne participe pas à la lutte, mais en subit toutes les retombées économiques et morales. À cela, bien entendu, il faut ajouter le désordre intérieur : en toute époque de crise et d’insécurité, il faut survivre, d’où l’apparition d’un banditisme qui prend les formes les plus diverses.
La chevalerie aurait donc été créée pour garantir la société de tous les désordres, intérieurs et extérieurs. Son code moral lui impose la protection de la veuve et de l’orphelin, c’est-à-dire de tous les démunis.
Si, au départ, le chevalier provient de n’importe quelle couche de la société, la chevalerie se trouve peu à peu rassemblée par sa situation privilégiée au faîte de l’édifice politique et social. En effet, l’évolution récente de l’art de la guerre a fini par rendre plus efficaces les combattants dont l’armement était complet – armement dont la pièce maîtresse était le cheval. Rapidement, donc, les chevaliers se sont élevés au-dessus de la piétaille. Même si tous deux font la guerre, il ne faut pas confondre chevalier et soldat : le chevalier ne touche pas de solde. On comprend donc qu’au XIIe siècle, seuls les plus riches peuvent posséder un cheval et tout l’équipement nécessaire (la lance et l’épée, l’écu, le heaume et le haubert).
La caste des chevaliers, déjà étroite, s’est refermée progressivement jusqu’à se réserver le titre, transmis de génération en génération. Ainsi, il existe une justification démocratique de l’aristocratie : les meilleurs et les plus forts ont été choisis par les victimes de l’oppression. La noblesse est donc directement issue du peuple qui, incapable de se défendre lui-même, confie son sort à des protecteurs.
 Les seigneurs se préparent très jeunes au métier des armes. Ils sont tout d’abord pages, c’est-à-dire qu’ils aident le suzerain à s’habiller et font de légères tâches pour lui (messages, courses, etc.). Ils sont ensuite valets, puis, écuyers – ils s’occupent alors des chevaux, entretiennent les armes, portent les bagages, etc. Vers l’âge de quinze ans, ils sont enfin admis au combat.
Les seigneurs se préparent très jeunes au métier des armes. Ils sont tout d’abord pages, c’est-à-dire qu’ils aident le suzerain à s’habiller et font de légères tâches pour lui (messages, courses, etc.). Ils sont ensuite valets, puis, écuyers – ils s’occupent alors des chevaux, entretiennent les armes, portent les bagages, etc. Vers l’âge de quinze ans, ils sont enfin admis au combat. C’est par la cérémonie de l’adoubement que l’écuyer devient chevalier. Le rituel, assez complexe, commence la veille de la cérémonie : le futur chevalier doit prendre un bain, jeûner et passer la nuit en prières. Après la messe et la communion du matin, on remet au jeune homme ses armes défensives et offensives.
On le frappe ensuite violemment, soit de la main, soit du plat d’une épée : c’est la colée, qui vise à éprouver le jeune chevalier et à montrer sa force. Il est ensuite invité à prouver son habileté et sa puissance au jeu de la quintaine. Enfin, le nouveau chevalier doit prêter serment sur la Bible, promettre fidélité à son seigneur et protection aux pauvres, à la suite de quoi on le fête en donnant un grand banquet en son honneur.
Ceux qui sont chargés de protéger le peuple doivent posséder diverses qualités. Son code moral, très strict, donne au chevalier des valeurs de référence. Il doit d’abord être preux, c’est-à-dire vaillant. Par le mot « prouesse », on désignait l’ensemble des qualités morales et physiques qui font la vaillance d’un guerrier. Le chevalier doit donc être fort physiquement et psychologiquement. Il doit être fort, agile, rapide et courageux. Devant le danger, un chevalier ne recule pas. Il ne craint pas pour sa vie, puisqu’il la voue à protéger les faibles. Mais une prouesse, si elle n’est pas connue, ne sert strictement à rien. Le vainqueur d’une épreuve sort toujours davantage grandi lorsqu’il y a des témoins.
Il doit aussi être loyal. En effet, le premier devoir du chevalier est de tenir parole. S’il rompt la foi qu’il a jurée, c’en est fait de sa réputation. Il faut savoir que la chevalerie est une fraternité dont tous les membres s’entraident. D’ailleurs, il est important que les chevaliers puissent se faire confiance, puisqu’ils vont combattre ensemble : ils doivent être assurés que leurs camarades ne les laisseront pas tomber. La largesse est aussi une valeur du chevalier modèle. Il s’agit du mépris du profit, voire de la prodigalité. Un chevalier ne devait pas s’attacher aux richesses, mais les distribuer autour de lui dans la joie.
Enfin, un bon chevalier fait preuve de mesure, c’est-à-dire qu’il sait réprimer les excès de sa colère, de son envie, de sa haine, de sa cupidité, qu’il est capable de rester maître de lui-même dans le feu de l’action. La mesure est donc l’équilibre entre la prouesse et la sagesse.
Afin de l’enseigner aux futurs chevaliers, on les faisait jouer... aux échecs. La courtoisie a aussi contribué à promouvoir la mesure – quand elle n’a pas elle-même versé dans l’excès. On peut dire d’un chevalier qui suivait ces règles morales qu’il vivait selon une éthique de l’honneur. En fait, ce qu’un chevalier doit redouter, c’est la honte, plus encore que la mort.

En temps de paix, les chevaliers s’adonnent à la chasse, sport noble, et au tournoi1. Pour conserver intacte leur ardeur guerrière, les chevaliers se battent « amicalement » entre eux. En fait, ce sont des exercices très sérieux et très violents, véritable école de guerre. Ils aiment aussi, bien sûr, les fêtes...
Si, à la vérité, c’est souvent pour leur force brutale que les premiers chevaliers étaient choisis2, c’est un autre tableau que présente la littérature, où ils doivent non seulement être forts et courageux, mais beaux. Dans le monde courtois, la laideur est une tare, une faiblesse. Les chevaliers doivent aussi avoir du charme et de l’esprit, être polis et bien élevés, être courtois, en somme.
Il est bien certain que la chevalerie arthurienne, telle qu’elle est décrite dans les romans, représente un idéal et n’a jamais existé, mais la littérature a ceci d’intéressant que, opérant une synthèse entre le mythe et la réalité de l’époque, elle donne une image minutieuse de la façon dont on voyait le chevalier idéal au XIIe et au XIIIe siècle, dans les cours des grands féodaux de l’époque.
1. Bien qu’il ait emprunté plusieurs formes – dont la mêlée –, il semble qu’au XIIe siècle, le tournoi était un sport mondain assez ritualisé, où se succédaient des joutes singulières strictement réglées, à la lance ou à l’épée.
2. Duby dit de la chevalerie que seuls le corps et le cœur y comptaient, non l’esprit : par choix, la chevalerie était illettrée.
Réf. : Georges DUBY, La Chevalerie, Paris, Perrin, 1993, et Le Moyen Âge. Adolescence de la chrétienté occidentale 980-1140, Genève, Skira, 1995 [1967], p. 81 ss. ; de Jean FLORI, La Chevalerie, Luçon, Éditions Jean-Paul Gisserot, 1998 ; de Didier MEHU, Gratia Dei. Les chemins du Moyen Âge, Québec, Musée de la civilisation et Fides, 2003, p. 153-155 ; de Jean MARKALE, Lancelot et la chevalerie arthurienne, Paris, Imago, 1985, p. 157-197 et Dictionnaire du Moyen Âge, histoire et société, Paris, Encyclopædia universalis et Albin Michel, 1997, p. 228-233 (article « Chevalerie », écrit par Georges DUBY).Histoire de la littérature française
Caractéristiques de la chevalerieLes seigneurs se préparent au métier des armes dès leur enfance. Ils sont d'abord pages, valets puis écuyers. Ils aident leur suzerain à s'habiller, entretiennent ses armes, s'occupent des chevaux. En tant qu'auxiliaires, ils portent le lourd écu (bouclier) du chevalier lorsqu'il est au combat.
 Vers l'âge de quinze ans, ils sont admis au combat et s'initient aux manœuvres des armées. C'est l'adoubement qui fait du jeune écuyer un véritable chevalier. Il s'agit en fait d'un rite de passage : après avoir reçu ses armes, le nouveau chevalier est frappé soit du plat d'une arme sur l'épaule, soit de la main sur la joue – c'est la colée, symbole de sa résistance.
Vers l'âge de quinze ans, ils sont admis au combat et s'initient aux manœuvres des armées. C'est l'adoubement qui fait du jeune écuyer un véritable chevalier. Il s'agit en fait d'un rite de passage : après avoir reçu ses armes, le nouveau chevalier est frappé soit du plat d'une arme sur l'épaule, soit de la main sur la joue – c'est la colée, symbole de sa résistance.S'il leur revient de protéger les faibles, de faire la guerre, en temps de paix, ils s'adonnent à la chasse, sport noble, et au tournois. Pour conserver intacte leur ardeur guerrière, les chevaliers se battent « amicalement » entre eux. En fait, ce sont des exercices très sérieux et très violents, véritable école de guerre
Son code moral très stric donne au chevalier des valeurs de référence. Il doit d'abord être preux, c'est-à-dire vaillant. Par le mot « prouesse », on désignait l'ensemble des qualités morales et physiques qui font la vaillance d'un guerrier. Le chevalier doit donc être fort physiquement et psychologiquement. Il doit être courageux. Devant le danger, un chevalier ne recule pas. Il ne craint pas pour sa vie, puisqu'il la dédie à protéger les faibles. Il doit aussi être loyal. En effet, le premier devoir du chevalier est de tenir parole. S'il rompt la foi qu'il a jurée, c'en est fait de sa réputation.
Il faut savoir que la chevalerie est une fraternité dont tous les membres s'entraident. D'ailleurs, il est important que les chevaliers puissent se faire confiance, puisqu'ils vont combattre ensemble : ils doivent être assurés que leurs camarades ne les laisseront pas tomber. La largesse est aussi une valeur du chevalier modèle. Il s'agit du mépris du profit, voire de la prodigalité. Un chevalier ne devait pas s'attacher aux richesses, mais les distribuer autour de lui dans la joie. Enfin, un bon chevalier fait preuve de mesure, c'est-à-dire qu'il sait réprimer les excès de sa colère, de son envie, de sa haine, de sa cupidité, qu'il est capable de rester maître de lui-même dans le feu de l'action.
La mesure est donc l'équilibre entre la prouesse et la sagesse. Afin de l'enseigner aux futurs chevaliers, on les faisait jouer... aux échecs. La courtoisie a aussi contribué à promouvoir la mesure – quand elle n'a pas elle-même versé dans l'excès.
Ainsi, les qualités d’un bon chevalier sont :
-
prouesse
-
loyauté
-
largesse
-
mesure
-
courtoisie
On peut dire d'un chevalier qui suivait ces règles morales qu'il vivait selon une éthique de l’honneur (règles de comportement et de convenances).
 Un tournoi devant Arthur
Un tournoi devant Arthur
sources : http://www.la-litterature.com/dsp/dsp_display.asp?NomPage=1_ma_007_chevalerie
 votre commentaire
votre commentaire
-
-

La société du Moyen Âge est une société fortement hiérarchisée, fondée sur la transmission héréditaire du pouvoir, des titres et de la richesse. Au XIIe siècle, la société est divisée en trois classes ou ordres : les clercs et les hommes d’Église, les guerriers (seigneurs et chevaliers) et les « travailleurs », qui sont paysans, artisans, etc. Deux de ces classes se disputent le pouvoir : les guerriers et les hommes d’Église. Dans les faits, toutefois, aucune de ces trois classes n’est plus importante que les autres, puisqu’elles sont interdépendantes. En effet, ceux qui travaillent ont besoin de la protection des guerriers, qui ont, en retour, besoin du fruit des labeurs des paysans et des produits des artisans. Quant aux hommes d’Église, ils ont besoin à la fois de la protection des chevaliers et du travail des paysans et des artisans. En retour, les deux autres ordres ont besoin de l’Église pour s’assurer du bien-être de leur âme et obtenir la « vie éternelle ».
Ainsi, la féodalité est un moment particulier dans l’histoire occidentale qui est la conséquence directe de la dissolution de l’autorité publique, assumée jusqu’alors par le roi. En effet, l’affaiblissement de la royauté au IXe siècle change les rapports politiques et, peu à peu, le pouvoir de commander, de rendre justice et de taxer les gens du commun se répartit entre de petites cellules autonomes construites autour des châteaux. Les seigneurs de ces domaines (qui sont parfois très vastes) ont coutume de les séparer en plus petits lopins, qu’ils font cultiver par des paysans libres. Ces parcelles de terres sont appelées fiefs – en fait, le mot « féodalité » est apparu au XVIIe siècle pour qualifier ce qui se rattache au fief.
C’est donc dire que la société et l’économie du XIIe siècle sont fondées sur l’exploitation des paysans par l’aristocratie dans le cadre de la seigneurie. Même si la terre ne leur appartient pas, les paysans peuvent en garder les fruits ; ils doivent cependant remettre une partie de leur récolte au seigneur et payer pour divers services (entre autres, pour traverser les ponts et pour l’utilisation du moulin seigneurial).
La féodalité est donc un régime économique et politique : le roi divise ses terres en fiefs qu’il distribue à ses barons à la condition expresse que ceux-ci les défendent. À leur tour, les barons divisent ces espaces en territoires plus petits, que les serfs (paysans libres) cultivent pour eux. C’est toute une pyramide qui se construit alors, chaque homme détenant sa terre d’un autre, plus puissant que lui.
Entre eux, les hommes sont liés par le serment de fidélité, prononcé au cours de la cérémonie de l’hommage. Il s’agit d’un contrat liant deux personnes par un serment de protection et de travail (le fort protège le faible, qui travaille pour lui). Le seigneur le plus puissant, le suzerain, reçoit l’hommage du seigneur plus faible ou du simple paysan, qui devient son vassal. En échange, il l’investit d’un fief. Au cours de la cérémonie, le vassal, sans armes, s’agenouille devant son suzerain, place ses mains jointes dans les siennes en signe de soumission et se déclare son « homme ». Le suzerain le relève, lui donne un baiser sur la bouche (signe de paix) et lui remet un objet (un bâton ou une lance, souvent) symbolisant le fief – c’est l’investiture. Puis, le vassal jure sur les Évangiles ou sur des reliques qu’il sera fidèle à son suzerain.
Dans les premiers temps de la féodalité, le fief revient au suzerain à la mort du vassal. Il peut alors le donner à un autre de ses vassaux ou aux descendants du défunt. Peu à peu, cependant, les vassaux prennent l’habitude de le transmettre en héritage à leurs descendants, de sorte que le fief devient héréditaire. Mais, justement, comme les vassaux le retransmettent à tous leurs fils et à toutes leurs filles, ils morcellent et appauvrissent les domaines.
Les deux personnes unies par l’hommage ont des devoirs l’une envers l’autre, elles ont des obligations réciproques. Le vassal doit à son suzerain le service d’ost (l’assistance militaire : il doit rejoindre son seigneur avec ses hommes, en cas de guerre), le service de cour ou de conseil (il doit siéger à la cour ou au tribunal) et l’aide aux quatre cas, c’est-à-dire une aide financière spéciale (pour la rançon, l’armement du fils aîné, le mariage de la fille aînée ou le départ pour la croisade)1. Le suzerain, quant à lui, doit à son vassal aide et protection et ne doit commettre aucune injustice à son égard.
À cette protection on ajoute habituellement le devoir d’entretien, c’est-à-dire qu’il lui revient de fournir à son vassal de quoi vivre, ce qu’il fait le plus souvent en l’investissant d’un fief. En fait, le seigneur joue souvent un rôle économique puisqu’il aménage le territoire en construisant moulins et étangs, met en place une administration, avec des « officiers », percepteurs de redevances et juges. Ainsi, avant de s’organiser autour de l’église, la ville naissante s’organise autour du château fort... souvent loin de l’image qu’on s’en fait2.
Le lien d’hommage unit les deux hommes toute leur vie, sauf manquement de la part de l’un ou de l’autre à ses obligations. Celui qui rompt sciemment le contrat peut être accusé de félonie ; pour le vassal, cette accusation peut mener à la confiscation par le suzerain de son fief.
L’organisation féodale a pu causer parfois quelques problèmes. En effet, que faire quand on est lié à plusieurs seigneurs qui se font la guerre entre eux ? C’est le concept d’hommage-lige qui a permis de répondre à cette épineuse question : il s’agit de l’hommage principal, celui qu’il faut respecter en priorité. (Mais il est même arrivé que certains vassaux se voient dans une situation où les deux seigneurs dont ils étaient les hommes-liges entrent en guerre...)
Le roi, bien sûr, est au-dessus de cette organisation sociopolitique, puisqu’il est « élu par Dieu ». En fait, le roi, au départ simple suzerain, se voit conférer une autorité supérieure, une autorité incontestable par le sacre. Toutefois, l’hérédité du fief fait en sorte que la puissance du roi diminue puisque certaines terres lui échappent ; ses revenus diminuent d’autant, comme les hommes à sa disposition pour le service d’ost. En n’ayant pas la puissance militaire pour faire valoir son droit divin, il est souvent plutôt une figure symbolique qu’un roi tout-puissant comme on en verra plus tard (comme Louis XIV, par exemple).
1. L’évêque Fulbert de Chartres, au début du XIe siècle, écrivait que « l’obligation fondamentale du vassal [était] de ne rien faire qui puisse causer dommage au seigneur dans son corps, dans ses biens, dans son honneur ». Cela a bien changé à la fin du Moyen Âge, où le vassal doit donner plusieurs jours par semaine pour aider son seigneur à diverses tâches, comme faire les foins, construire ou reconstruire des murailles et des palissades, etc.
2. Au Xe siècle, le château est une tour ou un donjon en bois, entouré d’une palissade à l’abri de laquelle les paysans vont se réfugier en temps de guerre. Il se situe généralement en hauteur (au sommet d’une colline ou d’une éminence artificielle qu’on appelle la « motte », et qui symbolise le pouvoir féodal). Didier MÉHU, dans Gratia Dei. Les chemins du Moyen Âge (Québec, Musée de la civilisation et Fides, 2003, p. 140), fait un bref historique de l’évolution du château fort tout au long du Moyen Âge très intéressant.
Réf. : Marc BLOCH, La Société féodale, Paris, Albin Michel (L’Évolution de l’humanité), 1968 [1939], p. 209 ss., de Jean FLORI, La Chevalerie, Luçon, Éditions Jean-Paul Gisserot, 1998, p. 26-29, de Jean SURET-CANALE, Panorama de l’histoire mondiale, Paris, Marabout (Savoir pratique), 1996, p. 160-161 et le Dictionnaire du Moyen Âge, histoire et société, Paris, Encyclopædia universalis et Albin Michel, 1997, p. 334-344 (article « Féodalité », écrit par Georges DUBY).La société médiévale est fondée sur la transmission héréditaire du pouvoir, des titres et de la richesse. Elle présente donc une structure hiérarchique rigide. La société est divisée en trois classes ou ordres :
- ceux qui prient, c'est-à-dire les clercs et les hommes d’Église
- ceux qui combattent et qui dirigent, les guerriers (chevaliers et seigneurs)
- ceux qui travaillent, soit les paysans et les artisans.
Ce monde est très cloisonné. Chacun y est le vassal de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire son subalterne : le serf est soumis à son seigneur ; l'écuyer, à son chevalier ; le chevalier, à son roi ; l'amant courtois, à sa dame. L'Église elle-même est calquée sur ce modèle.
C'est l'hommage qui lie les hommes entre eux. Il s'agit d'un contrat liant deux personnes par un serment de protection et de travail (le fort protège le faible, qui travaille pour lui). En fait, les deux personnes unies par l'hommage ont des devoirs l'une envers l'autre, elles ont des obligations réciproques. Le vassal doit à son seigneur :
- le service d'ost - l'assistance militaire ;
- le service de conseil (siéger à la cour ou au tribunal) ;
- l'aide aux quatre cas, c'est-à-dire une aide financière spéciale (pour la rançon, l'armement du fils aîné, le mariage de la fille aînée ou le départ pour la croisade).
Le seigneur, quant à lui, doit à son vassal :
- la protection
- l'entretien (c'est-à-dire qu'il lui fournit de quoi vivre, le plus souvent une terre avec des paysans - un fief).
Il faut savoir que ces serments ne peuvent être rompus, sous peine d'être accusé de félonie. Cela peut causer parfois quelques problèmes. En effet, que faire quand on est lié à plusieurs seigneurs qui se font la guerre entre eux ? C'est le concept d'hommage-lige qui permet de répondre à cette épineuse question ; il s'agit de l'hommage principal, celui qu'il faut respecter en priorité.
Le roi, bien sûr, est au-dessus de cette organisation sociopolitique, puisqu'il est élu par Dieu…

Hommage d’un châtelain au duc de Bourbon
Bibliothèque nationalesources : http://www.la-litterature.com/dsp/dsp_display.asp?NomPage=1_ma_002_feodalite
 votre commentaire
votre commentaire
-

- Il est le plus grand auteur romantique et probablement le plus grand poète du XIX siècle (il est, en tout cas, le plus prolifique)e
- Voit le poète comme un guide qui doit mener l'homme à la vérité et se sent lui-même investi d'une mission humanitaire et religieuse, « car le Mot c'est le Verbe, et le Verbe c'est Dieu »
- Sa expose la théorie romantique telle qu'il la conçoitPréface de Cromwell
- Hernani, un de ses premières pièces, est restée célèbre pour la bataille qu'elle provoqua à la première entre les tenants de l'esthétique classique et les romantiques
-
Œuvres les plus connues
- Cromwell
- Hernani
- Ruy Blas
- Quatre-vingt-treize
- Notre-Dame de Paris
- Les Misérables
- Les Travailleurs de la mer
- Les Orientales
- Odes et ballades
- Chansons des rues et des bois
- Les Contemplations
- La Légende des siècles
- L'Art d'être grand-père
Textes :
1453
Âme que j'ai trouvée…
Certe, elle n'était pas femme…
La Conscience
Le Poète au ver de terre
Oh ! si vous existez, mon ange
Puisque j’ai mis ma lèvre...
Sultan Mourad
Textes complets :
Quatre-vingt-treize (733 Ko)
L'Âne (147 Ko)
L'Année terrible (331 Ko)
À propos de Shakespeare (56 Ko)
L'Art d'être grand-père (190 Ko)
Bug-Jargal (339 Ko)
Chansons des rues et des bois (213 Ko)
Les Contemplations (1) (245 Ko)
Les Contemplations (2) (312 Ko)
Les Feuilles d'automne (143 Ko)
La Fin de Satan (293 Ko)
La Légende des siècles (1) (260 Ko)
La Légende des siècles (2) (228 Ko)
Notre-Dame de Paris (1064 Ko)
Odes et ballades (357 Ko)
Les Orientales (141 Ko)
Les Rayons et les ombres (167 Ko)
sources : http://www.la-litterature.com/dsp/dsp_display.asp?NomPage=5_19s_009_romantisme_08
 votre commentaire
votre commentaire
-

Considérez et réfléchissez en vous-même de quelle manière en notre temps Dieu a transformé l'Occident en Orient ; nous qui avons été des Occidentaux, nous sommes devenus des Orientaux ; celui qui était Romain ou Franc est devenu ici Galiléen ou habitant de la Palestine ; celui qui habitait Reims ou Chartres se voit citoyen de Tyr ou d'Antioche.Nous avons déjà oublié les lieux de notre naissance ; déjà ils sont inconnus à plusieurs de nous, ou du moins ils n'en entendent plus parler. Tels d'entre nous possèdent déjà en ce pays des maisons et des serviteurs qui lui appartiennent comme par droit héréditaire ; tel autre a épousé une femme qui n'est point sa compatriote, une Syrienne ou Arménienne, ou même une Sarrasine qui a reçu la grâce du baptême ; tel autre a chez lui ou son gendre, ou sa bru, ou son beau-père, ou son beau-fils : celui-ci est entouré de ses neveux ou même de ses petits-neveux ; l'un cultive des vignes, l'autre des champs ; ils parlent diverses langues, et sont déjà tous parvenus à s'entendre.
Les idiomes les plus différents sont maintenant communs à l'une et à l'autre nation, et la confiance rapproche les races les plus éloignées. Il a été écrit en effet, « le lion et le bœuf mangent au même râtelier. » Celui qui était étranger est maintenant indigène, le pèlerin est devenu habitant ; de jour en jour nos parents et nos proches nous viennent rejoindre ici, abandonnant les biens qu'ils possédaient en Occident. Ceux qui étaient pauvres dans leur pays, ici Dieu les fait riches ; ceux qui n'avaient que peu d'écus possèdent ici un nombre infini de byzantins ; ceux qui n'avaient qu'une métairie, Dieu leur donne ici une ville. Pourquoi retournerait-il en Occident celui qui trouve l'Orient si favorable ? Dieu ne veut pas que ceux qui, portant leur croix, se sont dévoués à le suivre tombent ici dans l'indigence. C'est là, vous le voyez bien, un miracle immense, et que le monde entier doit admirer.
Foucher de Chartres, Histoire des croisades (XIIe). Tiré de la Collection des mémoires relatifs à l'Histoire de France de François Guizot, 1825.
 votre commentaire
votre commentaire
-
La culture populaire est la culture du peuple, lequel est traditionnellement opposé aux élites. Le clivage qui sépare ces deux cultures est néanmoins loin d'être imperméable : la monarchie tente d'harmoniser les cultures « régionales » tandis que les élites tendent à imposer leur manière d'être, caractérisée par la retenue, le contrôle des pulsions et la pudeur. Si le XVIIIe siècle est le siècle du mépris de cette culture populaire, paradoxalement celle-ci suscite l'intérêt à des fins d'apprivoisement, de contrôle des masses.Le jugement des élites sur le peuple :
Le siècle des Lumières est celui du mépris du peuple, considéré comme « une multitude aveugle et bruyante » (d'Alembert). Ce mépris n'est pas nouveau, se retrouvant déjà au XVIe siècle : « Le vulgaire est une bête sauvage, tout ce qu'il pense n'est que vanité, tout ce qu'il dit est faux et erroné, ce qu'il réprouve est bon, ce qu'il approuve est mauvais, ce qu'il loue est infâme, ce qu'il fait et entreprend n'est que pure folie » (Pierre Charon, De la sagesse, 1601). D'Holbach considère qu' « il n'y a qu'un très petit nombre d'individus qui jouissent réellement de la raison ou qui aient les dispositions et l'expérience qui la constituent ». Voltaire conseillait à d'Alembert : « Portez-vous bien, éclairez et méprisez le genre humain » (lettre de 1757). Si ce discours est méprisant, les élites cherchent néanmoins à connaître l'état d'esprit de la population et les bruits qui courent : à Paris, rapporte Louis-Sébastien Mercier, « La Cour est fort attentive aux discours des Parisiens : elle les appelle les grenouilles. Que disent les grenouilles ? Se demandent souvent les princes entre eux. » (Tableau de Paris). En 1745, le contrôleur général Orry ambitionne de dresser un état de l' « esprit public des populations » du royaume en utilisant des méthodes plutôt originales : il conseille aux intendants de « semer les bruits » d'une augmentation des impôts, puis de relever les marques de l'émotion engendrée.
Puis on tente de contrôler les masses. La monarchie propose à tous les habitants du royaume les mêmes fêtes, rituels et cérémonies : l'entrée du roi dans la ville, un mariage princier, un Te Deum,... De même, l'Eglise tente d'imposer un modèle auquel tous doivent s'identifier, par le biais de l'histoire des saints, les sermons ou catéchismes. Les cultures régionales s'harmonisent dans un processus d'acculturation : l'historien Benoît Garnot parle de « dressage culturel ».Aspects de la culture populaire

La famille :
 Nicolas Lancret. Le repas de noces (1735).
Nicolas Lancret. Le repas de noces (1735).Contrairement aux idées reçues, la famille typique dans la France de l'Ancien Régime est la famille conjugale limitée aux parents et aux enfants (et non la famille large étendue aux grands-parents, aux oncles et cousins). Il peut arriver qu'elle se recompose suite à la mort de l'un des deux parents. Le nombre d'enfants n'est pas non plus très élevé : 3-4 environ. Tout au long du XVIIIe siècle se développe ce que des historiens appellent le « refus de l'enfant » ; un comportement malthusien se développe : on fait moins d'enfants pour mieux s'en occuper tandis que le recours aux pratiques contraceptives s'accentue (recettes de rebouteux, préservatifs en peau de porc, coït interrompu). L'âge du mariage est tardif et recule tout au long du siècle (28 ans pour les garçons, 25 ou 26 pour les filles) ; les remariages sont fréquents (un tiers des mariages implique un veuf ou une veuve).
La cellule familiale coïncide souvent avec le groupe de travail : le père est aussi le chef de l'exploitation et sa domination se caractérise par exemple par sa place à table. La femme a la quasi-exclusivité des travaux de la maison et du soin des enfants, elle aide aussi son mari pour certains travaux agricoles secondaires.
Le voisinage tient aussi un rôle important puisque tout le monde fréquente à peu près les mêmes personnes durant le travail et les loisirs. Ces relations de voisinage se marquent entres autres par l'échange de services ou d'outillages pour les travaux agricoles, les repas en commun, les rassemblements pour les veillées d'hiver, les jeux collectifs de boules et de quilles et les devoirs rendus pour les mourants des familles voisines.
Le raffinement des mœurs
Au XVIIIe siècle, de nombreux petits guides ou traités de politesse diffusent dans les milieux populaires l'art des bonnes manières, calqué sur les codes nobiliaires. C'est ainsi qu'au cours du siècle, il devient condamnable, même dans les milieux paysans, de mettre la main dans le plat commun : l'usage des ustensiles s'impose (à la fin du XVIIIe, à Chartres, trois habitants sur quatre possèdent des fourchettes et cuillères) ; chacun se retrouve maître de son assiette et de son verre. La promiscuité jouit désormais d'une mauvaise image : il est mal vu de dormir à plusieurs dans un même lit. On apprend aussi à se moucher dans un mouchoir. Le soin du corps gagne en importance et s'inscrit dans le discours scientifique et la croyance en le progrès véhiculés des Lumières ; la mortalité recule partout et les grandes crises démographiques s'espacent puis disparaissent. De nombreux petits traités médicaux ou hygiénistes sont écrits à destination de tous (L'Orthopédie ou l'art de prévenir et corriger dans les enfants les difformités du corps de Boisregard en 1741, l'Education médicinale des enfants de Brouzet en 1754, la Dissertation sur l'éducation physique des enfants de Ballexserd en 1762,...).
Dernier aspect significatif de la diffusion de la civilité : le recul de la violence. Les crimes jugés sont moins graves et les peines plus légères. La criminalité contre les personnes (meurtres, blessures, coups) recule tandis que celle contre les biens augmente.
Les lectures populaires :
Même si le peuple est analphabète dans sa grande majorité, le livre est très présent dans les milieux populaires, même à la campagne. Ceux qui ne savent pas lire profitent des lectures collectives à haute voix durant les veillées de l'hiver. Un livre peut servir pour plusieurs familles. La Bibliothèque bleue, destinée spécialement aux plus pauvres, est la plus connue des collections populaires. Elle comporte des textes issus de genres variés (titres savants, livres religieux, astrologie, cuisine, jardinage, contes de fées, récits chevaleresques, farces,...) tirés d'ouvrages anciens ou de nouveautés dès que le privilège de l'éditeur initial parvient à expiration (souvent 12 à 14 ans). Les libraires n'hésitent pas à retoucher les textes pour les rendre accessibles aux milieux peu cultivés : des paragraphes superflus sont supprimés ou transformés, de nouveaux chapitres sont ajoutés ainsi que des titres et résumés.
Deux fléaux pour la monarchie : le jeu et la prostitution :
Les hommes du XVIIIe siècle ont la passion du jeu, qui s'exprime tout particulièrement dans les jeux de hasard. A Paris, les joueurs de loterie se réunissent, dans les coins des rues, dans les cabarets, dans des maisons de jeu pour parier sur tel ou tel numéro. Cette pratique est largement condamnée par les moralistes qui y voient une menace pour l'économie (non-investissement d'une part de l'argent acquis) et la civilité (égoïsme et superstition). En 1793, la Révolution ira jusqu'à interdire la loterie nationale. La monarchie tente d'encadrer ces jeux afin d'éviter toute dérive, ce qui entraîne descentes de police et recours aux mouchards. La répression est particulièrement forte sur un tout autre domaine : la prostitution, fléau qui touche à Paris près d'une femme sur sept en âge de la pratiquer (25 000 personnes). La police arrête en moyenne 800 prostituées tous les ans, lesquelles sont jugées et enfermées provisoirement à l'hôpital de la Salpêtrière.
Etienne Jeaurat, Conduite des filles de joie à la Salpêtrière (1745).
L'éducation dans les milieux populaires :
Les écoles :
Sous l'Ancien Régime, l'éducation de l'enfant n'est pas faite principalement par les parents mais par les adultes du bourg (voisins, vieillards et amis), par la parole et le travail (association aux travaux des champs, apprentissage des comportements sociaux, etc.). La monarchie ne créé pas d'écoles, celles-ci sont fondées sur l'initiative de l'assemblée des habitants de la paroisse ou d'un bienfaiteur (souvent l'évêque). Dans les villes, des écoles de chant héritées du Moyen Âge subsistent, des petites écoles sont créés par la municipalité, des communautés dévotes ou des particuliers.
L'enseignement dans les écoles primaires au XVIIIe est surtout assuré par des congrégations spécialisées (la principale est celle des frères des Ecoles chrétiennes, fondée à Reims en 1679). Les garçons et les filles sont séparés, parfois, lorsqu'il n'y a qu'un seul instituteur, celui-ci fait cours alternativement aux filles et aux garçons dans deux salles séparées. Quand les moyens sont insuffisants, une grange, le logis du maître ou le porche de l'église sert de salle de classe. Trois enseignements essentiels sont dispensés : l'éducation religieuse, l'instruction scolaire et des préceptes de civilités. L'enseignement scolaire consiste en l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et la maîtrise du calcul (chiffres romains et arabes, les quatre opérations de base et des règles utilitaires : compter en deniers, sols et livres). Les préceptes de civilités concernent les manifestations du corps, les habits, la coiffure, les manières à table.
L'enseignement est gratuit pour les familles les plus pauvres, mais la perte de travail représenté par la scolarisation des enfants freine les progrès de l'éducation. La scolarité dure jusqu'à 14 ans mais peu restent jusqu'au bout. Par conséquent, l'analphabétisme, s'il recule au XVIIIe siècle, reste très présent : en 1686-1690, 28 % des hommes signent, contre 14 % des femmes ; peu avant la Révolution, on passe à 47 % et 26 %. Le Nord et le Nord-Est de la France sont davantage alphabétisés que le Sud.
Faut-il éduquer le peuple ?
La question de l'éducation du peuple est largement discutée dans le cercle des philosophes. De nombreux textes sont relatifs à ce sujet comme l'Emile de Rousseau (1762), le Mémoire sur l'éducation publique de Guyton de Morveau ou Le Temps perdu ou les écoles publiques (1765) de Maubert de Gouvest. La question « faut-il éduquer le peuple ? » sera posée en dissertation en 1780 aux élites académiques sur l'initiative de Frédéric II et d'Alembert. Les dissertations reçues répondent à peu près également oui et non. L'Eglise considère que l'instruction est utile à l'ordre public, l'ignorance entraînant l'oisiveté et le libertinage. Voltaire au contraire est opposé à l'éducation des masses, ayant crainte que les paysans ne désertent leurs terres : « Moi qui cultive la terre, je vous présente requête pour avoir des manœuvres, et non des clercs tonsurés […]. Il est à propos que le peuple soit guidé et non qu'il soit instruit. Il n'est pas digne de l'être, il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants ».
Sources :
Benoît Garnot. Société, cultures et genres de vie dans la France moderne. Hachette supérieur, 2007.
Antoine de Baecque, Françoise Mélonio. Histoire culturelle de la France, T. 3, Lumières et liberté. Seuil, 2004.Sources : photographies google
 votre commentaire
votre commentaire
-
Aujourd'hui, au quotidien...
La table n'a plus le monopole des repas
Se mettre à table est une habitude encore vivace, mais plus systématique. 1 Français sur 2 se prépare un plateau-repas au moins 1 fois par semaine, selon le Crédoc (seulement 1 sur 3 en 1995). On mange devant la télé sur le canapé, sur un coin du bar, sur son lit, en surfant sur le Net...
La plupart des produits nomades, conçus pour être mangés hors de la maison, sont en fait consommés à domicile...
Des repas simplifiés
La trilogie entrée-plat-dessert est de moins en moins pratiquée à table. On estime que 67% des Français ne mangeront que 2 plats sur 3 au dîner à l'horizon 2020.
C'est un des principaux effets de la diminution du temps consacré à la préparation des repas du soir. Il n'a cessé de diminuer depuis les années 70 et se stabilise autour de 40 min depuis la fin des années 90. Depuis 1988, le temps de préparation des repas du week-end diminue aussi, sous l'effet de l'arrivée à l'âge adulte de nouvelles générations moins habituées à cuisiner : entre 1988 et 2003, il est passé de 60 à 46 min pour arriver à 33 en 2009.Des horaires de repas plus flexibles
Fini le sacro-saint dîner devant le 20 h. L'horaire du repas doit composer avec les rythmes de chacun. La proportion de Français qui ne dînent pas à heure fixe ne cesse d'augmenter, selon les enquêtes du Crédoc. Ils sont 25 % en 2008 alors qu'ils étaient seulement 15% en 1995. Il s'agit d'un véritable phénomène de génération et non d'un simple effet d'âge. Cette proportion atteindra 31 % en 2020.
Le repas perdure mais s'étale dans le temps et l'espace. On assiste à des transferts. Le midi, on mange une grosse salade et on boit un café. On s'offre un dessert plus tard, vers 16 h.
Vive la convivialité!
Quel que soit l'âge, manger ensemble reste très important: le temps passé à table est de 85 min par jour contre 38 min aux États-Unis.
Nous invitons plus qu'avant, même si notre façon de recevoir évolue: un apéritif qui se prolonge, un pique-nique, un barbecue ou même un plateau repas dans 17% des cas.Une envie d'exotisme
En 2008, 50,6 % des Français consommaient des aliments exotiques (36,4 % en 1995).
"II y a les voyages, mais pas seulement. Les jeunes sont plus ouverts sur le monde parce que la société est multiculturelle", souligne Pascale Hébel, directrice du département consommation du Crédoc.La cuisine est un loisir
La cuisine va-t-elle devenir une pièce inutile?
Non. D'abord parce que 94 % des français pensent que bien manger fait partie des plaisirs de la vie. Ensuite plus de 2 sur 3 affirment aimer cuisiner.
Son aspect corvée s'allège, la cuisine devient un loisir, une activité relaxante que l'on pratique occasionnellement, pour se faire plaisir et en faire profiter son entourage.
Le succès des cours de cuisine en témoigne. Autre motivation, l'envie de mieux contrôler ce que l'on mange suscite, selon les sociologues, un retour aux fourneaux de la génération des années 67/76 et des retraités.sources : http://ja6.free.fr/chapitres/heritage.htm
La Cuisine, enfin les repas pris à toute vitesse, les kebbab qui fleurissent : une viande cuite sur une tige de métal, pendant des heures, souvent au soleil...mayo... qui n'a plus d'heure....une feuille de salade.. et les frites, grosses comme des batons, bien grasses.... voilà aussi la "nouvelle nourriture" des gens pressés...même plus le temps de penser, de réfléchir et de vivre....( signé Dona )
Une adolescente de 16 ans est décédée en 2011 au C.H. de Chartres des suites d’une intoxication alimentaire. Elle avait ingurgité un kebab, dans un restaurateur indépendant de la ville, qui a été fermé le jour même par les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
 votre commentaire
votre commentaire
-
LA RENAISSANCE CULINAIRE DU XXème
Incontestablement, celui qui a établi définitivement ce que devait être l’art culinaire, tel qu’il avait été conçu par ses illustres prédécesseurs, Carême ou Dubois, est Auguste Escoffier. Cuisinier hors pair, il s’engage dans une restructuration et une codification minutieuse de la cuisine “l’adaptant”, comme il dit, aux impératifs plus modernes.
 Les théoriciens du XIXe siècle, les décrivent par un fonds, ou un coulis de base, additionné d’une liaison et d’un jus de cuisson, auxquels s’ajoutent des garnitures. Le résultat est une “sauce capitale” ou “grande sauce” qui servira à son tour de base pour d’autres sauces.
Les théoriciens du XIXe siècle, les décrivent par un fonds, ou un coulis de base, additionné d’une liaison et d’un jus de cuisson, auxquels s’ajoutent des garnitures. Le résultat est une “sauce capitale” ou “grande sauce” qui servira à son tour de base pour d’autres sauces. Mais avec Escoffier, le schéma est le suivant : un fonds additionné d’une liaison donne la sauce capitale, à laquelle on ajoute une garniture et un ou deux autres éléments pour faire une autre sauce. Par exemple. en ajoutant du beurre et du consommé de volaille à la sauce allemande de Carême, on obtient une sauce suprême. La cuisine ainsi codifiée devient comme un vaste jeu de poupées russes, qui s’emboîtent sans fin les unes dans les autres.

La période qui s’annonce est une période de stagnation, où la grande cuisine s’est quasiment momifiée, comme si les chefs cuisiniers d’alors, avaient décrété que la perfection avait été atteinte pendant la Belle Époque, on ne pouvait rien faire d’autre que répliquer les œuvres des grands maîtres.
Une exception, tout à fait notable cependant : Édouard Nignon. Homme, peu connu du grand public, mais nombreux sont les chefs contemporains qui lui sont redevables. Il officia dans toutes les grandes maisons de Paris, entre autres, à la Maison Dorée et au café Anglais et fut sollicité par le tsar, l'empereur d'Autriche et le président Wilson. Il est l’auteur d’un ouvrage merveilleux mais peu connu, L’Héptaméron des gourmets ou Les Délices de la table, l’un des plus beaux livres de cuisine du XXe siècle.À quelles sources allaient donc puiser les autres créateurs pour un renouveau de l’art ?
Mais dans la cuisine régionale, bien sûr!
Dans cette bonne vieille cuisine bourgeoise, sans pareille pour mitonner de petits plats traditionnels et savoureux. Une révolte semble s’imposer contre le centralisme parisien, contre l’uniformité et la standardisation rigide de gastronomie devenue internationale.
Dés le début de la Première Guerre mondiale, Pampille, pseudonyme de Marthe Allard, publie les bons plats de France. Elle épouse Léon Daudet, homme politique opposé aux idées socialistes et universalistes. Dans son ouvrage, il ne s’agit pas de grande cuisine, mais d’un intérêt, teinté de politique par les tenants d’un renouveau national, pour les spécialités régionales, opposées aux concoctions estimées dispendieuses et décadentes de la grande cuisine. Ses recette vedettes sont le pot-au-feu (Pot-au-feu “tradition”) et la poule au pot. (Poule au pot “de Lou Nouste Henric” du Béarn)
 En 1923 s’organise à Paris les 8 jours de la “Gastronomie régionaliste”, sous la direction d’Augustin de Croze.
En 1923 s’organise à Paris les 8 jours de la “Gastronomie régionaliste”, sous la direction d’Augustin de Croze.Des chefs de, toutes les provinces viennent présenter leur spécialités.
L’angevin Maurice-Edmond Sailland (1876-1956), allias Curnonsky, s’installe à Paris a l’âge de 18 ans afin de préparer Normale Sup. Il préfère alors se tourner vers le journalisme.
Il rédigera + de 100 ouvrages, tout au long de sa vie et va défendre la cuisine de terroir en publiant en 28 opuscules, la France gastronomique, consacrés à la cuisine régionale et aux meilleures tables de France. C'est, notamment, dans le volume consacré à l'Orléanais qu'il diffuse, en 1926, la recette de la célèbre tarte Tatin.
Il ne cessera de faire connaître les merveilles culinaires de nos provinces. Grâce à lui, la cuisine bourgeoise et provinciale connue un net regain d’intérêt.
Curnonsky présidait moult repas où défilait le “Tout-Paris” gourmand. En 1927, il est élu prince des gastronomes et fonde l'année suivante l'Académie des gastronomes, réalisant ainsi le vœu de Brillat-Savarin…Dans les années 1930, la cuisine française devient l’une des cuisines les plus intéressantes du monde contemporain. Parallèlement, le discours médical se mêle de cuisine. La diététique prend le devant de la scène, et à la gastronomie, s’adjoint la notion de régime. C’est l’époque où un nutritionniste de l’Institut Pasteur, Édouard de Pomiane, dont La Physique de la cuisine et son Art, explique au grand public les principes biochimiques de la cuisson des aliments !
La gastronomie se veut scientifique.



1936 1939 1943 
Dans les années 1960, le discours des nutritionnistes et des diététiciens se fait fortement entendre. L’image idéale du corps a changé, ainsi que les notions d’esthétique. La diététique médicalisée se vulgarise et, dans l’esprit des Français, se met en place la non-compatibilité du bon et du sain, de la gastronomie et de la diététique. Dilemme! Problème de fond, qui se pose à un peuple dont l’expression culinaire fait intrinsèquement partie de la culture...

Il fallait innover, réinventer, réconcilier bonne cuisine et bonne santé, et ce fut le fait d’un très grand cuisinier de ce siècle: Michel Guérard. Les choses vont enfin bouger. Henri Gault et Christian Millau, journalistes gastronomiques quelque peu iconoclastes envers sa majesté Michelin, se joignent à Guérard pour lancer “la nouvelle cuisine”. L’histoire semble alors se répéter quelque peu, car nous nous trouvons, comme nos ancêtres de 1600, dans une période de profond remaniement en matière d’art culinaire.

Dans les années 1960, le discours des nutritionnistes et des diététiciens se fait fortement entendre. L’image idéale du corps a changé, ainsi que les notions d’esthétique. La diététique médicalisée se vulgarise et, dans l’esprit des Français, se met en place la non-compatibilité du bon et du sain, de la gastronomie et de la diététique. Dilemme! Problème de fond, qui se pose à un peuple dont l’expression culinaire fait intrinsèquement partie de la culture...
C’est une révolution qui sera amplement suivie. Mais qu’y a-t-il de vraiment nouveau dans cette cuisine? À priori, le principe du respect de la saveur des aliments, du goût naturel des produits, ne date pas d’hier, nous l’avons vu.
Il s’agit donc d’un retour aux valeurs anciennes, mais, faisant appel aux techniques nouvelles.
Les types de cuisson se développent considérablement avec la vapeur, puis le micro-ondes.

Dans les années 80, la diversification des produits est telle, que les cuisiniers ont à leur portée à peu près toutes les denrées alimentaires de la planète. Dans leur zèle explorateur, certains ont pu commettre des plats aussi baroques que la morue aux fraises ou le turbot aux kiwis ou encore la salade “rive gauche”
La Varenne, en 1661, dans Le Cuisinier François, nous donnait bien une recette de “Poulet d’Inde à la framboise farci” !
On ne se libère pas de 150 années de répétitions respectueuses de recettes des maîtres anciens sans quelques excès...La période “exploratoire” est maintenant révolue et la création culinaire reprend ses droits.
Dans ce début du XXIe siècle, nous assistons à la mise en place de la tradition rénovée par le subtil amalgame des cuisines de terroir et des approches raisonnées de la nouvelle cuisine, elle-même héritière des grandes tendances du passé.
La cuisine française ne s’est jamais
aussi bien portée !
SOURCES : http://ja6.free.fr/chapitres/heritage.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
LA NAISSANCE DE LA “GRANDE CUISINE”- XVIIème et XVIIIème
C'’est aux XVIIe et XVIIIe siècles que la grande cuisine française va établir ses règles et étendre sa domination sur ce que, à l’époque, on considère comme le monde civilisé. Cette haute cuisine commence à se développer dans les grands établissements de l’aristocratie, puis dans les riches demeures particulières. Elle devient l’affaire de cuisiniers spécialisés.
Des maisons plus modestes et bourgeoises, va émerger une cuisine que l’on appellera “bourgeoise” puis “régionale”, pratiquée par des cuisiniers non professionnels et, le plus souvent, des femmes.
Les aspirations de la bourgeoisie à toujours plus de raffinement vont accélérer l’évolution des fastes de la grande cuisine. La noblesse qui se voit imitée dans ses goûts et sa distinction va, pour garder ses distances, redoubler de fastes culinaires, lesquels seront, à leur tour, copiés par les bourgeois. Les bouleversements de la Révolution n’y changeront rien.
Au XVIIe siècle, s’opère un changement du paysage culinaire. Le premier fait marquant est le déclin du goût pour les épices. La France qui, de tout l’Occident, avait été le plus grand consommateur d’épices, ce qui lui avait valu pour la première fois son statut de grand gastronome, s’en désintéresse alors qu’elles continuent à être très appréciées dans tout le reste de l’Europe. Il n’y a plus guère que le poivre, le clou de girofle et la muscade, en quantités discrètes, qui trouvent grâce à son palais.
À cette époque, les étrangers s’étonnent même du peu d’épices utilisées en France, et les Français voyageant dans d’autres pays d’ Europe manifestent leur dégoût, comme la comtesse d’ Aulnoy qui, se rendant en Espagne en 1691, dit n’avoir rien pu manger, tant tous les mets étaient assaisonnés d’épices et de safran. Les herbes aromatiques ont également changé: l’hysope, la rue, la marjolaine, la menthe ou la tanaisie disparaissent et sont remplacées par le thym, le laurier, le persil, la sarriette, la ciboulette, l’estragon et le romarin.

Les aliments végétaux, considérés au Moyen Age comme une nourriture paysanne, vont devenir la marque distinctive des tables princières. En fait, il semble bien que la grande cuisine française ait délaissé ce qui avait fait sa distinction par le passé pour prendre une nouvelle inspiration dans les ingrédients plus vulgaires, mais aussi plus naturels, des cuisines bourgeoises et paysannes. Elle en fait bientôt les critères du bon goût et du style culinaire à la mode…
Le beurre triomphe enfin. Absent des recettes du Moyen Age, il est mis rapidement à toutes les sauces ! Adopté par l’élite sociale il devient à l’instar des truffes (Œufs brouillés à la truffe) l’une des caractéristiques de la grande cuisine.
Transformation due au fait qu’au XVIIe siècle, le beurre est autorisé durant le Carême et les jours de jeûnes.La crème fraîche est encore négligée par les cuisiniers. En même tant que le beurre, l’emploi de graisses : saindoux, lard et huiles, employées dans la cuisine, augmente considérablement, notamment dans la confection des sauces.
Les sauces, c’est en effet à cette époque que l’on assiste à cet élément primordial de la cuisine classique, d’une conception radicalement différente, des “potages liants” médiévaux. En accompagnement du poisson, voici la “sauce blanche”, encore un peu acide à cause de sa petite quantité de verjus, mais rendu liante et épaisse grâce au beurre.
L’ancêtre de notre beurre blanc est recommandé pour accompagner le brochet! Toutes les autres sauces sont faites à base de bouillon de cuisson de ragoût et sont liées à la farine, aux jaunes d’œufs ou encore de pain, et additionnées de beurre. Le roux est né.

On le trouve mentionné dans Le Cuisinier François (1651), rédigé par La Varenne, écuyer de cuisine du marquis d’Uxelles. (Toasts en d'Uxelles de champignons) - (Amourettes gratinées à la d'Uxelles).
Son ouvrage se vendra jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle!La réduction est une nouvelle technique pour donner consistance aux sauces. Conservées dans des récipients séparés, afin d’être utilisées dans la confection de diverses préparations. L’événement est de taille dans l’histoire des techniques culinaires.
L’autre grande innovation est l’apparition des jus et des coulis, ancêtres des fonds, dont les cuisiniers développeront toute une théorie au XIXe siècle. Les jus sont des déglaçages de viandes rôties dans des récipients couverts, qui peuvent être réservés à divers usages, et les coulis sont très proches des fonds modernes. Pierre de Lune dans Le Cuisinier, rédigé en 1656, et le dernier des grands cuisiniers du XVIIe, Massaliot n’en mentionnent pas moins de 23 recettes différentes.

Mais cette grande cuisine ne naît pas sans querelles. Tout au long de ce siècle, des algarades entre partisans de la tradition et adeptes d une cuisine nouvelle se multiplient. Les réformateurs, insistent sur la nécessité de conserver aux aliments le goût qui leur est propre.
Enfin, la séparation rigoureuse qu’établissent les Français entre le salé et le sucré se met vraiment en place à cette époque.
Tandis que l’aristocratie se distingue en érigeant en règle dans ses cuisines ce qui doit être “le bon goût”, la bourgeoisie qui lui emboîte le pas, devient un public assidu des nouveaux livres de cuisine. Tel : Le Jardinier François et les Délices de la campagne, parus en 1654, de Nicolas de Bonnefons, 1er valet de chambre du jeune Louis XIV. Celui-ci, en fervent moderniste, énonce en précepte de base que les aliments doivent garder le goût que leur a conféré la nature.
Autre fait nouveau : l’auteur s’adresse aux dames qui ne rechignent pas à venir voir ce qui se passe dans la cuisine et, au besoin, à mettre la main à la pâte, particulièrement lorsqu’il s’agit de recettes sucrées et de la confection de friandises...

La manière de servir les grands repas change lentement. Vers la fin du XVIIe et jusqu’à la mort de Louis XIV, le cérémonial de table atteint le point culminant du formalisme. Disposition des plats, enchaînement des services et place des convives, tout est savamment réglementé selon les usages d’une hiérarchie sans compromis. Une ou deux fois par semaine, le repas du roi à Versailles est un spectacle ouvert à tous, et se déroule comme une véritable pièce de théâtre, avec le maître d’hôtel comme metteur en scène.
Le nouveau siècle et l’avènement de Philippe d’Orléans, le Régent, vont mettre en œuvre d’importantes transformations.

En homme qui aime la bonne chère, le Régent ne répugne pas à préparer lui-même des petits plats pour ses amis, dans une batterie de cuisine en argent, il introduit la mode des “petits soupers” et promeut le Champagne.
Il s’agit de repas servis pour un nombre très restreint de convives, avec un minimum de domestiques et où la qualité de la cuisine est de tout premier ordre. Le “bon goût” s’allie désormais à une intimité faite de convivialité.
Dans les grandes cuisines règne une querelle sans merci, qui divise toujours avec autant d’âpreté les Anciens et les Modernes. Pour ces derniers, seules comptent la simplicité et la pureté “naturelles”. Ce mouvement est bien établi dès les années 1740, mais que ce mot de “simplicité” ne trompe personne. En réalité, cette cuisine nouvelle exige un travail extraordinaire et, dans les plats, se mêlent quantités de saveurs, peut-être “naturelles” au départ, mais dont le résultat est d’une extrême complexité. Les ingrédients sont de plus en plus luxueux, les mélanges de base fort chers et compliqués, et les combinaisons de plus en plus recherchées. On parle beaucoup de théorie dans les cuisines.
Tous les grands auteurs culinaires de l’époque sont d’accord pour que l’on fasse table rase de l’encombrante cuisine des siècles précédents.
La cuisine des aristocrates reste une affaire d’hommes, et il faut aller jusqu’en Angleterre pour trouver des femmes “maîtres d’hôtel” (housekeeper). Menon, a la particularité de s’adresser dans ses écrits à 2 couches différentes de la société; à l’aristocratie avec ses Soupers de la cour, où il donne force conseils à la fois théoriques et techniques aux cuisiniers professionnels, et à la bourgeoisie avec sa Cuisinière bourgeoise, ouvrage plein de bon sens, plutôt destiné aux femmes et rempli de recettes fondées sur les produits du jardin et du marché. Ce dernier ouvrage remplacera Le Cuisinier François dans la liste des ouvrages de référence jusqu’au début du XIXe siècle.
Vincent de la Chapelle, autre cuisinier de renom officiant en Angleterre et grand voyageur, rédige Le Cuisinier moderne. Comme Marin, il énonce les bases théoriques de la grande cuisine. Sa “sauce espagnole” est toujours un classique. Dans le siècle suivant, il sera fort admiré par les grands cuisiniers, même si son recueil reprend plus d’un tiers des recettes des Soupers de la Cour de Menon
Dans ce siècle où se mettent en place les théories scientifiques modernes, où la philosophie est en pleine effervescence et où la Révolution se prépare, la cuisine suit un parcours assez particulier. Chez les aristocrates et chez les très riches, elle est d’un raffinement et d’un luxe extrême et exige une main-d’œuvre très spécialisée. Un menu d’apparat se compose alors de 4 services, comprenant plusieurs plats chacun (soit ± 2 par convive), plus un 5ème service de “dessert”, préparé à l’office et comportant confiseries, glaces pâtisseries et autres friandises.
Dans la bourgeoisie, faute de pouvoir suivre les tendances aristocratiques, on pratique une sorte de cuisine de compromis, en simplifiant et diminuant plats et ingrédients. Menon l’avait compris et il connaissait bien le public qui allait se ruer sur sa Cuisinière bourgeoise.
L’aristocratie éclairée ne dédaigne pas cette cuisine bourgeoise soit par souci de santé, soit aussi a la lumière des “nouvelles idées” par souci d’égalité. Un livre comme La maison rustique suite logique en quelque sorte aux Délices de la campagne du siècle précédent fait beaucoup pour propager dans les familles de province les principes de la cuisine bourgeoise qui comme toute cuisine de cette époque est essentiellement parisienne.

C’est à Paris que l’approvisionnement est le meilleur. Tous les chemins y mènent, les meilleurs produits du pays et des autres régions du monde s’y concentrent. Les grands cuisiniers ne peuvent véritablement officier que dans la capitale. Thé, café et chocolat ne sont plus considérés comme de curieuses nouveautés. Les premiers cafés parisiens font leur apparition. On y sert, bien sur, du café et on y discute avec véhémence des questions politique du jour. L’italien Procope, ouvre un café (1686) où il sert également des glaces. C’est une nouveauté, la fabrication de glaces ou de sorbets étant jusqu’à là le fait d’établissements aristocratiques.
Les légumes du Nouveau Monde sont devenus courants, même la pomme de terre, grâce aux efforts d’un certain Parmentier. Le pâté de foie gras (Tourte de foie gras d'Alsace), spécialité régionale d’Alsace, connaît une vogue qui ne fera que s’accroître et, en Normandie, une certaine Marie Marel dans son village de Camembert prépare un fromage qui fera les délices du monde entier. La pomme de terre va enfin faire son entrée sur les tables françaises, vers la fin du siècle.En 1765, un certain Boulanger, dénommé aussi Champ d’Oiseaux, ouvre une sorte de petit cabaret dans la rue des Poulies (aujourd’hui rue du Louvre), où il sert des “restaurants”, des bouillons a ses clients. Il offre également des volailles bouillies au gros sel et des œufs frais. N’étant pas traiteur, il n’a pas encore le droit à cette époque de vendre ragoûts ou plats en sauce...
En 1789, Antoine de Beauvilliers, qui a dirigé les cuisines de la Maison royale. ouvre à paris, rue Richelieu près du Palais-Royal, le premier restaurant tel que nous le concevons.
Comme à son ouverture, son établissement était très fréquenté par des aristocrates, Beauvilliers est emprisonné durant 18 mois sous la Terreur, mais a la chance de sauver sa tête. Lors de sa sortie. il ouvre un autre restaurant, Galerie de Valois. toujours au Palais-Royal, qui deviendra un haut lieu de la gastronomie.
Les restaurants se multiplient à Paris sous la Révolution.
Les aristocrates ont fui et leurs cuisiniers et maîtres d’hôtel se retrouvent sans emploi. Ils n’ont d’autre solution que de se faire restaurateurs. Certains, comme Beauvilliers, Méot ou Véry deviennent des célébrités nationales. L’ère des grands restaurants a commencé !Époque enthousiaste, voire tragique, où se côtoient, festins et famines. Les dirigeants révolutionnaires sont souvent de fameux gourmands. Même chez les condamnés, on festoie. Restaurateurs et traiteurs ont des contrats avec les prisonniers qui en ont les moyens, et qui se font servir d’exquises nourritures avant d’aller à la guillotine!

La haute cuisine est descendue dans la rue, les grands chefs ont des restaurants, et n’importe quel citoyen, du moment qu’il a de l’argent, peut manger comme le faisaient les grands aristocrates disparus. Sous le Directoire et jusqu’au début de l’Empire, lorsque s’éloignent enfin les horreurs de la Terreur, l'on assiste à une frénésie de gourmandise et jouissance, une envie irrépressible de plaisir: la France se remet à vivre.
Le premier à avoir eu l’idée de publier une revue gastronomique fut Grimaud de La Reynière. Gourmand obsessionnel, il est le créateur des premiers “labels”, un ancêtre du Michelin ou du Gault et Millau.
 Cependant, le plus grand écrivain sur la gastronomie fut sous Napoléon, Jean-Anthelme Brillat-Savarin 1755-1826 . ( Fondue “Brillat-Savarin”). Sans être cuisinier, ce très fin gourmet et homme du monde écrivit un ouvrage qui fit date dans la littérature gourmande : La Physiologie du goût (1828) ou Méditations de gastronomie transcendante (1826). Malgré son titre assez rébarbatif, à défaut de recette, l’ouvrage offre une passionnante série de réflexions sur la gastronomie. On y découvre une foule d’anecdotes et de souvenirs de repas simples ou mémorables.
Cependant, le plus grand écrivain sur la gastronomie fut sous Napoléon, Jean-Anthelme Brillat-Savarin 1755-1826 . ( Fondue “Brillat-Savarin”). Sans être cuisinier, ce très fin gourmet et homme du monde écrivit un ouvrage qui fit date dans la littérature gourmande : La Physiologie du goût (1828) ou Méditations de gastronomie transcendante (1826). Malgré son titre assez rébarbatif, à défaut de recette, l’ouvrage offre une passionnante série de réflexions sur la gastronomie. On y découvre une foule d’anecdotes et de souvenirs de repas simples ou mémorables.  Les petits soupers du XVIIIe siècle, avec leur raffinement dans la séduction. Sont remplacés par des repas intimes, dont le seul but est la jouissance des papilles. À ces agapes en comité restreint s’oppose, tout au long de ce siècle riche en événements politiques et diplomatiques, une grande cuisine vouée au gigantisme. Le Chef incontestable de ces généraux et stratèges des banquets est Antonin Carême. Quel tour de force fut le sien, quand il eut à composer, réaliser et diriger les opérations d’un grand repas comme celui du 12 février 1816 dans le théâtre l’Odéon en l’honneur de la Garde nationale. Les convives étaient plus de 3000 !
Les petits soupers du XVIIIe siècle, avec leur raffinement dans la séduction. Sont remplacés par des repas intimes, dont le seul but est la jouissance des papilles. À ces agapes en comité restreint s’oppose, tout au long de ce siècle riche en événements politiques et diplomatiques, une grande cuisine vouée au gigantisme. Le Chef incontestable de ces généraux et stratèges des banquets est Antonin Carême. Quel tour de force fut le sien, quand il eut à composer, réaliser et diriger les opérations d’un grand repas comme celui du 12 février 1816 dans le théâtre l’Odéon en l’honneur de la Garde nationale. Les convives étaient plus de 3000 ! Paris ne produit plus rien. On y fait plus pousser de légumes depuis bien longtemps, les moutons, porcs et vaches ont disparu des ruelles et arrières-cours. Mais, la capitale est devenue le lieu où convergent les meilleurs produits des “4 coins” du globe. Nous assistons à une belle extension du centralisme culinaire,
déjà bien amorcé au XVIIIe siècle.
La France de cette époque imagine être le phare culturel des sociétés civilisés, le nombril du monde. Paris est donc la capitale mondiale de la cuisine et du goût.
 Les conditions de travail ont considérablement évolué dans les cuisines. Non seulement le fourneau a fait son apparition, mais il est même en fonte et de plus en plus perfectionné. Cette merveille de modernité permet désormais de rôtir, cuire au four, braiser, griller...
Les conditions de travail ont considérablement évolué dans les cuisines. Non seulement le fourneau a fait son apparition, mais il est même en fonte et de plus en plus perfectionné. Cette merveille de modernité permet désormais de rôtir, cuire au four, braiser, griller... Durant ce siècle, que l’on a qualifié peut-être un peu trop arbitrairement : “Âge d’or de la gastronomie française”, vont s’affirmer les grands principes de la technique culinaire, qui en feront le modèle de la gastronomie internationale. Des fourneaux des grands cuisiniers vont naître des plats qui feront le tour de la planète et deviendront de grands classiques.

Paradoxalement, les 2 inventions techniques les plus fondamentales pour le traitement des aliments, à savoir la conserve par stérilisation découverte par Nicolas Appert et réfrigération mise au point par Ferdinand Carré, n’auront aucune incidence sur la cuisine à cette époque.
Dans ce siècle, la cuisine s’approprie les signes distinctifs de la société bourgeoise, à savoir la recherche des valeurs sûres et de la stabilité. Les recettes s’alourdissent et incorporent des quantités tout à fait considérables de beurre et autres corps gras, qui n’arrondissent pas que les saveurs...
Les cuisiniers du XIXe siècle, vont rivaliser d’ardeur et d’originalité afin de présenter les pièces extravagantes en sucre. massepain, graisse, viande ou toute autre substance modelable.
Nous voilà dans le siècle de la réussite ventripotente!

Le XVIIIe siècle invente la salle à manger. Jusque-là, on prenait ses repas dans la chambre à coucher ou l’antichambre. Nous parlons évidemment, des aristocrates du temps, cette distinction n'avait pas cours dans les humbles chaumières où une pièce unique accueillait hommes et bêtes.
Vers 1750. les couverts de table trouvent leur forme définitive, et de nombreux modèles d'orfèvrerie dessinés à cette époque sont toujours produits aujourd'hui. Le couvert s’enrichit de la petite cuillère. La table accueille nombre d’ustensiles de service nouveaux :
la louche, alors dénommée “cuillère à pot”, les cuillères à sel, à moutarde, à ragoût, à olives, à sucre en poudre... Ainsi que la saucière, le moutardier, l’huilier-vinaigrier, le beurrier, le sucrier à poudre...
La faïence commence à concurrencer l’orfèvrerie jusqu'alors de rigueur. Cette évolution annonce la table moderne telle qu’elle va apparaître entre la Révolution de 1789 et les années 1850.
Un autre changement fondamental va s’opérer : la transformation du service des repas. Dès le début du siècle, on peut voir dans la littérature culinaire la description de ce qui est appelé le service “à la russe”. Il s’agit, en fait, de servir les divers plats du repas les uns après les autres, en les présentant directement au convive. Les mets sont découpés et arrangés en cuisine, et peuvent être consommés chauds, dans la perfection de leur préparation.
Ce changement a une autre conséquence : désormais, les verres sont disposés sur la table. devant les convives. Ils font partie du décor, et les manufactures inventent alors les services de verres à vin, à madère, à liqueur, à champagne...
sources : http://ja6.free.fr/chapitres/heritage.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
LA RENAISSANCE - XIVème, début XVIIème
Période de transformation et de renouvellement socioculturel des États de l’Europe occidentale, qui s’étend de la fin du XIVe siècle au début du XVIIe siècle. Ce renouveau, eut son point de départ dans les Cités-États d’Italie. Sans parler de rupture brutale avec le Moyen Âge, les changements dans l’économie ont engendré des mutations sociales qui ont accéléré les mutations politiques, signant par la même, la fin de la féodalité.
L’apparition de la notion d’État reste une caractéristique essentielle de la période de la Renaissance. Les autres traits marquants sont l’accroissement démographique, l’essor des techniques, comme le développement de l’imprimerie, et des échanges, l’urbanisation, la naissance d’une bourgeoisie d’affaires, l’éclat culturel exprimé par les fastes de la vie de cour, le goût de la fête et des œuvres d’art.
Si la Renaissance en France est une période de grands changements tant dans le domaine artistique que scientifique, il n’en est pas de même pour la cuisine qui évolue selon un rythme séculaire. Dans les années 1500, le goût et les techniques semblent stagner à la table et à l’office, certains éléments se mettent en place pour amorcer la lente transformation qui verra le jour au siècle suivant.
Si l’on en croit Rabelais, sous François I , la cuisine est florissante, guidée par Pierre Pidoux et son livre La fleur de toute cuisine.
La cuisine devient un sujet d’écriture pour la première fois à cette époque. Cela va des descriptions de Montaigne sur ses préférences alimentaires, aux morceaux de bravoure de Rabelais décrivant les festins de Pantagruel ou la somptueuse abondance de l’île de maître Gaster. Ronsard lui-même, consacrera un sonnet à la salade…À noter, un ouvrage de cuisine : “très utile et profitable à tous. Contenant la manière d’habiller toutes sortes de viandes tant chair que poisson, et de servir banquets et festins”, une réimpression de ± 1610 du livre plus connu sous le titre de “Livre fort excellent de cuisine”, publié à Lyon en 1542.
Parallèlement, la découverte du Nouveau Monde permet l’arrivée de nouveaux produits en Europe: maïs, haricot, piment, potiron, tomate, dinde, pomme de terre, et surtout café et chocolat qui restent pour l’instant à l’état de simples curiosités pour les Français.

Après les guerres entre France et Italie, les échanges diplomatiques, les alliances et les mariages royaux, l’influence transalpine devient très marquante, notamment avec l'arrivée de la “Cour” de Catherine de Médicis.

Artichauts, nouvelles sortes de melons, pois frais et salades, s’imposent peu à peu dans les menus.
Le changement le plus frappant concerne l’usage grandissant du sucre. De denrée rarissime et à usage surtout thérapeutique, le sucre, que l’on se procure de plus en plus facilement devient un ingrédient de cuisine. L’un des premiers ouvrages de confiserie en français est rédigé par l’astrologue alchimiste Michel de Nostre-Dame, dit “Nostradamus”. La mode italienne a également changé la table. La Renaissance voit apparaître la table fixe, telle que nous la connaissons aujourd’hui, ainsi que la fourchette, au départ considérée comme une “curiosité orientale” dont on ne se servait guère que pour piquer des aliments poisseux, comme les fruits confits.
La mode italienne a également changé la table. La Renaissance voit apparaître la table fixe, telle que nous la connaissons aujourd’hui, ainsi que la fourchette, au départ considérée comme une “curiosité orientale” dont on ne se servait guère que pour piquer des aliments poisseux, comme les fruits confits.Les XVIe et XVIIe siècles sont marqués par la généralisation de l’assiette individuelle, au détriment du tranchoir, et du couvert composé d'une cuillère, d’une fourchette et d’un couteau. Désormais, on pique avec sa fourchette, et les lames des couteaux de table deviennent rondes. La faïence et le verre remplacent progressivement l’étain. Dans les cuisines, le matériel se sophistique.

L'’époque est également propice aux nouveautés, liées à l’émergence de nouvelles recettes et habitudes alimentaires : le pot à oille (sorte de ragoût de viande), ancêtre de la soupière, et les terrines. Les cafetières, théières, chocolatières et leurs tasses assorties, et comble du raffinement, les jattes à punch, que l’on boit dans des verres à pieds.


Enfin, le repas, s’il suit la même structure qu’au Moyen Age se décompose toujours en 3 services. Il se distingue néanmoins par une plus grande variété de plats.
L'’établissement d’une cuisine “classique” est en cours d’élaboration. Bien qu’aucun ouvrage de cette époque ne soit aussi précis et aussi riche en renseignements que ne l’avait été Le “Taillevent” pour les siècles précédents, il semble certain qu’une nouvelle cuisine se soit progressivement constituée entre 1500 et 1600, mais il faudra attendre le XVIIe siècle pour en trouver une trace écrite.
sources : http://ja6.free.fr/chapitres/heritage.htm votre commentaire
votre commentaire
-
Héritage & tendance de la cuisine française

Au pays de François Rabelais et d’Anthelme Brillat-Savarin, la cuisine est déjà depuis des siècles un véritable mode de vie.
Les Français ont développé l’art de se nourrir jusqu’à en faire un modèle de subtilité, de variété, de raffinement et aussi d’élégance.

Cependant, la variété des produits ne peut suffire à expliquer le prestige de la cuisine française. Le secret est ailleurs, détenu par les hommes qui la pratiquent...
La cuisine française a influencé toutes les cuisines du monde occidental, au point de devenir un symbole international de qualité et de prestige.
Par quels cheminements la France est-elle devenue le berceau de la gastronomie?
Certes, ce “beau pays” bénéficie d’un climat tempéré et ses régions sont d’une extraordinaire variété. De la montagne à la mer, en passant par les plaines et les vallées, “l’Hexagone” offre une somptueuse palette de paysages et de produits de toutes sortes.
Carrefour de populations très diverses : Celtes, méditerranéennes ou germaniques, pour n’en citer que quelques-unes, la France est ainsi devenue progressivement, le creuset d’influences et de cultures donnant le jour à ce qu’il serait possible d’appeler :
“ l’Homo gastronomicus”.

Les Romains, installés en colons, ont marqué leur contribution par l’apport de 2 produits essentiels : la vigne et le vin d’une part, l’huile d’olive d’autre part.
Ils ont également encouragé la culture du blé, modifiant ainsi progressivement les habitudes alimentaires des Gaulois (Celtes), plutôt amateurs jusque là, d’orge et de seigle.
La grande tradition culinaire des Romains, développée dans le monde antique sur le pourtour de la Méditerranée les a suivis ainsi que leurs produits les plus prisés tels le “garum” : (Pissaladière provençale) fait de saumure de poisson fermenté, “lasa faetida” au goût d’ail très relevé, le poivre ou la cannelle.

Ainsi, cette combinaison des traditions celtes et latines, fit que l’on mangeait aussi bien en territoire gallo-romain, qu’à Rome. Des grandes invasions à la chute de l’ Empire romain, les traditions gallo-romaines et les apports des peuples barbares vont faire mûrir, ce qu’il est convenu d’appeler, la cuisine médiévale.

LA CUISINE MÉDIÉVALE, du V au XVème
Le Moyen Âge, s’étend entre 476 : chute de l’Empire romain d’Occident, et 1453 : prise de Constantinople par les Turcs ou 1492 : découverte de l’Amérique.
Le Haut Moyen Âge s’étend, lui, du Ve siècle au XI - XIIe siècle.
Au cours de cette période qui va du Ve au XVe siècle, s’établissent les caractéristiques d’un art culinaire, se développant essentiellement dans les cours princières et ecclésiastiques.
 C’est à cette époque, que l’on adopte la position assise pour manger. L’habitude de manger assis à table ne s’est généralisée qu’au Moyen Age. Auparavant, la position semi-couchée, si prisée des Grecs et des Romains, restait de règle.
C’est à cette époque, que l’on adopte la position assise pour manger. L’habitude de manger assis à table ne s’est généralisée qu’au Moyen Age. Auparavant, la position semi-couchée, si prisée des Grecs et des Romains, restait de règle.
Les tables de ce temps étaient des tables provisoires, faites de planches posées sur des tréteaux, que l’on installait avant le repas pour la démonter aussitôt après. De là l’expression “dresser la table”, c’est-à-dire la construire, et non pas, comme on l’entend aujourd’hui, disposer le couvert. Une longue nappe tombante venait cacher les disgracieux tréteaux. Elle servait également de serviette, car on mangeait surtout avec les doigts.
Devant chaque convive, point d’assiette, mais un tranchoir, grande tranche de pain rassis sur laquelle on disposait les aliments. Plus tard, cette tranche fut elle-même posée sur une planche à découper individuelle qui prit également le nom de tranchoir. Pour se servir dans les écuelles où sont présentés les mets - surtout des viandes - on pique les morceaux avec la pointe d’un couteau.
Les pièces de viande entières, de volaille ou de gibier, font leur apparition sur les tables. En même temps, ce développe un art du découpage, confié à “l’officier” tranchant, qui occupe une position importante dans la hiérarchie naissante des grandes tables princières.
Les premiers textes culinaires en France datent de l’an 1300 environ. Il s’agit de traités à l’usage des grands de ce monde. Les documents sont beaucoup plus rares en ce qui concerne l’alimentation des paysans et petites gens.
L’approvisionnement dépend à la fois des variations saisonnières et du calendrier liturgique qui fait alterner jours maigres et jours gras. En effet, le bon catholique de l'époque doit faire maigre en moyenne 1 jour sur 3 ! Ce qui signifie s’abstenir de manger tout produit provenant d’un animal terrestre y compris les œufs et le lait. Il n’est donc pas rare, de trouver dans les ouvrages de cuisine de cette époque 2 versions d’une même recette, l’une pour les jours maigres, l’autre pour les jours gras. La viande est alors remplacée par du poisson, le lait par du lait d’amandes, le bouillon de viande par du bouillon de poisson, du vin, et parfois même par de la purée de pois secs.
Au début de l’hiver, les cochons engraissés, les bœufs et les moutons sont tués.
La graisse est conservée dans de grandes jarres. Le lard, les jambons et les saucisses sont fumés après salaison. On conserve les légumes verts dans le sel, les fruits en les faisant cuire dans du miel, les herbes et les champignons en les faisant sécher.
Les aristocrates chassent sur leurs terres. Les habitants des villes, quant à eux, ont à leur disposition la production des maraîchers et des éleveurs installés sur leur périphérie. Les monastères qui vivent en autarcie, sont amplement pourvus par leurs propres domaines.

Le sucre et le riz font plutôt partie de la pharmacopée, et sont considérés comme des nourritures pour malades. Ce n’est que très progressivement qu’ils s’introduiront dans la cuisine française.
Le pain est un aliment basique, qui se trouve à toutes les tables, et en grande quantité. À la cour comme à la ville, il est fabriqué par des spécialistes : les boulangers.
À la campagne, le four est la propriété du seigneur, les paysans viennent y faire cuire leur pain. Il s’agit toujours de pain de froment, sauf dans l’Ouest et le Centre où l’on préfère le pain de seigle ou le méteil (mélange de blé et de seigle), préférence qui se manifeste encore de nos jours.
Il en existe 3 catégories, correspondant de fait à 3 classes sociales bien distinctes : un pain très blanc, appelé “pain de bouche”, réservé aux riches, le “pain de ville”, un peu plus grossier, consommé par les artisans et petits bourgeois des villes, et enfin le “pain à tout”, très proche de notre pain complet actuel, foncé, lourd, considéré comme très grossier, destiné aux paysans et hommes de labeur.
Il existe aussi de nombreux pains fantaisies, tels que galettes, gaufres ou échaudés, dont la pâte est cuite à l’eau avant d’être mise au four. Le pain sert à épaissir et à lier les sauces. En tranches, il donne de la consistance à la soupe. Chez les riches, où il n’y a pas encore de vaisselle de table, une épaisse tranche de pain dur, appelée “tranchoir”. fait office d’assiette et sera ensuite donnée aux pauvres ou jetée aux chiens.

La viande est très appréciée. Elle représente l’aliment de prestige par excellence. C’est la substance la plus fortifiante. Dans les villes, les bouchers forment une corporation très influente. L’abattage des bêtes se fait quotidiennement, et la légende selon laquelle la cuisine du Moyen Age était très épicée afin de masquer le goût de la viande avariée est fausse.
La qualité des bêtes mises sur le marché varie bien entendu. Les “grosses viandes” de bœuf, de mouton ou d’animaux vieux, sont réservées aux travailleurs de force. Porc, veau et agneau sont nourritures de riches et de nobles qui ont, dit-on, l’estomac plus délicat.
Si le lait n’est pas très consommé, c’est uniquement parce qu’il se conserve mal.
Le fromage, en revanche, occupe une place importante dans l’alimentation, soit à table, soit comme ingrédient dans divers plats ou pâtisseries. Le brie et le roquefort sont déjà célèbres à cette époque. Quant aux œufs, ils jouent un rôle majeur en cuisine et en pâtisserie, en dehors des jours maigres évidemment...L'’aristocratie et les bourgeois, qui possèdent rivières et étangs, aménagent des viviers et peuvent avoir du poisson frais toute l’année. Pour ceux qui vivent loin des côtes, le poisson de mer est rarement accessible. Reste le poisson salé, morue ou hareng, (Harengs saurs “Lucifer”) très présent sur les tables les jours maigres.
Les médecins de l’époque déconseillent de manger des légumes. Ils les disent peu nourrissants comparativement au pain ou à la viande. Les panais, navets et autres racines, les herbes comme les épinards ou les bettes, les poireaux, pois et autres verdures restent les aliments du petit peuple, des paysans et des pauvres, même s’ils ne sont pas systématiquement négligés par quelques bourgeois soucieux d’économie.
Les fruits en revanche sont beaucoup plus prisés. Noix, noisettes, amandes, figues, cerises, raisins, pommes et poires trouvent leur place sur les tables des riches.

Longtemps. la cuisine médiévale a été dépréciée et dédaignée pour son usage, jugé excessif, des épices. La gastronomie de cette époque, fait montre d’un goût prononcé pour les mélanges fortement parfumés et savamment dosés et liés, lesquels sont à l’origine du légendaire goût français pour les sauces.
Le poivre, pas très cher, devient une épice populaire, mais reste dédaigné par les cuisiniers de l’aristocratie. En revanche, les “menues épices” c’est-à-dire : girofle, muscade, macis ou graine de paradis, sont extrêmement coûteuses, et par conséquent, fort prisées dans les grandes cuisines. S’y ajoutent galanga, poivre long, cannelle, gingembre et cardamome.
Le Viandier, l’un des plus anciens ouvrages de cuisine en langue française, mentionne 16 épices nécessaires à la confection de ses recettes.
Cette cuisine décrite par les bourgeois du XIXe siècle comme composée “d’abominables ragoûts”, est en fait une cuisine légère.Non pas dans le sens utilisé de nos jours pour qualifier la nouvelle cuisine, mais dans la mesure où elle fait très peu usage de corps gras.

Les sauces se font à partir de vinaigre de vin ou de verjus, parfois de jus de citrons, d’oranges amères, voire de grenades et sont parfumées de mélanges d‘épices pilés au mortier. Le goût de base le plus apprécié est acide et épicé. Il arrive que l’on adoucisse ce mélange par addition de sucre. Les sauces qui accompagnent les poissons, les volailles et rôtis sont liés au pain grillé et finement moulu. Le beurre et la crème sont dédaignés.
Les herbes qui parfument les plats ont des saveurs fortes et âcres : menthe, carvi, moutarde, hysope ou encore safran.
D’autres part, les cuisiniers d’alors accordent une importance extrême à l’effet visuel de leurs préparations. La couleur est un élément capital dans la composition des mets. Les recettes insistent beaucoup sur ce point.
Le vert s’obtient avec le vert de poireau ou le jus de d’épinards. Le safran, très fréquemment utilisé, mais la plus onéreuse des épices, donne le jaune. Le rouge s’obtient avec le tournesol ou le santal. Toutes sortes de substances, dont le lait ou le lait d’amandes. s’utilisent pour le blanc.Si les recettes qui nous sont parvenues montrent qu’il s’agit d’une cuisine légère, très peu grasse, elle n’en est pas pour autant “naturelle”. Loin de vouloir conserver aux aliments leur aspect ou saveur d’origine, les cuisiniers s’efforcent de déguiser et de masquer les plats, d’où ces préparations de “bœuf comme venaison d’ours” ou “d’esturgeon contrefait de veau”.


Viandes et poissons rôtis, grillés ou frits reposent sur des sauces liées au pain grillé. Les grosses pièces de chair et les volailles sont cuites à la broche et les rares légumes se présentent sous forme de purées épaisses. C’est l’âge d’or des pâtés, (“Potjesvlees” de Flandre“) dont certains atteignent de gigantesques proportions, contenant poissons, viandes ou oiseaux entiers rôtis.
Quelques préparation peu raffinées vont avoir beaucoup de progrès à faire pour devenir les fines pâtisseries, dont elles sont les ancêtres. Les mets sucrés sont les gaufres, les oublies, les petits gâteaux (comme les talmouses qui subsistent de nos jours…), les beignets, les crêpes, les tartes au lait ou au fromage, les fruits cuits dans le miel, les pains d’épices (Le “véritable” pain d'épices) ou les fruits frais.
Quant aux boissons, la plus répandue est le vin, souvent utilisé en cuisine. Dès le Moyen Âge, les grands vignobles de France sont déjà bien établis. Tout le monde boit du vin, généralement coupé d’eau. À la fin des repas on sert souvent l’hypocras (vin cuit, sucré et épicé, ancêtre de notre vin chaud). On boit aussi du cidre et du poiré, fait avec du jus de poires, ainsi que de la bière, descendante légitime de la cervoise des Gaulois !
À cette époque, apparaît le premier grand cuisinier français. En 1326, Guillaume Tirel, fils de Normand, débute dans la vie comme garçon de cuisine de Jeanne d’Évreux, épouse du roi Charles IV. Il doit, comme tous ses congénères, faire son lent et difficile apprentissage sous les ordres des maîtres queux et d'officiers de la bouche.
 Le travail est pénible, les jeunes marmitons sont souvent battus. L’enseignement repose entièrement sur la tradition orale. Puis le jeune homme devient “potagier”, c’est-à-dire spécialiste des ragoûts et des cuissons mijotées, et gravit lentement les échelons de la hiérarchie culinaire. Ses confrères l’ont surnommé Taillevent.
Le travail est pénible, les jeunes marmitons sont souvent battus. L’enseignement repose entièrement sur la tradition orale. Puis le jeune homme devient “potagier”, c’est-à-dire spécialiste des ragoûts et des cuissons mijotées, et gravit lentement les échelons de la hiérarchie culinaire. Ses confrères l’ont surnommé Taillevent. En 1346, il devient maître queux du roi Philippe VI, puis entre au service du Dauphin, duc de Normandie, et continue à diriger ses cuisines, lorsque celui-ci est couronné roi. Sous Charles VI, il atteint le sommet de la gloire, étant nommé écuyer de cuisine et maître des garnisons du roi. En 60 ans, il aura été au service de 5 rois. Il mourra comblé d’argent et d’honneurs, possédant des armoiries qui rappelleront sa fonction de cuisine.
Taillevent, est en quelque sorte l’ancêtre de générations d’artistes qui ont marqué à tout jamais l’histoire de la gastronomie, et même l’histoire tout court. Il a rédigé au cours de sa vie un livre de recettes, connu aujourd’hui sous le nom de Viandier de Taillevent, où il reprend les recettes de 2 précédents recueils anonymes, tout en en ajoutant d’autres de son cru.
Liber de coquina : est un autre excellent livre de cuisine, écrit en latin vers ± 1300. Il comporte 172 recettes réparties en 5 chapitres. Vraisemblablement d'inspiration italienne, il présente des similitudes notoires avec Il libro della cucina del secolo XIV de Zambrini. On trouve plusieurs recettes de ravioli, une recette de lasagnes, de tria génoises et de crozets, mais aussi une recette parlant de fromage de Brie … !
Sont également présentes plusieurs recettes d'influence étrangère. Cuisine catalane avec De brodio yspanico, qui décrit la picada, cuisine andalouse avec De limonia, De romania, De mamonia.
Beaucoup de recettes utilisent, bien sur, des plantes aromatiques, avec ou sans épices.À noter aussi l'excellent Tractatus de modo preparandi et condiendi omnia cibaria, d'après Jean-Louis Flandrin, ce Traité de la façon de ..., serait d'origine ecclésiastique.
Écrites en latin vers ± 1300, on trouve environ 80 recettes, réparties en 5 chapitres. Certaines recettes sont très détaillées, avec temps de cuisson et description précise du processus de préparation du plat (cf II.11, recette de lapins et lièvres...).
Enfin, le plus ancien recueil de cuisine en langue française trouvé à ce jour est connu sous le nom de Petit Traité de 1306. Il contient une collection très limitée de recettes. Le second manuscrit, appelé Le Manuscrit de Sion, parce que découvert assez récemment dans Le Valais. en Suisse, comprend les principales recettes présentent dans Le Viandier de Taillevent. Ces 3 recueils représentent les origines de notre littérature culinaire.
Mais le Viandier, restera le livre de référence jusqu’au XVIIe siècle, et même au-delà.L’importance du maître queux ou chef cuisinier, dans les maisons royales ou princières est immense. C’est un personnage considérable. Il existe des dynasties de cuisiniers, le savoir se transmet de père en fils. Le point culminant de la carrière étant atteint lorsqu’on devient écuyer de cuisine.

Plus modestement. les bourgeois des villes, même riches, ne s’offrent pas de maîtres queues, ils emploient des cuisinières, lesquelles ne jouissent pas d’un statut très élevé dans la hiérarchie domestique. Curieusement, le grand art culinaire en France semble avoir toujours été une affaire d’hommes. Pourtant. le rôle des femmes dans la gastronomie française est loin d’être négligeable.
Le recueil de recettes le plus vivant et le plus touchant n’est pas l’œuvre d’un cuisinier mais d’un bourgeois de Paris, dont on ne connaît le nom et qui décida d’écrire vers 1390, un traité de morale et d’économie domestique pour sa très jeune épouse, intitulé Le Ménagier de Paris, (Crème de petits pois - 1390)
Le Moyen Âge atteint une sorte de perfection dans l’art du festin. Le type de repas caractéristique de l’époque est bien le banquet. “Repas-spectacle”, occasion d’affirmer son rang, sa richesse et son prestige. Chez les grands de ce monde, comme chez les bourgeois qui peuvent se le permettre, le festin est donné à l’occasion de noces, d’alliances, de victoires, de naissances ou de tout autre événement important. C’est le moment par excellence qui concrétise les idéaux esthétiques et sociaux de l’époque.

Le menu se compose de plusieurs mets, que l’on appellera plus tard “services”. Le service comprend tout un ensemble de plats : rôtis, sauces, poissons ou pâtés, disposés sur la table. Chaque convive se servant de ce qu’il trouve devant lui. Les divers mets se suivent. Il peut y en avoir jusqu’à 6, voire plus. Régulièrement séparés par ce que l’on appelle logiquement les “entremets” : des spectacles offerts aux convives, c’est le début du service dit “à la française”.
Cette cuisine médiévale, aromatique, acide, légère, se retrouve par bien des aspects dans la cuisine moderne. Dénigrée pendant des siècles, elle a suscité les lentes transformations à venir des XVIe et XVIIe siècles, qui ont permis d’établir les grands préceptes de la cuisine classique.

SOURCES : http://ja6.free.fr/chapitres/heritage.htm
 votre commentaire
votre commentaire
Dona Rodrigue